| Accueil > Années 1952 > N°669 Novembre 1952 > Page 699 | Tous droits réservés |
En Argentine

|
Vers les cimes de l'Aconquija |

|
|
Il faut en chemin de fer, sur réseau à voie large, parcourir environ mille deux cents kilomètres dans la direction du nord pour aller de Buenos-Aires à Tucuman ; deux cents de plus si l'on emprunte la voie d'un mètre. Depuis Tucuman, historique (1), magnifique et opulente cité de plus de cent mille habitants, seule la voie d'un mètre déroule encore son rail six cents kilomètres vers le nord pour atteindre, à la Quiaca, la frontière bolivienne. Cette ligne passe sous le tropique du Capricorne un peu au nord de Jujuy, ville située à mi-chemin entre Tucuman et la Quiaca. Elle monte de Tucuman à Jujuy, puis escalade, sur trois cents kilomètres, une région accidentée et rocheuse, traversant des contrées plus hautes que nos sommets pyrénéens. Sur onze kilomètres, la traction est à crémaillère. Des voyageurs, sans quitter leur couchette de wagon-lit ou leur fauteuil de wagon-restaurant, y sont parfois atteints du mal des montagnes. Il est curieux alors d'y voir les garçons présenter à leurs clients non des bouteilles de whisky, mais des bouteilles d'oxygène. Comme nous voici loin de la capitale fédérale, loin des plaines d'élevage et de cultures des provinces de Buenos-Aires, Santa-Fé, Cordoba, Santiago del Estero. Bien loin aussi des immenses forêts plates de quebrachos rouges du Chaco austral ou du Chaco Santiagueno. L'horizon, le climat, la végétation, les gens, le dialecte même ont changé. Nous sommes dans un autre pays, presque dans un autre monde où l'on respire déjà l'air humide des tropiques. Venant du sud, peu avant d'arriver à Tucuman, après quelques ondulations de terrain, brusquement, au nord-ouest, une énorme barrière aux tons rosés, ocrés ou carminés l'hiver, sous son manteau de neige l'été (2), barre le ciel, majestueuse et formidable : la Cordillère des Andes se dresse.
Une opération topographique de longue durée devait, en 1914, nous retenir durant toute la saison sèche dans cette magnifique région, hélas malsaine : le « chucho », dénomination locale du paludisme, y épargne peu d'humains. Le torrent a donné son nom à la gare et au village. La sucrerie est alimentée en canne à sucre par des plantations qui bordent le rio Seco sur une quinzaine de kilomètres : depuis le chemin de fer jusqu'à la montagne. Chaque année, les cultures gagnent sur la forêt ; on coupe, on arrache, on brûle. Des arbres énormes, tels les « laureles », dont les énormes massifs sont inattaquables à la hache, sont vaincus par le feu entretenu à leur base durant des saisons entières. L'explosif a raison des souches. Ces plantations de canne ont tout de même une limite ; elle est contituée par les flancs rocheux des premières arêtes de la sierra. Les cimes de ces arêtes sont si étroites qu'un homme a parfois de la peine à y circuler. De chaque côté, un gouffre profond recouvert d'une forêt impénétrable. Depuis le chemin de fer, le lit du torrent, presque à sec en cette saison, est praticable à dos de mule sur une quinzaine de kilomètres ; plus loin, les blocs roulés par les eaux de crue deviennent tellement volumineux qu'il faut, pour avancer, bien connaître les pistes qui vous obligent souvent à faire des détours considérables. Le rio serpente entre des rives d'une sauvage beauté, rives coiffées d'une végétation dense où l'on n'entre qu'au machete. Des massifs rocheux à pic, dépassant parfois quatre ou cinq cents mètres de hauteur, tel le Moro de los Tastaces, vous surprennent par leurs teintes allant, suivant les formations, de l'ocre au blanc de craie, au vert émeraude et au bleu turquoise ; par leur végétation, qui les coiffe, et par leur masse. Plus on avance, plus on monte, plus les gorges se resserrent et s'obscurcissent ; à des hauteurs qui vous donnent le vertige, des arbres surchargés de lianes qui pendent dans le vide forment une voûte noire. Le chaos change d'échelle, c'est de l'alpinisme qu'il faut faire maintenant, sur des dizaines de kilomètres, avant d'apercevoir le ciel. À une altitude de deux mille cinq cents mètres environ, les géants de la forêt se font plus rares : les tipas au fût droit et noir, les noyers sauvages au bois et aux fruits durs comme du roc, les cèdres rouges au bois précieux, les énormes orangers sauvages qui embaument de leurs fleurs la forêt tout entière et jonchent le sol de leurs fruits effroyablement amers font place à une végétation moins avide de soleil et de chaleur. Des résineux à petites feuilles font leur apparition : les bambous se font moins touffus et, quelques centaines de mètres plus haut, leurs bouquets de perches séchées paraissent de gigantesques éventails. Des herbages propres aux pâturages donnent aux montagnes des tons vert tendre. Dépassant l'altitude de trois mille mètres, seuls les « quénos », par-ci par-là, présentent leurs petits troncs en forme de moignons, d'où partent deux ou trois branches squelettiques. Cet arbre est le dernier combustible utilisable pour le feu de camp. Il est curieux par son écorce qui le calorifuge, si l'on peut dire, et lui permet de supporter les énormes différences de température entre le jour et la nuit. Cette écorce est composée intérieurement d'une infinité de feuilles minces comme du papier à cigarette, enroulées les uns sur les autre et détachables. Plus haut encore, c'est le rocher abrupt de quartz rosé qui donne un aspect si original à ces montagnes chaotiques et sauvages. Les neiges éternelles, les glacier ne se rencontrent guère que sur les versants qui voient peu le soleil. Même l'Aconquija, qui domine le paysage de ses cinq mille six cents mètres, se présente sous le même aspect rosé, sauf, bien entendu, en temps de neige. Peu ou pas de plateaux, par conséquent les lacs sont très rares. La « laguna de Los Leones », vers trois mille mètres, dont la surface ne dépasse pas quelques hectares, est le seul que nous ayons rencontré. Nous avons passé dans la forêt malsaine et déserte des mois durs ; mais je n'oublierai jamais les nuits passées sous la tente, aux hautes altitudes, où le thermomètre descendait parfois à vingt-cinq degrés sous zéro. Dans la forêt, le dimanche, nous avions la chasse, qui constituait pour tous une belle distraction ; sur ces rochers abrupts nous avions le loisir de suivre, dans le ciel, les évolutions lointaines des condors à des hauteurs vertigineuses. C'était tout de même un peu monotone, et mes hommes avaient imaginé un divertissement que l'on ne peut s'offrir partout : ils appelaient cela le jeu de moutons. Cela consistait à ébranler d'énormes blocs et à les faire rouler dans les précipices. Ces blocs dévalaient bientôt à des vitesses folles, faisaient des bonds prodigieux. À la jumelle, on les voyait parfois éclater sous l'effet de la force centrifuge ; parfois, aussi, mille ou mille cinq cents mètres plus bas, dans la forêt déserte, ou supposée telle, ils fauchaient des arbres comme l'eussent fait des obus de gros calibre. On s'amuse comme on peut dans l'Aconquija ! L'équipe en question faillit d'ailleurs ne jamais revenir. Un jour de septembre, de gros nuages noirs voilèrent les cimes. Peu après, de gros flocons de neige se mirent à tomber. Plus que les tremblements de terre, auxquels nous étions accoutumés, ils nous plongèrent dans l'inquiétude. Nous levâmes le camp dans un temps record ; mais il nous fallut deux jours pour atteindre la zone où la neige se transforme en pluie. Deux jours et deux nuits d'angoisses, de glissades, animaux et gens. Un jour plus tard, nous n'aurions pas pu nous en sortir. Le plus âgé de nos guides : Molina, homme de soixante-deux ans, qui, toute sa jeunesse, avant la construction du chemin de fer de Bolivie, avait été muletier et qui demeurait toute l'année dans la Cordillère, nous confessa qu'il ne s'était jamais trouvé dans une semblable situation et que les condors avaient manqué de peu de faire ripaille. Léon VUILLAME.
(1) C’est le 9 juillet 1816, à Tucuman, que le Congrès
des Provinces Unies du Rio de la Plata déclara l'indépendance de l'Argentine. |

|
Le Chasseur Français N°669 Novembre 1952 Page 699 |

|

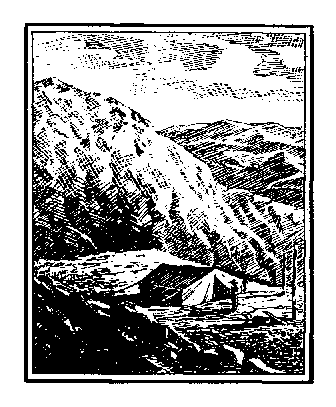 Une autre ligne de chemin de fer dessert, sur plus de
cent kilomètres, et parallèlement à la sierra, de riches contrées irriguées et
plantées de canne à sucre. De très nombreuses et importantes sucreries y sont
installées, voisinant avec de somptueuses demeures. Le rail traverse de
nombreux torrents descendant des Andes. C'est par le lit d'un de ces torrents :
le rio Seco, que la voie enjambe à soixante-cinq kilomètres de Tucuman, que
nous avons pu gagner les épaisses forêts qui recouvrent la région montagneuse
jusqu'à près de trois mille mètres d'altitude.
Une autre ligne de chemin de fer dessert, sur plus de
cent kilomètres, et parallèlement à la sierra, de riches contrées irriguées et
plantées de canne à sucre. De très nombreuses et importantes sucreries y sont
installées, voisinant avec de somptueuses demeures. Le rail traverse de
nombreux torrents descendant des Andes. C'est par le lit d'un de ces torrents :
le rio Seco, que la voie enjambe à soixante-cinq kilomètres de Tucuman, que
nous avons pu gagner les épaisses forêts qui recouvrent la région montagneuse
jusqu'à près de trois mille mètres d'altitude.