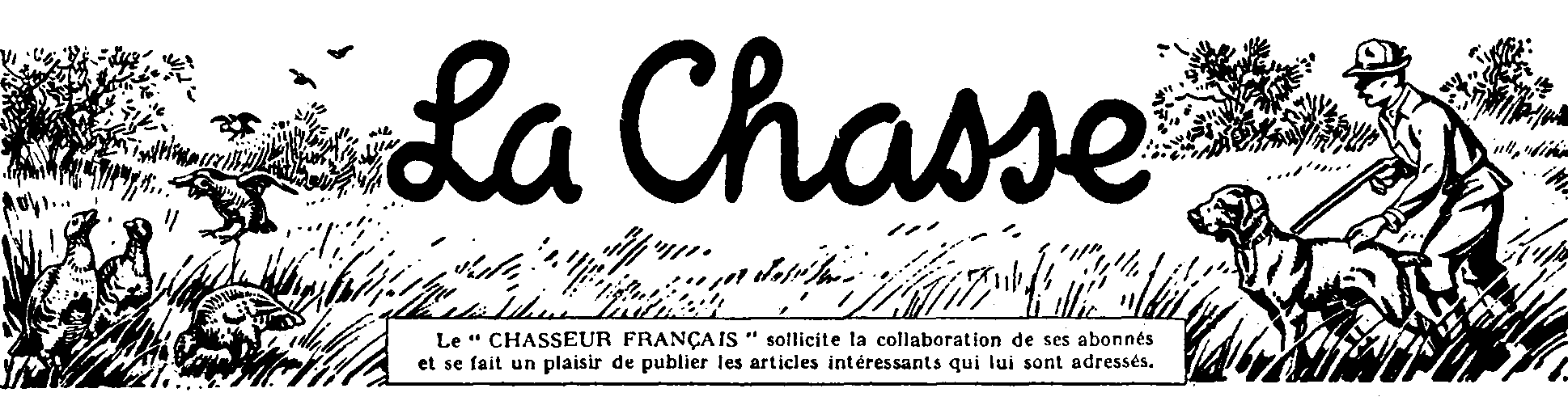| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°597 Mars 1940 > Page 129 | Tous droits réservés |
Science et chasse
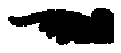
|
Densités limites du gibier |
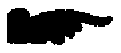
|
|
Un lecteur du Chasseur Français nous interroge sur la question de la densité limite à laisser, en fin de saison, sur un terrain de chasse, de manière à assurer une bonne reproduction pour l’année suivante, sans que l’on ait à craindre éventuellement des dégâts de culture. La chose vaut, en effet, la peine d’être discutée, étant donné que, pour le lapin, et c’est précisément ce qui intéresse particulièrement notre correspondant, l’année 1939 ne paraît pas, tout au moins dans le centre de la France, avoir tenu les promesses du printemps. Nous examinerons donc successivement la question de la densité théorique maximum et celle des procédés de destruction qui permettent le mieux d’apprécier en fin de saison ladite densité, car il est inutile de se fixer un chiffre abstrait, même après avoir mûrement réfléchi à son importance, si nous sommes, d’autre part, incapables d’appliquer avec certitude notre théorie. En ce qui concerne le lapin de garenne, il est courant d’entendre les experts émettre, en cas de dégâts, les opinions les plus divergentes sur le nombre d’individus ayant commis lesdits dégâts. En réalité, nous avons acquis la conviction que de telles opinions pêchent toujours beaucoup plus par excès que par défaut, et que, quand les cultures sont mal placées et mal défendues, il suffit de très peu de rongeurs pour commettre des délits très importants. Dans une propriété bien administrée et dans laquelle les espaces cultivés sont convenablement répartis par rapport aux parties boisées ou incultes, on arrive facilement à une assez grosse densité de gibier sans compromettre les cultures. Il est courant, en Sologne, par exemple, que, dans un domaine de 500 hectares dont 200 à 250 en culture en deux ou trois fermes, on puisse, chaque année, retirer 3.000 à 4.000 lapins par la bourse ou le fusil, en laissant la graine pour l’année suivante, sans avoir autre chose que des dégâts insignifiants. Mais, pour arriver à ce résultat, il convient de connaître son terrain, d’éliminer des terres cultivables certaines parcelles mal placées et indéfendables contre la dent du rongeur, et de posséder les six ou huit mille mètres de grillages indispensables. Et encore faudra-t-il effectuer, au bon moment, les destructions nécessaires et ne pas attendre, pour faire un fermé, que les dégâts soient par trop apparents au voisinage immédiat. Le choix du procédé de destruction n’est pas non plus indifférent : on se trompe grossièrement sur la densité réelle du lapin dans un bois ou dans une bruyère, en y pratiquant une battue rapide et un peu large. Pour peu que le gibier ait l’expérience de ces sortes d’expéditions, il saura parfaitement se dissimuler, glisser dans les pièces voisines et éviter le tableau. Nous avons vu assez souvent des battues en hautes bruyères pouvoir être recommencées trois fois, sans interruption, dans des sens divers, et avec des résultats équivalents. Lorsqu’il s’agit de tir, et non de destruction, on voit bien ce que l’on tue, mais on ne sait jamais ce qui reste au terrier ; s’il s’agit, au contraire, d’une opération faite pour protéger les récoltes voisines, il est indispensable de fureter dès la fin d’une battue répétée au moins deux fois et d’y mettre le temps nécessaire. C’est le seul procédé certain pour ne laisser à peu près rien au voisinage des céréales, pendant la période de sensibilité aux dégâts. Après l’hiver, les couverts se repeupleront petit à petit de reproducteurs provenant des parties du domaine où l’on aura pu laisser une densité plus importante en raison de l’absence de culture dans le voisinage immédiat. Tout ceci est une question d’équilibre. On voit donc qu’il est assez difficile de fixer un chiffre absolu pour la densité limite à l’hectare : cette densité, sur une même propriété, dépendant de la situation de l’hectare dans l’ensemble du domaine. Nous pensons qu’il vaut mieux considérer le domaine en bloc et se fier à l’expérience, en arrêtant, chaque année, la destruction lorsque le tableau type est réalisé. Dans une année franchement médiocre, peut-être pourra-t-on mettre un peu plus tôt fin aux prélèvements, si les dégâts n’apparaissent pas trop sérieux, et ne pas essayer, dans ce cas, d’atteindre la moyenne. Quant à l’année favorable, nous la reconnaîtrons de suite en comparant les résultats mensuels ; par sagesse, arrêtons-nous au voisinage de nos moyennes basées sur l’expérience. En opérant à temps les destructions nécessaires à la protection de la culture et en surveillant attentivement les céréales pendant l’hiver, on sera assuré d’avoir tiré le maximum du rendement de la chasse. Vouloir aller au delà du tableau ainsi obtenu serait courir le risque de dégâts sérieux. En ce qui concerne l’an dernier, la plupart des chasseurs s’accordent à déclarer le lapin peu abondant, tout au moins dans le centre de la France. Nous nous demandons si cette impression ne résulte pas précisément de l’insuffisance des moyens employés : chiens, gardes et rabatteurs déficitaires, temps limité pour tous les usagers, jours fixés à l’avance. La sagesse consiste, en ce cas, à régler définitivement, en mars, le sort de la population, et cela, d’après les dégâts qui apparaîtront ou n’apparaîtront pas à ce moment. Et moyennant quoi, nous aurons encore quelques cartouches à brûler l’an prochain. Lapin à part, le faisan a pu faire quelques dégâts cette année, étant donné qu’il était très abondant. En fin de saison il a été permis, dans quelques départements, de disposer des coqs repris à la mue, l’usage du fusil restant interdit pour leur destruction. Beaucoup de propriétaires n’ont pu assurer l’écoquetage faute de personnel et, sur certains domaines, il en résultera certainement une reproduction médiocre. Dans la plupart des cas, heureusement, la loi d’espacement rétablira l’équilibre au profit des voisins et, moins heureusement, les braconniers se chargeront du reste. Tout cela n’est pas pour désespérer outre mesure de l’ouverture de 1940, qui nous apportera, souhaitons-le, la Victoire, la Paix et les plaisirs de la Chasse. M. MARCHAND,Ingénieur E. C. P. |
|
|
Le Chasseur Français N°597 Mars 1940 Page 129 |
|