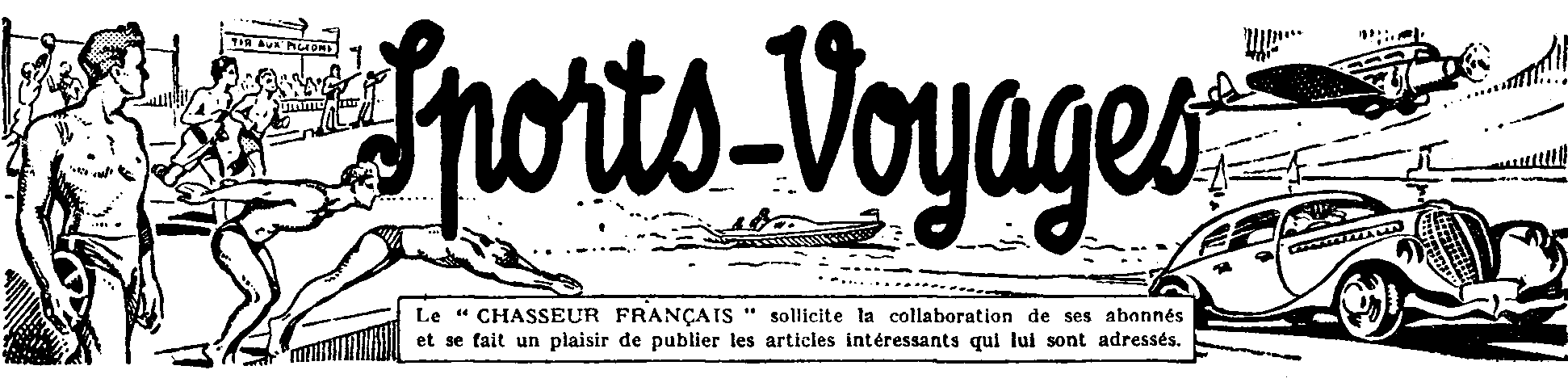| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°599 Mai 1940 > Page 279 | Tous droits réservés |

|
Adaptation bienfaisante |

|
|
À quelque chose malheur est bon, et cette guerre sera pour beaucoup de jeunes citadins l’occasion d’apprendre beaucoup de choses à la fois utiles et agréables pour leur bonheur et leur bien-être futur. Certes, du point de vue de leurs études, certains s’en trouveront gênés. Mais les diplômes et les titres ne constituent pas tout le charme de la vie, et d’ailleurs, plus on en possède, plus ils entraînent la nécessité d’occuper de façon intelligente et agréable les loisirs nécessaires après une longue concentration de l’esprit. Or il est frappant — et désolant — de constater combien de jeunes citadins — et même des gens d’âge mûr — sont désemparés et gauches, dès que leurs pieds ont quitté l’asphalte et que ne s’offrent plus à leurs yeux, à chaque coin de rue, un passage clouté ou une luxueuse vitrine. On a dit souvent que les provinciaux, qui « montent » à Paris, s’adaptent très vite et que, généralement, ils y réussissent, dans presque toutes les professions, grâce au vieux bon sens qui est le propre des gens de la terre. Et sans vouloir faire de peine à nos Parisiens (mais combien de ceux-ci ont des origines rurales dont ils restent fiers), ils sont, en vacances, tout aussi hésitants lorsqu’il s’agit de distinguer un navet d’une betterave, qu’une vieille femme de la campagne lorsqu’il s’agit de traverser la place de l’Étoile ou le carrefour de Châteaudun ! Tous d’ailleurs, et qui que nous soyons, il nous faut des catastrophes pour nous faire réaliser de petites, de modestes vérités que nous comprenons mal, soit que, par parti pris, nous évitions de nous les poser, soit parce qu’elles nous semblent si banales que nous ne prenons pas la peine de les envisager. Car, pour l’homme moderne, il est bien entendu que vivre près de la nature et de la petite vie quotidienne de nos ancêtres, c’est perdre son temps. Or, pour lui, hélas ! depuis vingt ans surtout, time is money. Comme s’il ne perdait pas chaque jour du temps en s’agitant pour rien. Comme s’il suffisait de s’agiter pour agir. Depuis quelques années, l’on a compris le danger. Des hygiénistes, des démographes, des poètes, les pouvoirs publics eux-mêmes, ont, sans grand succès, prêché les bienfaits du grand air et les charmes et les profits de la campagne. La guerre, par l’évacuation forcée des villes au profit de nos provinces, a, en quelques jours, réalisé ce qu’ils n’eussent jamais obtenu. Il ne sera que salutaire aux petits Parisiens d’avoir remplacé, cette année, les après-midi au cinéma ou assis dans une tribune pour regarder un match de football, par des dimanches et des jeudis de grand air et d’exercice si simple, soit-il, ne serait-ce qu’une marche dans les bois qu’ils auront accompli au lieu d’en être les spectateurs. Quant aux habitants de la campagne eux-mêmes, ils ne se lamenteront plus sur leur sort, sur l’élégance moindre de leurs chaussures, ou sur la rareté des théâtres, depuis que les citadins partagent leur vie. Car ceux-ci, depuis qu’ils sont « pour de bon » à la campagne, ne jouent plus au gentilhomme étalant son calicot frais parmi les sabots, et certaines pécores, bêtes à manger du foin, ne se lamentent plus devant les yeux écarquillés des petites filles du village, de ne pouvoir se passer de l’atmosphère intellectuelle de Paris. Les unes et les autres semblent s’accommoder fort bien de cette vie nouvelle et jouent à tout autre chose qu’à épater les populations qui les accueillent d’ailleurs fort aimablement, avec la simplicité naturelle aux terriens. Tous les âges et toutes les classes, d’ailleurs, profitent de ces vacances forcées. D’abord les non mobilisés citadins que la guerre, de gré ou de force, a fait sortir de leurs appartements, pour les disperser à la campagne. Il y a même les mobilisés, dont (souvenons-nous de 1914-18) beaucoup ne se seront jamais si bien portés, parce que jamais ils n’auront si pleinement vécu la vie des champs et des bois. Ils reviendront en maugréant contre les chemins glissants de boue, les nuits opaques et les soirées sans orchestre, mais la plupart auront découvert les splendeurs de la forêt en automne, les sourires du printemps. Quelques-uns, certes, auront vu pour la première fois de leur vie un lever de soleil et constaté que cela vaut bien une visite à la foire aux « navets ». (Pas ceux de Touraine, ceux que les artistes exposent à Montparnasse.) Mais pensons surtout aux enfants, aux jeunes, qui vont avoir enfin le loisir de s’adapter au plein air et aux charmes du terroir. Lorsqu’ils n’y allaient qu’en vacances et à la plus belle saison, ils ne faisaient qu’y passer, et n’en retenaient guère que le film déroulé sous leurs yeux à cent à l’heure, ne s’occupant que d’eux-mêmes et de leur plaisir de détente. C’est en vivant pendant des mois la vie rurale qu’ils auront le temps et l’occasion de regarder autour d’eux les choses et les gens, de constater que l’érudition et la vivacité d’esprit du citadin n’est pas la seule forme de l’intelligence, et que tels cultivateurs qu’ils prenaient pour des lourdauds sont, en réalité, des êtres pleins de bon sens et d’expérience. Moins certains au fond d’eux-mêmes, après ce contact, de constituer des êtres supérieurs par principe, ils verront que la campagne possède, elle aussi, une élite. Le retour à l’amour de la nature y retrouvera, espérons-le, sa place, et aussi un sens plus pratique, une économie mieux comprise. L’exode rapide de septembre, les matelas, les voitures d’enfants et les cages à serins entassés sur le toit des conduites intérieures, ont démontré que les vastes agglomérations urbaines sont un non-sens depuis les formes nouvelles de la guerre. Les grosses bombes auront eu quelque chose d’utile si elles nous forcent à comprendre que notre besoin d’air, que notre « espace vital » consiste à laisser autour de nos poumons des espaces libres, et que l’homme n’est pas fait, comme le sont les pierres de taille, pour s’entasser les uns contre les autres, sous un château de dominos de vingt-cinq étages. La formation sportive d’une jeunesse, et son mieux-être, découlent tout naturellement de ce séjour prolongé au grand air et de ce contact avec la nature. Et puis, d’une façon plus générale, n’est-il pas désirable que tous les Français aient un peu vécu dans cette douce ambiance de nos vieilles provinces, qui, au fond, bien mieux que l’horizon limité d’un boulevard bordé de gratte-ciels, représente le vrai visage de la France. J. ROBERT. |
|
|
Le Chasseur Français N°599 Mai 1940 Page 279 |
|