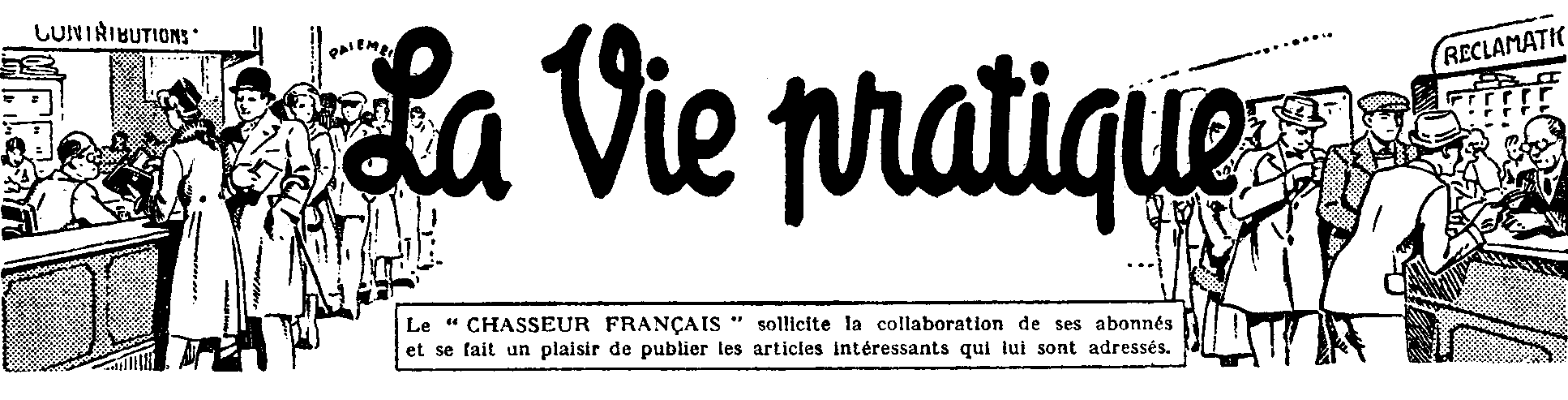| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°602 Octobre 1941 > Page 500 | Tous droits réservés |
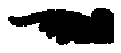
|
Causerie médicale |
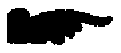
|
La couperose.
|
Parmi les dermatoses inesthétiques qui peuvent désoler une femme tant soit peu coquette, la couperose est une des plus affligeantes et j’ai été bien souvent sollicité de lui consacrer une de mes causeries. Rien de désolant, en effet, comme cette rougeur, d’abord passagère, mais qui finit par s’installer d’une façon définitive et permanente à l’extrémité du nez, sur les pommettes, plus rarement sur les joues ou le menton. On en décrit différents degrés qui ne se succèdent pas inévitablement, depuis la simple rougeur fugace jusqu’aux difformités quasi monstrueuses. Voici ordinairement comment les choses se passent : l’affection frappe plus souvent une femme, vers la trentaine; tout d’abord elle voit son nez et ses pommettes rougir à la suite d’un repas ou d’une émotion, puis, à son grand désespoir, cette rougeur persiste dans l’intervalle des accès, tout d’abord la peau prend une teinte rougeâtre qui paraît uniforme, mais, si on l’examine à la loupe, on voit se dessiner des arborisations qui ne sont autre chose que les vaisseaux capillaires de la peau, dilatés et parfois variqueux. Cette congestion de la peau réagit sur les glandes sébacées, qui exagèrent leur fonctionnement, sécrètent plus de substance grasse, et la face, ou tout au moins la région hyperémiée, devient huileuse ; il arrive parfois que cette sécrétion, trop abondante, se dessèche, forme de fines croûtelles qui prennent un aspect eczémateux. Ordinairement, les pores de ces glandes sont largement dilatés, ils ne sont pas bouchés par des points noirs, des comédons, comme dans l’acné juvénile, mais il peut arriver que l’hypertrophie des glandes devienne considérable, qu’elles forment de véritables boursouflures « entre cuir et chair ». Chez la femme, cela se produit parfois au menton ; les grosses difformités du nez, qui donnent à cet organe les formes les plus diverses et les plus monstrueuses, sont, au contraire, l’apanage du sexe masculin. Quelles sont les causes de cette déplaisante affection ? L’opinion vulgaire — et c’est bien là une des raisons qui désolent le plus les femmes — est que la rougeur du nez est un signe d’intempérance, d’abus de vin et de boissons alcooliques. Or, si l’abus, et non l’usage modéré, des boissons spiritueuses peut être quelquefois invoqué, principalement chez l’homme, comme cause de couperose, cette étiologie ne se rencontre que très rarement chez la femme, et il n’est pas rare de voir des abstinentes totales en être frappées et considérer cette difformité comme une réelle injustice du sort. Mettons de côté quelques causes secondaires, comme la vie au grand air (l’affection est plus fréquente chez les campagnards que chez les citadins), le climat humide, la trop fréquente transition du froid au chaud, la sensibilité des extrémités au froid, causes parmi lesquelles il faudrait encore faire place à l’hérédité, car il semble bien que, pour faire de la couperose, il faille posséder des vaisseaux capillaires particulièrement fragiles, et revenons à notre définition du début. Nous avons dit que l’affection se manifestait au début, d’une façon passagère, à la suite d’un repas ou d’une émotion ; cela nous donne immédiatement à penser qu’il faut chercher une origine digestive ou nerveuse, deux choses qui s’intriquent ordinairement. On a aussi incriminé, chez la femme, un trouble des sécrétions ovariennes, qu’on trouve souvent à l’examen ; il est même à remarquer que, dans ces cas, l’affection se localise plutôt au menton qu’au nez, aux pommettes ou aux joues. Malheureusement, les traitements opothérapiques qui semblent alors indiqués, n’ont qu’une bien faible action sur les lésions cutanées. La vaso-dilatation locale est incontestablement sous l’influence du système nerveux, la rougeur émotive qui survient surtout chez les jeunes filles en est une preuve convaincante, aussi doit-on chercher, par des médications appropriées, par une hygiène bien comprise, à rétablir l’équilibre nerveux. Il faut aussi envisager la possibilité, qui est loin d’être purement théorique, où les fibres nerveuses ou leurs centres d’origine sont intoxiqués par certains produits anormaux de la digestion, et ceci nous ramène à l’examen des fonctions digestives. Presque toujours, à l’examen superficiel, on trouvera la ptose de l’estomac et, si l’on pousse plus loin cet examen, on relèvera des signes d’insuffisance gastrique, déficit de pepsine et d’acide chlorhydrique aussi, même en l’absence d’une étude complète du chimisme, est-il le plus souvent indiqué de prescrire une solution acide de pepsine, à prendre avant les repas. On sait qu’au cours de la digestion, les albumines se dégradent en un certain nombre de substances plus simples, qui sont absorbées et au moyen desquelles l’organisme reconstitue ses albumines spécifiques ; ce sont les acides aminés. Or, parmi ceux-ci, il en est, comme l’histamine, qui ont la propriété de causer la vaso-dilatation des petits vaisseaux, lorsqu’on injecte cette substance sous la peau (cela se fait dans certaines formes de rhumatisme chronique). On remarque, en effet, que la piqûre est presque toujours suivie d’une rougeur passagère de la face. Conclure de là que l’histamine se trouve mal neutralisée chez certains sujets n’est qu’une hypothèse, mais qui peut conduire à une thérapeutique utile comme pour l’urticaire pour laquelle on soupçonne un mécanisme analogue. Et l’on a obtenu de bons résultats en prescrivant des peptones polyvalentes (obtenues avec des aliments divers), trois quarts d’heure avant les repas ; ces produits existent en pharmacie spécialisée sous diverses formes (cachets, comprimés, liquide). Il va sans dire que le régime doit être minutieusement surveillé, sans cependant tomber dans l’excès ; on supprimera chez le couperosique les aliments susceptibles de fermenter, les salaisons, les conserves, certains légumes comme les choux, mais on se guidera surtout sur les susceptibilités individuelles, le pain ne sera consommé que rassis, en quantité modérée, et l’on attachera une importance majeure à ce que les aliments soient bien mastiqués. L’alcool sera proscrit sous toutes ses formes, sauf sous celle de vin, en quantité très modérée. On veillera à éviter la constipation, sans lui attacher une importance exagérée, et l’on s’efforcera également de rétablir les fonctions génitales, surtout chez la femme. Après ces prescriptions, dont l’importance est primordiale, il faut envisager le traitement local, celui pour lequel on vient toujours consulter, car les malades s’imaginent toujours qu’il suffit d’une pommade pour guérir une affection de la peau. Il est en général inutile de leur prescrire des préparations à base d’hamamelis, d’hydrastis, etc., car elles n’ont pas manqué de les utiliser déjà sur les conseils de leur journal de modes. Ces topiques peuvent être d’utiles adjuvants, le cas échéant, mais le médicament le plus utile est le soufre, médicament type de la séborrhée et nous avons vu que la vasodilatation faciale s’accompagnait toujours d’une sécrétion exagérée des glandes sébacées. On l’emploiera sous forme de crèmes, de lotions pendant la nuit, sous forme de poudre pendant la journée. Les formules varieront selon la sensibilité particulière de chaque peau. Le traitement esthétique peut aller plus loin et oblitérer les vaisseaux dilatés, les scarifications superficielles, l’application d’acide carbonique solide à l’état de neige sont à peu près abandonnés et la ponction des petits vaisseaux variqueux à l’aiguille diathermique donne les meilleurs résultats sans cicatrices plus disgracieuses que l’affection elle-même, mais ce traitement ne peut être appliqué que par un spécialiste compétent et entraîné. Les rayons X trouvent parfois leur application dans les formes indurées, et les grosses difformités sont justiciables de la chirurgie esthétique qui a fait de si notables progrès depuis quelques années. THÉOPHRASTE. |
|
|
Le Chasseur Français N°602 Octobre 1941 Page 500 |
|