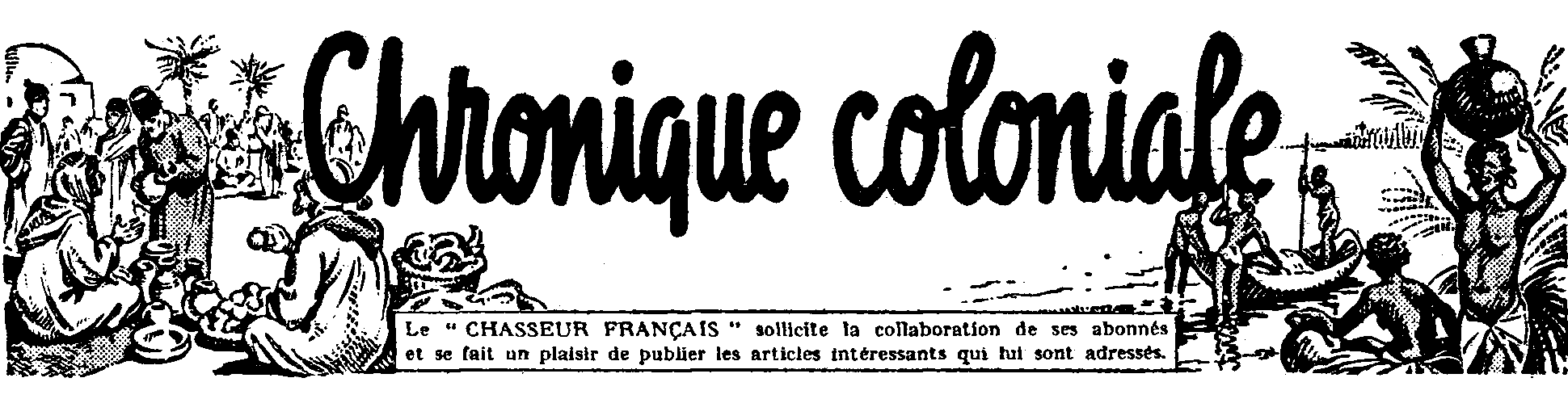| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°602 Octobre 1941 > Page 504 | Tous droits réservés |

|
A. O. F. 1939 |

|
La Côte d’Ivoire.
|
Rendons-nous donc en Indénié, déplacement facile et instructif. D’Abijan, une belle voie en direction nord, se dirige sur Adzopé, bien entretenue : on la nomme à juste titre « la route de la Banane », car elle fut construite au moment où la culture de cette plante prit de l’extension. Les bananeraies s’étendent aussi le long ou près de la route jusqu’à Adzopé (au km. 1, à 1km,500 de la route, bananes et ananas, non loin la plantation Saint-Georges, etc.) ; en tout, dans cette seule circonscription, dix millions de bananiers, des kolatiers. À noter qu’une partie des fruits exportés est fournie par la bananeraie de Niécky, exploitée sous forme coopérative. C’est seulement au delà d’Adzopé — on pénètre alors dans l’Indénié— que le cacao devient la richesse des villages qui, il y a vingt-cinq ans, étaient lamentables avec leurs habitants si miséreux. S’il y a de grandes et superbes plantations européennes, c’est surtout, et il faut s’en féliciter, au paysan noir, petit propriétaire de l’Agnéby, de l’Indénié et du bord inférieur du Baudama (qui se jette dans la mer à Grand Lahou), que le cacao a apporté le bien-être. Au poste de d’Abengourou, — le centre principal, — il est impossible, à vingt ans de distance, de reconnaître quoi que ce soit dans l’état des lieux : des cases propres et confortables, des indigènes sous la direction d’un chef puissant qui va recruter, dit-il, des travailleurs chez les sauvages du Mossi, des succursales nombreuses, des firmes européennes établies, d’où un trafic considérable qui donne au pays, à l’époque de la « traite », un mouvement intensif et des plus suggestif. Telle est l’impression ressentie et qu’a traduite à son tour récemment le professeur E.-M. Perrot dans son livre substantiel : Où en est l’Afrique Occidentale Française ? (Larose, éd., Paris). Au moment de la traite, le cacao est rassemblé dans les centres d’achat. Lorsqu’ils sont trop éloignés, les indigènes apportent leur récolte sur le bord de la route où ils attendent paisiblement le passage des camions des factoreries. Aux premières lueurs du jour, avant même, ceux-ci sont partis à vive allure pour ne rentrer de leur randonnée que le soir avec des chargements qui « sont souvent un défi au bon sens ». Certes, ils font quelquefois un tour dans le fossé ou une halte plutôt brusque contre un des arbres de la route ... Incident négligeable, ils repartent tant bien que mal. Spectacle journalier : un camion prend un virage avec une si parfaite désinvolture qu’il égrène son chargement sur plus de deux cents mètres. Naturellement, les sacs sont essaimés sur les à-côtés de la route et, comme ils sont généralement surmontés d’une véritable cargaison humaine, sans souci de surcharge pour les moteurs, on assiste à une salade de jambes, de pagnes aux vives couleurs, de calebasses, de poulets ficelés par quatre, de baluchons invraisemblables, de mioches qui piaillent. Qu’on se rassure, personne n’a de mal, rien de cassé, le « noir est en caoutchouc », comme on dit couramment à la Côte. Mais dépêchons-nous d’opérer le rechargement des sacs et des colis en chair et en os. Car c’est à celui des acheteurs indigènes, souvent possesseurs de leur voiture, opérant pour les « maisons », qui rentrera, la journée terminée, avec la plus forte quantité de produits. Pendant douze heures consécutives (le jour ne dure que douze heures), l’acheteur draine tout un secteur, fouillant les centres d’achat, les villages, « s’arrêtant d’un coup de frein brusque, lorsqu’au bord de la route il aperçoit un indigène accroupi auprès de quelques sacs ». Non sans grands cris et avec de grands gestes, on discute âprement, mais dans le minimum de temps, ce qui est rare en pays noir, car il faut repartir au plus vite, afin de ne pas se laisser rejoindre par un concurrent qui déjà vous talonne. « Le pays tout entier est travaillé par la fièvre des « opérations », des rivalités naissent; l’astuce, la « débrouille » sont maîtres ; les énergies sont décuplées. » C’est la traite. Quelle activité ! Angoulvant avait raison : En Afrique noire, l’ordre impératif seul vaut. Plus au sud, venant de Grand-Bassam, une bonne route aboutit à Adiaké, sur la lagune Aby, sur les rives de laquelle, plus au nord, des plantations importantes de cacao, mais aussi de café. La culture en grand, par les Européens et par les indigènes, du café est de date plus récente. Je dis en grand, car il n’existait guère qu’une plantation assez importante, créée en 1881, à Élima, au nord d’Assien sur la lagune Aby, et que, bien qu’ils connussent depuis longtemps le caféier, les indigènes en produisaient peu. Ce café est de la sorte dite du Libéria qui dut, il y a quelque dix ans, céder la place à des espèces plus fines, plus marchandes. C’est en 1931 que commença l’extension des champs de café qui, en maintes régions de la Côte d’Ivoire, trouvait des conditions convenables de développement considérable. Dans son remarquable ouvrage cité plus haut, le professeur Perrot, après une minutieuse inspection sur place, n’hésite pas à écrire : « Il n’est pas téméraire de songer que près de la moitié du café consommé en France sortira un jour de la Côte d’Ivoire et que le reste proviendra de Madagascar, d’Indochine, des Établissements de l’Océanie, et, pour les plus fins, de l’Amérique et de l’Arabie ». Rendons-nous donc d’Abengourou à Gagnoa, « la capitale du café », par Agboville et Tiassalé. D’Agboville à Tiassalé, nombreuses plantations indigènes, quelques concessions européennes où l’on trouve encore du cacao, mais où le caféier domine. Gagnoa est une région de vastes cultures, caféiers et cacaoyers. On doit y établir une station centrale d’expérimentation du café. De nombreuses variétés, qui ont chacune leur protagoniste, sont cultivées, de sorte qu’il n’y a pas commercialement un café Côte d’Ivoire, c’est-à-dire, par exemple, un café Robusta Côte d’Ivoire, un « Indénié Côte d’Ivoire » correspondant à des sortes Robusta, Indénié, Excelsa, etc., dont on peut déjà établir les normes. L’indication des dénominations d’origine s’imposera d’elle-même et le tout devra finir par être revêtu d’un label officiel en accord avec les chambres de commerce, comme cela se fait ailleurs depuis longtemps pour certains produits. Quelles que soient les préférences personnelles des planteurs pour telle ou telle sorte, l’avenir cultural du café en Côte d’Ivoire est certain, celui de son extension commerciale également avec un peu d’organisation pour l’homogénéité dans la production. Les choses se tasseront. Le café de la Côte d’Ivoire sera connu sur le marché. (À suivre.) G. FRANÇOIS.(1) Voir no 601 de septembre 1941. |
|
|
Le Chasseur Français N°602 Octobre 1941 Page 504 |
|