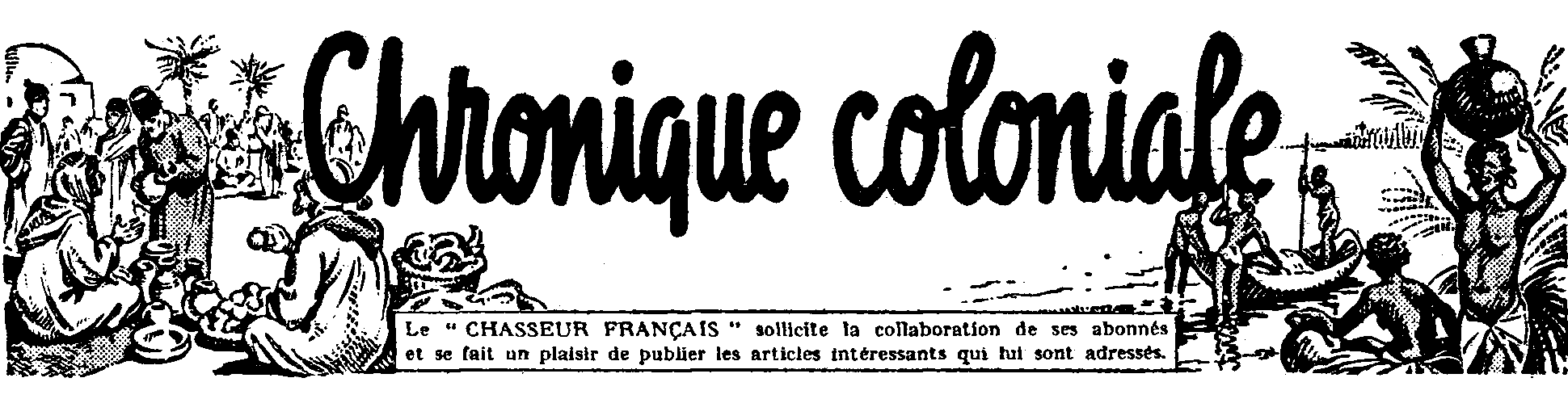| Accueil > Années 1940 et 1941 > N°604 Décembre 1941 > Page 631 | Tous droits réservés |

|
|

|
Le boa est-il comestible ?
|
— À ce sujet, que les lecteurs du Chasseur Français me permettent de narrer ici un épisode de ma vie de broussard. Ceci se passait au début de l’année 1912, dans un poste du secteur de la Haute-Sangha. Nous étions là une dizaine d’agents de la Compagnie forestière Sangha-Oubangui, gérants de factorerie, magasiniers, comptables, mécaniciens, et mariniers fluviaux. Vers la fin d’une lourde après-midi, un samedi, arriva, dans la cour du poste, un groupe de Noirs portant enroulé sur une perche un boa de poids et de taille respectable. Le corps du reptile fut allongé sur le sol de la cour, à l’ombre des palétuviers et des arbres à pain. De toutes les cases, magasins et bureaux, sortirent des curieux avides d’informations et prodigues d’appréciations. Après avoir amplement discuté et impressionné quelques pellicules de kodak, chacun s’en retourna à son travail. On oublia le boa. Nous devions le revoir cependant, mais dans quelles circonstances ! Le lendemain, un dimanche donc, la cloche du repas de midi nous réunit tous dans la salle à manger de la case-popote. Aucun de nous ne prit garde au fin sourire un peu narquois du gérant du mess qui nous accueillait sur le seuil. Le repas commença dans la sereine atmosphère d’un jour de détente dominicale. Les serviteurs noirs faisaient leur service correctement, quand on apporta un grand plat sur lequel apparaissait bien alignées des nombreuses tranches de ce qui nous parut être un beau poisson cuit au court-bouillon qu’accompagnait une copieuse sauce mayonnaise passablement relevée, à la mode indigène. Je me trouvais à peu près aux deux tiers de la table et, quand le plat arriva à ma hauteur, je me servis une belle tranche, et une bonne part de sauce piquante et commençai à manger. Jusque-là rien de suspect ; les serveurs continuant leur travail avaient contourné la table, quand mon boy personnel, de service de table ce jour-là, se trouva face à moi. Je crus alors remarquer dans ses yeux un imperceptible signal de son regard visant mon assiette, je lui demandai en benguala ce qu’était ce plat, il me répondit : « N’goo ». Or, en benguala, n’goo, c’est le serpent. La table entière avait compris ; l’effet fut instantané et, malgré le 50° à t’ombre, nous restâmes figés. Chacun se souvint du boa ! Nous avions mangé le boa. Les visages rougirent, pâlirent, verdirent. Certains se dirigèrent vers leur chambre, d’autres vers des endroits plus discrets. Le gérant lui-même s’était éclipsé. Craignait-il une semonce ? Il revint bientôt cependant, suivi d’un boy porteur de plusieurs bouteilles casquées d’argent ; soit qu’il voulût atténuer les effets de sa galéjade ou aider à une digestion qu’il pensait difficile, il nous offrait le champagne ! Précaution inutile et stérile, la salle à manger était vide. Pour ce qui me concernait, je regagnai ma case et ordonnai à mon boy de me préparer une tasse de thé à laquelle j’ajoutai une rasade da rhum, et me glissai sous la moustiquaire. Je m’endormis illico. À mon réveil, il était plus de quatre heures. Le soleil était déjà loin, et le boa aussi. À part la première impression quelque peu désagréable, quoique imaginative, personne ne fut incommodé par cette ingestion quelque peu insolite. Arthur DUGAS. |
|
|
Le Chasseur Français N°604 Décembre 1941 Page 631 |
|