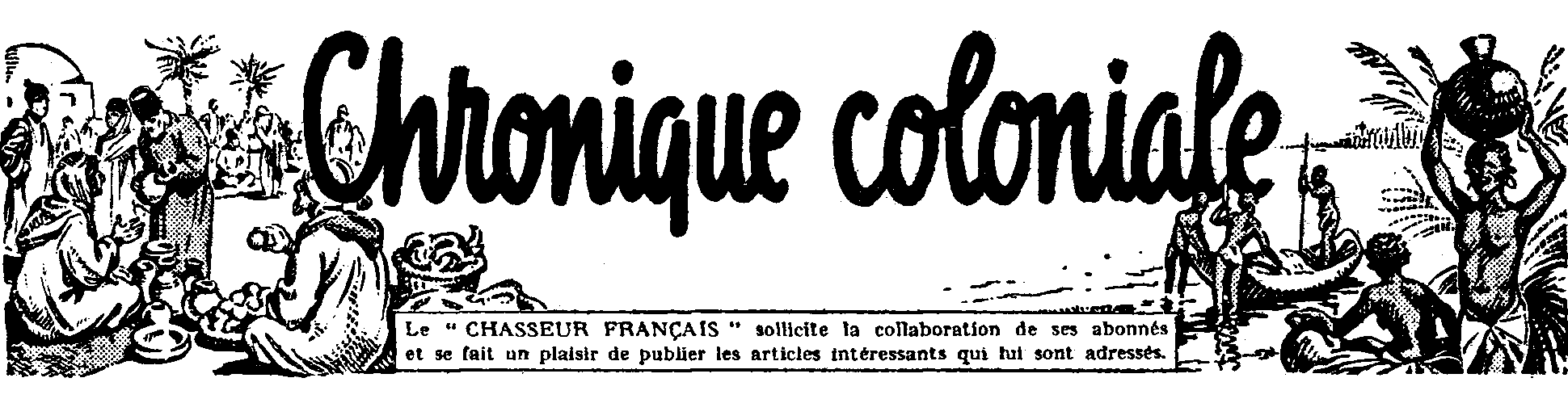| Accueil > Années 1942 à 1947 > N°605 Janvier 1942 > Page 55 | Tous droits réservés |

|
A. O. F. 1939 |

|
Conclusion.
|
Au terme de ce voyage dans les principales colonies de l’Afrique occidentale française, une conclusion s’impose : en une quarantaine d’années, la Fédération a fait, en tous ordres dans tous les domaines, des progrès surprenants, et elle ne s’arrêtera pas là, car l’élan est donné. Sa forte armature financière et économique l’a puissamment aidée. Au-dessus des budgets locaux de chaque colonie, qui conserve son autonomie, a été institué, en 1904, un budget général de l’A. O. F. alimenté par des droits à l’entrée et à la sortie sur les marchandises et les navires, contributions à vrai dire qui sont les plus productives, qui suivent les fluctuations de l’activité commerciale de l’ensemble, mais qui pourvoient aux dépenses d’intérêt général, spécialement aux grands travaux d’outillage économique. Ce budget général est le soutien du crédit de l’A. O. F. Ce que n’aurait pu entreprendre chaque colonie isolée, la Fédération l’a réalisé. L’union fait la force. Les finances fédérales sont quasi à l’abri des fluctuations, des moins-values qui peuvent mieux atteindre les ressources locales séparées. Le Sénégal n’a pas le même régime climatique que le Dahomey, le Soudan que la Côte-d’Ivoire. Qu’une mauvaise récolte d’arachides atteigne durement le Sénégal, pays de presque monoculture, il y a des chances que les palmiers à huile de la Côte-d’Ivoire et du Dahomey donnent une bonne production ou que les bananes guinéennes et le cacao éburnéen se présentent en d’excellentes conditions de réussite. Et réciproquement peut-on dire, car on peut légitimement penser qu’étant donnée la diversité des régions et des cultures il y aura compensation. Tout dépend en effet des exportations de ce que la douane appelle les produits du cru, de ce que les indigènes produisent, car ils n’achètent de marchandises européennes que dans la mesure où ils ont vendu leurs récoltes. Ils ont beau gagner, s’enrichir même, ils ne connaissent pas l’épargne maintenant encore : insouciants du lendemain, ils n’en saisissent pas l’avantage, ils ne la comprennent point, ne la pratiquent pas. L’exemple des planteurs indigènes de l’Indénié (cacao) est typique à cet égard. Même constatation s’il s’agit d’un petit cultivateur d’arachides, en général de tout paysan noir, à quelque tribu qu’il appartienne. Les ressources générales sont donc normalement à l’abri, le crédit est solidement assis. Vues de l’esprit, hypothèses optimistes ? Que non pas. Faits d’expérience acquise, une seule preuve : le gouvernement général de l’A. O. F. a dû, pour l’équipement de la Fédération (ports, chemins de fer, assistance médicale, etc.,), emprunter avec la garantie de l’État français des sommes assez considérables. L’A. O. F. n’a jamais fait appel à cette garantie, elle a toujours assuré elle-même, sur ses ressources propres, l’amortissement et les arrérages de ses emprunts. Bien mieux, elle a contribué par des crédits importants aux dépenses militaires effectuées sur ses territoires : il s’agit cependant bien là de dépenses impériales, des dépenses de souveraineté (et cette situation, soit dit en passant, n’est pas spéciale à l’A. O. F. ; Indochine, Madagascar sont dans le même cas). Il convient de souligner cette constatation. Trop de nos compatriotes ne s’en doutent même pas. Témoin cet ami. Français moyen, exerçant une profession libérale, à qui j’exposais tout ce qu’apportaient les colonies à la mère Patrie et qui, en toute bonne foi, me répondait ; « Oui, mais qu’est-ce que cela nous coûte ! » et il n’entendait pas le prix lui-même des marchandises, mais les frais d’administration. « Rien, lui répondis-je, bien au contraire, les colonies, l’A. O. F. en particulier, sont parmi nos meilleurs clients et nos meilleurs fournisseurs. » Chaque année qui passe consolide et élargit les échanges entre l’A. O. F. et la France. La métropole vendait naguère à l’A. O. F. pour près de 800 millions et lui achetait pour 1 milliard et demi de matières premières. Dans les échanges franco-coloniaux, l’A. O. F. arrivait en troisième ligne, après l’Algérie, suivant de près l’Indochine. Fait intéressant à noter, depuis quelques années s’établit un courant d’affaires qui va croissant entre l’A. O. F. et l’Afrique du Nord. Cette importance de l’apport de la Fédération à la France n’a rien qui puisse étonner lorsqu’on a saisi sur place l’activité qui règne, au moment de la traite sur les marchés d’arachides au Sénégal et du Soudan, quand on a vu les chargements réguliers, en Guinée, des bananes ; à la Côte-d’Ivoire, des bananes, du café, du cacao, des huiles et amandes de palme et les grosses quantités de bois ; au Dahomey, des huiles et des palmistes, pour ne parler que des principaux produits. C’est là un fret qui profite en grande partie à l’armement français. À côté de ces profits, il est encore d’autres qui, pour être moins visibles, n’en sont pas moins substantiels : les intérêts payés aux porteurs de titres des emprunts de la colonie, les dividendes touchés par les actionnaires des grandes sociétés commerciales et autres dont les capitaux investis se chiffrent par milliards. Si les Français retirent ces avantages de l’activité de l’A. O. F., les premiers bénéficiaires sont les indigènes, d’ailleurs les premiers artisans de base, puisque leur travail et ses résultats commandent le développement commercial. Aussi, en bien des régions, leur standard de vie s’est singulièrement élevé. La vie sociale s’est ressentie de cet état de choses. Le progrès marche vite en Afrique noire, progrès matériel, comme progrès moral. Éminemment captivante une visite aux écoles normales ou professionnelles, non moins attachante une inspection d’école primaire ou d’une école de brousse ! Symphonie encourageante en ce pays où la condition de la femme est inférieure et navrante, les filles commencent à venir dans nos écoles ; nous avons maintenant des institutrices, des sages-femmes indigènes, comme nous avons des aides-médecins et des infirmières. Cet apprivoisement, cette éducation des femmes seront d’un puissant secours pour l’évolution nécessaire de la société noire. Le mouvement est donné jusque dans les villages. La « tache d’huile » fera ici son œuvre. Il y a quarante ans, peu de choses en ce sens. Esquisses il y a vingt ans. Aujourd’hui, vaste programme en voie de réalisation. Il est à souhaiter que ce soient les écoles professionnelles et les écoles rurales avec rudiment d’agriculture qui retiennent l’attention des autorités. On avance à grands pas, et pas seulement dans ce domaine moral. La santé physique de nos pupilles a été de tout temps, dès le premier jour de notre venue, l’objet des préoccupations gouvernementales. Hôpitaux, maternités, dispensaires, tournées de vaccine ont été multipliés. Et comment ne pas rendre hommage au dévouement professionnel du Corps médical, médecins militaires et civils : ces derniers, attachés toute leur carrière à la colonie, portent le nom significatif de « médecins de l’assistance médicale indigène ». Des épidémies ont été jugulées, d’autres sont contenues et régressent. Ce n’était pas assez. Les crédits affectés à la Santé publique viennent de recevoir une forte augmentation. D’un recensement à l’autre, le chiffre de la population augmente (dernier chiffre : 14.700.000). Ce qui manque le plus à l’A. O. F., c’est la main-d’œuvre, et l’espace utilisable est immense. Nous commençons à récolter le fruit de nos efforts pour l’amélioration quantitative et qualitative de la race. Nos indigènes ne sont pas sans se rendre compte de l’action bienfaisante de notre méthode civilisatrice. Il reste encore beaucoup à faire, notamment pour le relèvement de la condition de la femme noire. Une missionnaire, Sœur Marie-Andrée du Sacré-Cœur, de l’ordre des Sœurs Blanches, docteur en droit, vient de la décrire en termes saisissants dans son ouvrage : La femme noire en Afrique occidentale (Payot, éditeur, Paris). Une femme missionnaire, ayant vécu en contact quotidien avec les indigènes, ayant pénétré dans les intérieurs familiaux, pouvait, grâce au privilège que lui valaient son sexe et son activité, être en situation de mener à bien une telle enquête sur un sujet de si primordiale importance au point de vue sociologique. C’est par la femme que nous ferons la conquête morale définitive de ces populations noires. Une société piétine tant que les femmes, conseillères des hommes, éducatrices des enfants, demeurent proches de l’animalité. Un premier pas légal a été fait, un projet de loi subordonne au consentement de la jeune fille la validité du mariage (on dispose d’elle comme d’une chose dans la coutume indigène) et assure à la veuve (elle fait partie de la succession) la libre disposition d’elle-même. Nombreuses sont les jeunes filles sorties de nos établissements d’instruction, donc évoluées, et qui doivent rester sous l’empire de coutumes qui font d’elles non une personne humaine, mais un objet de troc. Voit-on les jeunes noires chrétiennes ou catéchumènes (il y a 350.000 chrétiens noirs en A. O. F.), qui ont pris conscience de leur relèvement, — car, dans les communautés chrétiennes, la femme a une situation privilégiée, — retomber à leur asservissement ancestral ? Cette réglementation nouvelle peut produire des effets incalculables. Mais il faut la faire entrer progressivement dans les mœurs, tâche délicate que sauront remplir la compréhension et le dévouement de nos administrateurs coloniaux. C’est la nouvelle vie économique, substratum de la vie sociale, qui a permis et développé les résultats acquis. Cette nouvelle vie économique n’a été rendue possible que par l’équipement économique de la colonie : la création de ports : Dakar, grand port pourvu d’un outillage moderne, Conakry, bientôt Abidjan ; l’amélioration des rades, Sassandra, Cotonou, et par l’établissement de voies de communications à l’intérieur. Il y a trente ans, 300 kilomètres de chemins de fer, quelques routes. Aujourd’hui, 3.600 kilomètres de voies ferrées et 60.000 kilomètres de routes. Le plan ferroviaire conçu avec beaucoup de raison en 1904, avec une claire vision de l’avenir, a dessiné l’ossature générale. D’un point judicieusement choisi sur la côte, la locomotive s’élance dans l’arrière-pays, vers ou dans la boucle du Niger, ces divers tronçons pouvant ultérieurement être reliés entre eux par un transnigérien et se souder au transafricain. Ce réseau d’ensemble est en voie d’achèvement. Vient maintenant se poser le problème, en A. O. F. aussi, de la coordination du rail et de route, mais sur un tout autre plan qu’en France. En raison des progrès constants réalisés pour la traction automobile, les artères centrales des colonies étant desservies par les railways, ne convient-il pas maintenant de pousser plutôt la construction des routes ? L’A. O. F. n’a ni charbon ni carburant naturel, du moins présentement, sauf le bois. Mais le moteur à huile végétale est au point, le pays tout entier « sue l’huile », la question du carburant de synthèse en partant des matières grasses végétales est très poussée sur place. Avec les automobiles, on circule désormais partout. Les artérioles du système des communications doivent être automobiles, nos constructeurs ont depuis longtemps mis au point des voitures coloniales. Pour considérables que soient les progrès accomplis en un court laps de temps, il reste encore beaucoup à faire (hydraulique agricole déjà représentée par les magnifiques réalisations de l’Office du Niger, appareillage électrique, dans l’ordre matériel, amélioration de l’hygiène des noirs, lutte contre la mortalité infantile, relèvement de la condition de la femme). Ce sera l’œuvre de demain. Mais, dès à présent, c’est une œuvre immense, humanitaire et sociale, que nous avons menée à bien, notre action en A. O. F. nous fait le plus grand honneur : le loyalisme des populations en est la meilleure preuve, le bénéfice que nous en tirons pour notre économie nous paie des sacrifices financiers engagés. À huit jours de distance par mer (colonie tropicale la plus rapprochée de la Métropole), l’A. O. F., en plein dynamisme, poursuit sa marche vers de grandioses destinées. G. FRANÇOIS. |
|
|
Le Chasseur Français N°605 Janvier 1942 Page 55 |
|