| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°630 Août 1949 > Page 589 | Tous droits réservés |
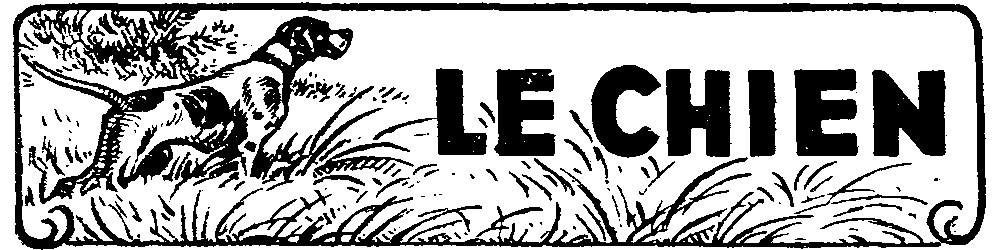
Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
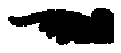
|
Le griffon nivernais |
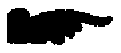
|
|
Il suffit qu’une race de chiens courants se trouve dispersée aux mains des chasseurs modestes, qu’elle ne soit représentée par aucun équipage important, pour passer pour disparue. Telle aventure advint il y a quelques lustres au griffon nivernais, que Pierre Mégnin considérait vers 1890 comme rayé du nombre des vivants. Cependant les lecteurs de cette revue pouvaient voir paraître de temps à autre, aux petites annonces, l’un où l’autre représentant de cette antique et précieuse race, proposé à vendre par un équarrisseur ou un boucher. La race menait une existence discrète dont seuls se doutaient les amateurs de chasse à tir du sanglier. Or, elle se maintenait en état d’homogénéité, qu’ici, en Bretagne, nous savions dès alors apprécier, plusieurs de ses représentants ayant été importés lors de l’invasion de sangliers de 1893, suivis peu après de l’arrivée des Vendéens-Nivernais de M. E. Costes. Ces superbes et excellents griffons prirent promptement la première place, bien qu’un peu importants pour chasser à tir. C’est pourquoi les véritables Nivernais sous leur robe grisâtre et feu pâle, mettons noir-Marengo et fauve, passèrent trop inaperçus. Leur formule, leur taille moyenne, la qualité et le courage dont ils faisaient preuve méritaient pourtant attention. Les grands Vendéens-Nivernais étaient excellents, je me plais à le répéter, mais vraiment un peu trop généreusement pourvus en taille. La consanguinité qui bientôt fit des siennes dans cette variété, représentée par un nombre trop restreint de familles différenciées, contribua, d’autre part, à leur disparition parmi nous — grand dommage sans doute, — mais demeurait toujours dans la province d’origine le substrat sur lequel l’édifice avait été bâti.
Les chiens exposés à Nevers au nombre d’une cinquantaine étaient en général tous typés. Cela est d’importance, car on en peut conclure à l’homogénéité du moral. Les critiques à formuler pouvaient plutôt s’adresser à certains détails de structure : pieds pas assez fermés chez certains, quelques dessus négligés chez d’autres et quelques fouets qui l’étaient aussi. Mais, je le répète avec plaisir, c’étaient les représentants de la même race et cela vaut mieux qu’une salade, même de chiens bien bâtis mais d’aspect hétérogène. Ma satisfaction a été complète lorsque j’ai observé les représentants de la variété dite de petite taille. Ceux-ci se trouvaient généralement être assez importants pour figurer dans la classe des grands et présentaient par surcroît des unités du meilleur type. Comme il n’y aurait aucun intérêt à hausser la taille du griffon nivernais, destiné aux risques de la chasse au sanglier, je vois la race s’unifiant autour d’une formule moyenne n’excédant pas de beaucoup 0m,56, réalisant ainsi un chien qui peut avoir grand train et assez leste pour éviter le massacre. Le Vendéen-Nivernais, dont la taille était celle des chiens de grande vénerie, payait un lourd tribut à l’adversaire, chaque fois que celui-ci réagissait. Un chien agile entre 0m,50 et 0m,56 est encore relativement à l’abri des mauvais coups, sans toutefois pouvoir prétendre à la sécurité plus complète du roquet de 0m,40. Mais à partir de 0m,60 et au delà, pour peu qu’un chien soit mordant, la casse est à prévoir. Ce n’est pas seulement pour le sanglier qu’un petit lot de Nivernais rendra les meilleurs services. J’ai vu ces chiens très bien chasser le chevreuil, le renard, bien entendu, et aussi la loutre. Beaucoup d’entre eux, comme feu le Vendéen-Nivernais, sont très friands de cette voie. Nos voisins de Grande-Bretagne ne font d’ailleurs aucun mystère des origines de leurs Otterhounds dans les veines desquels le sang nivernais coule largement. On a vu en France de ces Otterhounds importés, ne différant en rien de notre griffon. Tel auteur cynégétique anglais a pu dire justement leur identité. Sans doute l’Otterhound a été croisé avec le griffon Fauve, comme en témoignent certaines livrées rouge doré, et avec le Bloodhound au faciès caractéristique ; mais cela est exception. Dans les régions de bois et fourrés comme la mienne, les Nivernais m’ont semblé bien chasser le lièvre. Sur les chemins, moins à leur aise que Porcelaines et Artésiens ; mais, aussi bien, n’est-ce pas là leur spécialité. C’est l’auxiliaire désigné du chasseur rustique opérant en pays difficile avec peu de chiens, susceptible de s’attaquer à tout, à commencer par les animaux capables de réactions, lanceurs, débrouillards dans les embarras, sachant tout faire sans le secours de l’homme. Les « chiens gris », décrits au moral mieux qu’au physique par du Fouilloux, n’étaient autres que nos Nivernais, qui jamais ne vinrent de Palestine et pour cause, comme l’a démontré notre grand chartiste cynologue le commandant de Marolles. Ils appartiennent à la descendance de l’ancien Ségusien des mêmes régions, connu en France dès l’époque gallo-romaine et sans doute installé là en des temps encore plus reculés, donnant idée par leurs aptitudes et comportement de ce que pouvait être l’ancêtre destiné à l’attaque des animaux les plus divers, et même dangereux, qui alors peuplaient toute l’Europe. Ce moral a subsisté. Nous n’avons aucun courant plus mordant et courageux, plus capable de tenir le ferme avec ténacité soit seul ou en petite compagnie. C’est à sa forte individualité de chien demeuré près de la nature qu’il doit d’avoir conservé ces vertus, mais sans doute aussi de n’avoir pas l’esprit d’équipe aussi développé que le chien d’équipage. C’est sans doute pour le lui inspirer en quelque mesure que M. E. Costes eut recours à l’alliance du Foxhound « Archer ». Ceci n’est pas dit pour en conseiller l’expérience. Il ne faut pas toucher au moral de notre objet, surtout que tout semble annoncer la survivance de la chasse à tir, alors qu’hélas ! la vie des grands équipages est de plus en plus compromise. L’avenir est à la chasse à tir et celle qui se pratiquera avec les chiens courants, celle du sanglier en particulier, ne comportera pas de meutes importantes. Ce sera le règne du chien ayant tous les caractères moraux du griffon, un retour à la chasse de l’antiquité, le fusil moderne remplaçant les anciennes armes de jet. J’ai entendu à Nevers qu’on avait beaucoup détruit les sangliers et qu’il n’en restait guère, cela au moment où les chiens croissent en nombre et qualité. Surtout, qu’on ne prenne pas prétexte d’une éclipse momentanée du gibier pour opérer des croisements qui détruiraient l’œuvre entreprise. Les migrations de sangliers venant périodiquement du centre de l’Europe se produiront encore et il ne faut pas se trouver dépourvus de chiens propres à les chasser, comme cela s’est vu en 1893 et au temps de l’invasion de 1918. Lors de la dernière, qui a coïncidé avec la guerre, partout en France on s’est livré à des destructions inconsidérées qu’on déplore trop tardivement. Un jour viendra où les bois se repeupleront. En attendant, il faut conserver les chiens tels qu’ils sont et savoir, lors du retour de la gente sanglière, l’exploiter avec sagesse. R. DE KERMADEC. |
|
|
Le Chasseur Français N°630 Août 1949 Page 589 |
|
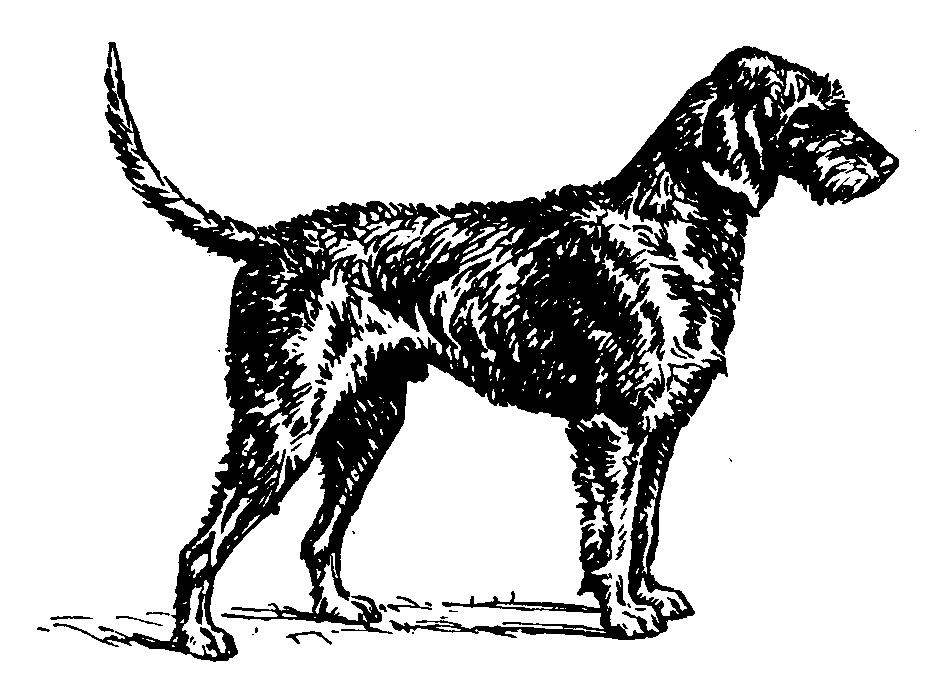 Il n’y a pas beaucoup plus d’un quart de siècle qu’un
groupe de sportsmen bien avisés ont entrepris et encouragé l’élevage, autrement
qu’au compte-gouttes, de l’antique race nivernaise. La réussite est complète
comme on pouvait l’espérer, vu l’ancienneté de la race, la méthode avec
laquelle il a été procédé, la pureté de nombreux éléments conservés chez les
chasseurs. Étant donné le travail spécial demandé à leurs chiens, ils n’avaient
eu, en effet, aucun intérêt à en modifier la psychologie par des croisements.
On sait pourtant que l’un a été tenté au début du siècle. On vit aux Tuileries
un lot de Bretons-Nivernais. Dans l’ensemble de qualité que j’ai eu l’honneur
de juger à Nevers au printemps dernier, j’ai vu un ou deux chiens dont la
livrée au moins pouvait en marquer souvenir. On a bien fait en n’insistant pas.
Le Fauve de Bretagne était de haute initiative et de grand courage comme le
Nivernais, mais de caractère souvent désagréable, ce pourquoi il a été
abandonné, ne survivant plus que sous forme de briquet assagi que nous nous
efforçons de sélectionner après un long abandon. Le Nivernais se suffit à
lui-même et il en demeurait assez pour remonter la race comme l’ont démontré
les faits.
Il n’y a pas beaucoup plus d’un quart de siècle qu’un
groupe de sportsmen bien avisés ont entrepris et encouragé l’élevage, autrement
qu’au compte-gouttes, de l’antique race nivernaise. La réussite est complète
comme on pouvait l’espérer, vu l’ancienneté de la race, la méthode avec
laquelle il a été procédé, la pureté de nombreux éléments conservés chez les
chasseurs. Étant donné le travail spécial demandé à leurs chiens, ils n’avaient
eu, en effet, aucun intérêt à en modifier la psychologie par des croisements.
On sait pourtant que l’un a été tenté au début du siècle. On vit aux Tuileries
un lot de Bretons-Nivernais. Dans l’ensemble de qualité que j’ai eu l’honneur
de juger à Nevers au printemps dernier, j’ai vu un ou deux chiens dont la
livrée au moins pouvait en marquer souvenir. On a bien fait en n’insistant pas.
Le Fauve de Bretagne était de haute initiative et de grand courage comme le
Nivernais, mais de caractère souvent désagréable, ce pourquoi il a été
abandonné, ne survivant plus que sous forme de briquet assagi que nous nous
efforçons de sélectionner après un long abandon. Le Nivernais se suffit à
lui-même et il en demeurait assez pour remonter la race comme l’ont démontré
les faits.