| Accueil > Années 1948 et 1949 > N°630 Août 1949 > Page 600 | Tous droits réservés |
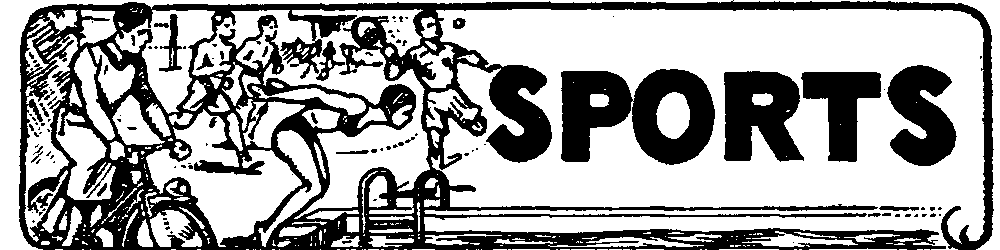
Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.
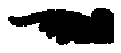
|
Le canoé de croisière |
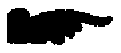
|
Équipement et accessoires
|
Peut-être, en achetant un canoé, n’envisagiez-vous de faire, avec lui, que d’agréables promenades dominicales en amont et en aval du lieu de votre résidence. Néanmoins, nous vous avons conseillé de fixer votre choix sur un type de bateau apte à la croisière, car nous sommes persuadés qu’un jour vous éprouverez le besoin de vous évader et d’aller plus en amont, ou sur une autre rivière, à la recherche de sensations nouvelles. Ce jour-là, il vous faudra un équipement approprié et quelques accessoires. Examinons d’abord le canoé : le fond doit être préservé par au moins dix paires de quilles d’échouage, longues lattes de bois dur, larges de 2cm,5, espacées de 2 à 3 centimètres. Elles recouvriront la coque jusqu’au-dessus du bouchain, les plus hautes étant forcément plus courtes, en fonction de la forme du bateau. La quille centrale ne doit pas être beaucoup plus épaisse que les quilles d’échouage, rabotez-la au besoin pour qu’elle n’ait pas plus de 2 centimètres de saillie et pratiquez deux légères entailles pour encastrer les extrémités des bandes de cuivre qui protègent les étraves.
Intérieurement, vous poserez dans le creux du bouchain, et au milieu du bateau, deux réglettes de bois, longues d’environ 60 centimètres, qui vous permettront, en passant des sangles dans les espaces ainsi ménagés entre les membrures, de fixer vos bagages. Le canoé, étant normalement chargé au centre, ne doit déjauger à l’avant que de quelques centimètres lorsque les équipiers sont à leur place ; déplacez au besoin l’un ou l’autre barrot peur obtenir l’équilibre. La hauteur des barrots a également son importance, 26 centimètres au-dessus du fond est une bonne moyenne, le poids du corps devant être également réparti sur le barrot et sur les genoux. Les plaques de caoutchouc mousse sur lesquelles vous posez vos genoux doivent avoir 20 à 25 centimètres de largeur et au moins 60 de longueur (80 pour un soliste). Il est bon de visser deux petits cavaliers au fond du bateau pour les attacher. Les bosses d’amarrage seront de préférence en coton torsadé de 8 millimètres de diamètre. Huit à 10 mètres à l’avant, 10 à 15 mètres à l’arrière sont nécessaires. On ne doit pas fixer une bosse directement à l’anneau qui peut casser ou s’arracher ; il faut la faire passer dans l’anneau et l’attacher à un barrot ou bien l’engager dans un trou pratiqué dans le pontage bois et la retenir par un nœud en dessous. Le pontage amovible en forte toile est indispensable pour franchir les rapides tant soit peu importants. Il sera toujours utile pour préserver les bagages du soleil et de la pluie. Le pontage recouvre entièrement le canoé et comporte deux ouvertures à l’emplacement des pagayeurs. Des cheminées en forme de tronc de cône avec soufflets sur les côtés entourent la taille, retenues à la partie supérieure par une ceinture élastique indépendante. Nous insistons sur ce point, il est indispensable qu’en cas de dessalage (c’est le terme consacré signifiant naufrage en canoé) les équipiers puissent se dégager sans aucun effort. La figure 2 représente les différentes parties du pontage :
b, renforts de sangle ou cuir à cheval sur les plats-bords ; c, pattes de retenue des bosses ; d et e, gaines et pattes de fixation des pagaies de rechange. Le pontage, qui comporte des œillets sur les bords, peut être maintenu et tendu par un laçage sur les listons ajourés à cet effet. Pour faciliter les opérations d’ouverture et de fermeture, il est préférable de disposer des boutons de taud juste au-dessus du liston ; celui-ci peut alors être plein et sert seulement de garantie (fig. 3). En croisière, chaque équipier doit disposer d’une pagaie de rechange, toujours à portée de la main. Sur une rivière accidentée nécessitant des manœuvres parfois brutales, la pagaie doit être avant tout solide ; mais en eau calme, pour accomplir de longues étapes, une pagaie légère est préférable. Vous fatiguerez moins et manœuvrerez plus facilement avec une pagaie bien équilibrée dont le poids de la pale est sensiblement égal à celui du manche.
Si vous partez sur une rivière très difficile ou en mer, que chaque équipier, même s’il est un excellent nageur, soit pourvu d’un gilet de sauvetage qu’il endossera pour franchir les passages les plus scabreux. Une grosse éponge remplira l’office de pompe de cale et vous ne manquerez pas d’enfermer tout votre matériel dans des sacs étanches arrimés au fond du bateau. L’équipement du kayac comprend sensiblement les mêmes accessoires avec, naturellement, quelques variantes. Les quilles d’échouage sont remplacées par des bandes de même nature que l’enveloppe, collées aux endroits où celle-ci est en contact avec l’armature. Pour pagayer longtemps, il est confortable de fixer des plaques de caoutchouc mousse sur le siège et le dossier. Le kayac, partiellement ponté et pourvu d’une hiloire, est mieux défendu que le canoé contre les vagues. Le pontage complet fermant entièrement l’ouverture n’est indispensable que pour franchir de très gros rapides ou esquimauter. Des pattes de fixation cousues sur le pont retiendront les pagaies de rechange, une pale de chaque bord. Vérifier et renforcer au besoin les fixations des anneaux de bosses. Le kayac étant plus léger que le canoé, le chariot peut être moins résistant. Il importe, par contre, qu’il soit pliant et démontable, la capacité du kayac ne permettant pas le transport d’objets volumineux. Pour la même raison, les bagages devront être répartis dans un plus grand nombre de sacs adaptés aux dimensions du kayac. Vous apporterez le plus grand soin au chargement, les colis les plus lourds étant rapprochés du centre pour que le bateau conserve sur l’eau une position normale et monte facilement à la vague. Enfin, vous n’oublierez pas que pour rendre un kayac insubmersible il est indispensable de disposer des ballons flotteurs dans les pointes. Il existe également des boudins pneumatiques qui, disposés à l’extérieur de chaque bord, assurent en mer une plus grande stabilité. G. NOËL. |
|
|
Le Chasseur Français N°630 Août 1949 Page 600 |
|
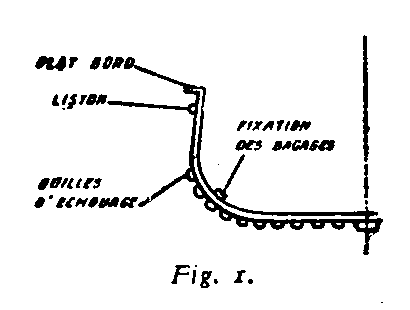 Des listons, baguettes de bois moins larges et plus
épaisses que les quilles d’échouage, disposés à 8 centimètres sous les
plats-bords, protègent les côtés et permettent de fixer le pontage (fig. 1).
Des listons, baguettes de bois moins larges et plus
épaisses que les quilles d’échouage, disposés à 8 centimètres sous les
plats-bords, protègent les côtés et permettent de fixer le pontage (fig. 1).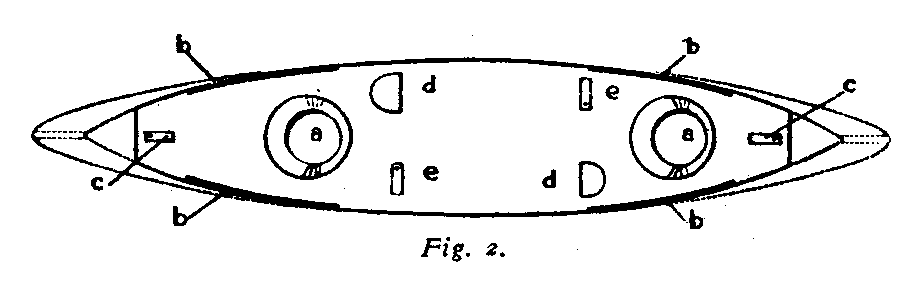 a, trous d’hommes et cheminées ;
a, trous d’hommes et cheminées ;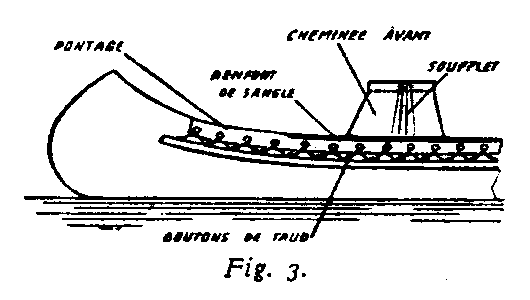 Le chariot est l’un des accessoires les plus
importants en croisière. Il vous servira, au départ et à l’arrivée, pour
franchir la distance de la gare à la rivière ; en cours de route, il vous
permettra de contourner un obstacle, barrage ou rapide infranchissable. Pour
rouler votre bateau chargé sur des sentiers souvent mauvais, vous devrez
choisir un chariot robuste, avec des roues fortement rayonnées, montées sur
roulements à billes et équipées de pneus ballons. Peu importe qu’il soit pliant
ou démontable si vous pouvez aisément le ranger à bord, et vous emporterez
toujours une pompe et un nécessaire de réparation pour les chambres à air.
Le chariot est l’un des accessoires les plus
importants en croisière. Il vous servira, au départ et à l’arrivée, pour
franchir la distance de la gare à la rivière ; en cours de route, il vous
permettra de contourner un obstacle, barrage ou rapide infranchissable. Pour
rouler votre bateau chargé sur des sentiers souvent mauvais, vous devrez
choisir un chariot robuste, avec des roues fortement rayonnées, montées sur
roulements à billes et équipées de pneus ballons. Peu importe qu’il soit pliant
ou démontable si vous pouvez aisément le ranger à bord, et vous emporterez
toujours une pompe et un nécessaire de réparation pour les chambres à air.