Écologie : La notion d'écologie apparaît avec Haeckel (1886) : elle institue un nouveau champ dans les sciences biologiques : celui des relations entre les êtres vivants et les milieux où ils vivent.
En se développant au XXe siècle, l'écologie va de plus en plus découvrir dans l'environnement la richesse d'un univers : le terme d'Umwelt signifie "monde environnant". Elle va discerner l'unité à double texture issue de la conjonction d'un biotope (le milieu géophysique) et d'une biocénose (l'ensemble des interactions entre les êtres vivants de toutes sortes peuplant ce biotope). Les unités écologiques émergent : à la base, la "niche", petite communauté topique où se tissent d'innombrables interactions entre les êtres vivants qui l'habitent : au sommet, la biosphère, qui totalise l'ensemble de la vie sur l'écorce terrestre.
Corrélativement, il apparaît que l'environnement n'est pas seulement constitué par l'ordre géophysique ni le désordre de tous contre tous. Les modèles mathématiques de Volterra et Lotka (1924) montrent que "la lutte pour l'existence" entre vivants produit des "lois". Plus encore : l'émergence de la notion d'éco-système (Tansley, 1935) constitue une prise de conscience fondamentale : Les interactions entre vivants, en se conjuguant avec les contraintes et les possibilités que fournit le biotope physique (et rétroagissant sur celui-ci), organisent précisément l'environnement en système. Dès lors, l'environnement cesse de représenter une unité seulement territoriale pour devenir une réalité organisatrice, l'éco-système, qui comporte en lui et l'ordre géophysique et le désordre de "jungle". L'écologie se fonde désormais sur l'idée d'éco-système, qui intègre et dépasse les notions de milieu, d'environnement, d'Umwelt.
En son fondement, effectivement, l'écologie n'est pas seulement la science des déterminations et influences physiques issues du biotope ; elle n'est pas seulement la science des interactions entre les divers et innombrables vivants constituant la biocénose ; elle est la science des interactions combinatoires/organisatrices entre chacun et tous les constituants physiques et vivants des éco-systèmes.
L'écologie à donc besoin d'une pensée organisationniste, mais qui dépasse les principes d'organisation strictement physiques. En effet, l'éco-organisation est de l'organisation à la fois physique <---> vivante dont l'originalité est dans son caractère vivant, qui rétroagit du reste sur son caractère physique.
La dimension écologique constitue, en quelque sorte, la troisième dimension organisationnelle de la vie. La vie n'était connue que sous deux dimensions, espèce (reproduction) et individu (organisme), et, si prégant soit-il, l'environnement semblait en être l'enveloppe extérieure. Or, la vie, ce n'est pas seulement la cellule constituée de molécules. Ce n'est pas seulement l'arbre multiramifié de l'évolution constitué en règnes, embranchements, ordres, classes, espèces. C'est aussi de l'éco-organisation.
(M2-80)
Écologie de l'action :
- Travailler dans l'incertain et dans l'inattendu, c'est le destin de la pensée et de l'action humaines. C'est ce que je nomme le principe d'écologie de l'action : quand quelqu'un entreprend une action , il peut la contrôler tout au début, mais après elle échappe à sa volonté parce qu'elle entre dans un jeu d'interactions et de rétroactions propres au milieu dans lequel elle intervient. Il en va de même pour l'action politique. Le savoir, ce n'est pas se décourager, c'est avoir conscience du risque inhérent à l'action , de la nécessité de la corriger, voire de la torpiller si elle va dans le sens contraire du but initial. (LM-91)
- Le principe de l'écologie de l'action , qui se prolonge en principe de l'écologie de la politique, signifie qu'une action commence à échapper à l'intention (l'idée) de ceux qui l'ont déclenchée dès qu'elle entre dans le jeu des inter-rétro-actions du milieu ou il intervient. Ainsi la «réaction aristocratique», qui a suscité la convocation des Etats généraux de 1789 où la noblesse pensait, grâce au vote par ordre, récupérer des privilèges qui lui avaient été arrachés par la monarchie absolue, a abouti au contraire à la liquidation de tous les privilèges de la classe aristocratique. A l'inverse, les poussées révolutionnaires de 1936 en Espagne ont déclenché par réaction le coup d'Etat franquiste. De même qu'en météorologie une petite bifurcation dans une zone critique peut avoir des effets en chaîne énormes, d'où l'idée «d'effet-papillon» , de même quelques légères modifications d'idées dans l'esprit du chef de l'immense empire totalitaire vont déclencher une réforme, d'abord prudente et locale, qui va se généraliser et s'amplifier, et, selon un processus devenant explosif, par effets d'action /réaction où l'échec de la réaction conservatrice donne le déclic final, le processus aboutit à l'écroulement en deux ans de l'empire lui-même. Il y a des «effets-papillon» historiques. De toute façon, les conséquences à long terme d'une action politique sont totalement imprévisibles au départ. (TP-93)
- Dès le début d'une action , celle-ci tend à échapper à la volonté de ses auteurs ou acteurs pour entrer dans un jeu d'inter et rétroactions propres au milieu où elle intervient notamment le milieu social et à ce moment là peut non seulement dévier de son chemin mais se retourner contre son auteur. Je dirais même que la règle, c'est que l'action échappe à son auteur. (EAP-95)
- Le premier principe de l'écologie de l'action enseigne qu'une action commence à échapper à l'intention de ses initiateurs dès qu'elle entre dans le jeu des inter-rétro-actions du milieu où elle intervient ; elle peut y changer son sens et même aboutir à l'inverse des effets escomptés...... Aussi l'action peut avoir trois types de conséquences insoupçonnées, comme l'a recensé Hirschman :
- l'effet pervers (l'effet néfaste inattendu est plus important que l'effet bénéfique espéré) ;
- l'inanité de l'innovation (plus ça change, plus c'est la même chose) ;
- la mise en péril des acquis obtenus (on a voulu améliorer la société, mais on n'a réussi qu'à supprimer des libertés ou des sécurités).
- Le second principe de l'écologie de l'action nous dit que les effets à long terme d'une action et ses conséquences finales sont imprévisibles.... L'écologie de l'action nous dit par là même que des intentions émancipatrices peuvent aboutir à des effets oppresseurs et que des intentions oppressives, en suscitant une réaction antagoniste, produire d'excellents effets libérateurs.
- Il faut également situer le problème de la fin et des moyens, dans une relation d'incertitude propre à l'écologie de l'action . Les moyens asservissants employés pour une fin libératrice peuvent, non seulement contaminer cette fin, mais aussi s'autofinaliser. Ainsi la Tcheka, après avoir perverti le projet socialiste, s'est autofinalisée en devenant, sous les noms successifs de Guépéou, NKVD, KGB, une puissance policière suprême destinée à s'autoperpétuer. A l'inverse, la ruse, le mensonge, la force, au service d'une juste cause peuvent sauver celle-ci sans la contaminer, à condition d'avoir été des moyens exceptionnels et provisoires. (PC-97)
- On a parfois l’impression que l’action simplifie car, dans une alternative, on décide, on tranche. Or, l’action est décision, choix, mais c’est aussi pari. Et dans la notion de pari, il y a la conscience du risque et de l’incertitude. Ici intervient la notion de l’écologie de l'action . Dès qu’un individu entreprend une action , quelle qu’elle soit, celle-ci commence à échapper à ses intentions. Cette action entre dans un univers d’interactions et c’est finalement l’environnement qui s’en saisit dans un sens qui peut devenir contraire à l’intention initiale.
- L’écologie de l'action c’est en somme tenir compte de la complexité qu’elle suppose, c’est-à-dire aléa, hasard, initiative, décision, inattendu, imprévu, conscience des dérives et des transformations. […] L'écologie de l'action nous invite toutefois non pas à l'inaction mais au pari qui reconnaît ses risques et à la stratégie qui permet de modifier voire d'annuler l'action entreprise.
- Toute action échappe à la volonté de son auteur en entrant dans le jeu des inter-rétro-actions du milieu où elle intervient. Tel est le principe propre à l’écologie de l'action. L'action risque non seulement l'échec mais aussi le détournement ou la perversion de son sens initial, et elle peut même se retourner contre ses initiateurs. Ainsi, le déclenchement de la révolution d'octobre 1917 a suscité non pas une dictature du prolétariat mais une dictature sur le prolétariat. Plus largement, les deux voies vers le socialisme, la voie réformiste social-démocrate et la voie révolutionnaire léniniste ont l'une et l'autre abouti à tout autre chose que leurs finalités. L'installation du roi Juan Carlos en Espagne, selon l'intention du général Franco de consolider son ordre despotique, a au contraire fortement contribué à diriger l'Espagne vers la démocratie. (SSEF-00)
Economie :
- On ne saurait considérer l'économie comme une entité close. C'est une instance autonome dépendante d'autres instances (sociologique, culturelle, politique) elles-mêmes autonomes/dépendantes les unes des autres. Ainsi, l'économie de marché suppose un ensemble cohérent d'institutions et cet ensemble cohérent manque à l'échelle planétaire. C'est la relation au non-économique qui manque à la science économique. Celle-ci est une science dont la mathématisation et la formalisation sont de plus en plus rigoureuses et sophistiquées ; mais ces qualités comportent le défaut d'une abstraction qui se coupe du contexte (social, culturel, politique) ; elle gagne sa précision formelle en oubliant la complexité de sa situation réelle, c'est-à-dire en oubliant que l'économie dépend de ce qui dépend d'elle. Aussi, le savoir économiste qui s'enferme dans l'économique devient incapable d'en prévoir les perturbations et le devenir, et devient aveugle à l'économique lui-même.
- L'économie mondiale semble osciller entre crise et non-crise, dérèglements et re-régulations. Profondément dérégulée, elle rétablit sans cesse des régulations partielles, souvent au prix de destructions (des excédents, par exemple, pour soutenir la valeur monétaire des produits) et de dégâts humains, culturels, moraux et sociaux en chaîne (chômage, progression de la culture des plantes à drogue.) La croissance économique, depuis le XIX siècle, a été non seulement motrice, mais régulatrice de l'économie en accroissant la demande en même temps que l'offre. Mais elle a en même temps détruit irrémédiablement les civilisations rurales, les cultures traditionnelles. Elle a apporté des améliorations considérables dans le niveau de vie ; elle a en même temps provoqué des perturbations dans le mode de vie.
- De plus la croissance économique cause des dérèglements nouveaux. Son caractère exponentiel ne crée pas seulement un processus multiforme de dégradation de la biosphère, mais également un processus multiforme de dégradation de la psychosphère, c'est-à-dire de nos vies mentales, affectives, morales, et tout cela entraîne des conséquences en chaîne et en boucle. Les effets civilisationnels que produit la marchandisation de toutes choses, justement annoncée par Marx - après l'eau, la mer et le soleil, les organes du corps humain, le sang, le sperme, l'ovule, le tissu fœtal deviennent marchandises -, sont le dépérissement du don, du gratuit, de l'offre, du service rendu, la quasi-disparition du non-monétaire, qui entraînent l'érosion des valeurs autres que l'appât du gain, l'intérêt financier, la soif de richesse…
- Certes, la concurrence demeure à la fois la grande stimulatrice et la régulatrice de l'économie, et ses dérèglements, comme dans la formation de monopoles, peuvent être combattus par des lois antitrusts ; mais ce qui est nouveau est que la concurrence internationale nourrit désormais une accélération à quoi sont sacrifiées la convivialité, les possibilités de réforme, et qui, s'il n'y a pas décélération, nous conduit vers… Explosion ? Désintégration ? Mutation ? (TP-93)
- La science économique est la science humaine la plus sophistiquée et la plus formalisée. Pourtant les économistes sont incapables de s'accorder sur leurs prédictions, qui sont souvent erronées. Pourquoi ? Parce que la science économique s'est isolée des autres dimensions humaines et sociales qui lui sont inséparables. Comme dit Jean-Paul Fitoussi : «beaucoup de disfonctionnements, aujourd'hui, procèdent d'une même défaillance de la politique économique : le refus d'affronter la complexité»... La science économique est de plus en plus incapable d'envisager ce qui n'est pas quantifiable, c'est-à-dire les passions et les besoins humains. Ainsi l'économie est à la fois la science la plus avancée mathématiquement et la plus arriérée humainement. Hayek l'avait dit : «Personne ne peut être un grand économiste qui soit seulement un économiste.» Il ajoutait même : «qu'un économiste qui n'est qu'économiste devient nuisible et peut constituer un véritable danger.» (TBF-99)
-
Education - Enseignement :
- L'être humain est troué comme gruyère, multiple comme polypier, ouvert comme corridor. Toute l'éducation sociale vise à calfeutrer les orifices, à corseter la multiplicité, à condamner la plupart des ouvertures, à baliser la piste aux elohim (démons). (VS-69)
- Je crois que nous sommes aujourd’hui dans des conditions particulièrement critiques liées à la dégradation de la fonction d’enseignant ; dégradation parce qu’enseigner est devenu une fonction qui réduit l’enseignant à l’image étriquée du fonctionnaire, alors que c’était, à une autre époque, une véritable mission. Les instituteurs du début de la 3ème République étaient des missionnaires. Leur mission était effectivement pensée dans l’héritage de ce qu’ils croyaient être l’esprit des Lumières. Ils n’entendaient pas seulement transmettre des matières, du savoir, mais traduisaient une volonté de faire en sorte que le savoir devienne fécond pour la personne comme pour la société. C’était politique au sens noble du terme. Pour des raisons historiques que nous n’avons pas à analyser, ici, il y a eu une dégradation d’un Eros et comme toujours, quand se dégrade l’Eros , la compensation que l’on demande c’est de l’argent (je ne sous-estime pas pour autant les problèmes de salaire, de traitement, de retraite etc... mais ceux-ci envahissent le champ mental de nombre d’enseignants qui ont désormais perdu le sens de leur mission). Cet eros , n’est pas seulement amour pour la tâche, amour pour les idées auxquelles on croit, mais tout autant amour pour ceux auxquels on s’adresse. En d’autres termes, il ne s’agit plus tellement d’élèves abstraits, identifiés par leur nom de famille mais d’humains auxquels on se sent attaché, lié de façon affective.
- Alors que l’enseignement semblait longtemps être fondé sur un savoir affirmé (on pensait alors la science comme certitude), là se trouve l’objet de l’interrogation, plus rien aujourd’hui ne reste à l’abri, en dehors du champ de cette ré-interrogation critique. Là, est vraiment le sens d’une nouvelle mission éducative, pensée cette fois dans une perspective d’ensemble. L’école apprend à séparer et n ’apprend pas à relier. Pourquoi ? Parce qu’on pose des disciplines comme des entités, côte à côte : de mon temps, par exemple, il y avait un professeur " d’histoire et géographie " (je ne sais pas si cela existe toujours dans l’enseignement secondaire), mais il est évident qu’il n’établissait jamais les liens entre la géographie et l’histoire, bien que la géographie soit une science typiquement historique, puisque c’est toute l’histoire de la terre, et bien que l’histoire soit typiquement topologique, toujours inscrite dans un espace. On enseigne des matières séparées et on n’élabore pas les liens. Les cloisonnements vont se multiplier et se durcir avec les spécialisations, et ce jusqu’à l’Université. Or, on a oublié que ce que l’on appelle la culture, c’est l’aptitude à situer un apport de connaissances dans son contexte et si possible dans l’ensemble où il se trouve. Il est évident que c’est l’aptitude à contextualiser qui rend la connaissance pertinente. Or, nous nous rendons compte que même dans des sciences très sophistiquées comme l’économie par exemple, cette économie si sophistiquée soit-elle dans sa mathématisation, sa quantification est incapable de se situer comme une des dimensions des activités humaines et ne tient jamais compte des passions, des mouvements, des mythes, des besoins de l'âme, de la chair ou du sang. C’est donc une science qui finalement manque aussi totalement du pouvoir de prédiction que des sciences beaucoup moins raffinées. (EAP-95)
- Au XVII siècle, Pascal avait déjà compris combien tout est lié, reconnaissant que "toute chose est aidée et aidante, causée et causante" - il avait même le sens de la rétroaction, ce qui était admirable à son époque -, "et tout étant lié par un lien insensible qui relie les parties les plus éloignées les unes des autres, je tiens pour impossible de connaître les parties si je ne connais le tout comme de connaître le tout si je ne connais les parties." Voilà la phrase clé. C'est à cet apprentissage que devrait tendre l'éducation. Mais, malheureusement, nous avons suivi le modèle de Descartes, son contemporain, qui prônait lui le découpage de la réalité et des problèmes. Or, un tout produit des qualités qui n'existent pas dans les parties séparées. Le tout n'est jamais seulement l'addition des parties. C'est quelque chose de plus. (LFM-97)
- L'éducation disciplinaire du monde développé apporte bien des connaissances, mais elle engendre une connaissance spécialisée qui est incapable de saisir les problèmes multidimensionnels, et elle détermine une incapacité intellectuelle de reconnaître les problèmes fondamentaux et globaux. (TSC-99)
- ... notre système d'enseignement.... nous apprend dès l'école élémentaire à isoler les objets (de leur environnement), à séparer les disciplines (plutôt que de reconnaître leurs solidarités), à disjoindre les problèmes, plutôt qu'à relier et intégrer. Il nous enjoint de réduire le complexe au simple, c'est-à-dire de séparer ce qui est lié, de décomposer et non de recomposer, d'éliminer tout ce qui apporte désordres ou contradictions dans notre entendement. (La pensée qui découpe, isole, permet aux spécialistes et experts d'être très performants dans leurs compartiments, et de coopérer efficacement dans des secteurs de connaissance non complexes, notamment ceux concernant le fonctionnement des machines artificielles ; mais la logique à laquelle ils obéissent étend sur la société et les relations humaines les contraintes et les mécanismes inhumains de la machine artificielle et leur vision déterministe, mécaniste, quantitative, formaliste, ignore, occulte ou dissout tout ce qui est subjectif, affectif, libre, créateur.). Dans ces conditions, les jeunes esprits perdent leurs aptitudes naturelles à contextualiser les savoirs, et à les intégrer dans leurs ensembles.
- Nous devons donc penser - La première finalité de l'enseignement a été formulée par Montaigne : mieux vaut une tête bien faite que bien pleine. Ce que signifie «une tête bien pleine» est clair : c'est une tête où le savoir est accumulé, empilé, et ne dispose pas d'un principe de sélection et d'organisation qui lui donne sens. «Une tête bien faite» signifie que, plutôt que d'accumuler le savoir, il est beaucoup plus important de disposer à la fois : - d'une aptitude générale à poser et traiter des problèmes, - de principes organisateurs qui permettent de relier les savoirs et de leur donner sens.
- L'éducation doit favoriser l'aptitude naturelle de l'esprit à poser et résoudre les problèmes et corrélativement stimuler le plein emploi de l'intelligence générale. Ce plein emploi nécessite le libre exercice de la faculté la plus répandue et la plus vivante de l'enfance et de l'adolescence, la curiosité, que trop souvent l'instruction éteint, et qu'il s'agit au contraire de stimuler, ou d'éveiller si elle dort. Il s'agit dès lors d'encourager, d'aiguillonner l'aptitude interrogative, et de l'orienter sur les problèmes fondamentaux de notre propre condition et de notre temps. Cela ne peut évidemment
être inscrit dans un programme, cela ne peut être animé que par une ferveur éducatrice.
- Comme notre mode de connaissance disjoint les objets entre eux, il nous faut concevoir ce qui les relie. Comme il isole les objets de leur contexte naturel et de l'ensemble dont ils font partie, il est de nécessité cognitive de mettre une connaissance particulière dans son contexte et la situer dans un ensemble. En effet, la psychologie cognitive démontre que la connaissance progresse principalement moins par sophistication, formalisation et abstraction des connaissances particulières, que par aptitude à intégrer ces connaissances dans leur contexte et leur ensemble global. Dès lors, le développement de l'aptitude à contextualiser et globaliser les avoirs devient un impératif d'éducation. (TBF-99)
- Il est remarquable que l'éducation qui vise à communiquer les connaissances soit aveugle sur ce qu'est la connaissance humaine, ses dispositifs, ses infirmités, ses difficultés, ses propensions à l'erreur comme à l'illusion, et ne se préoccupe nullement de faire connaître ce qu'est connaître.
- Que de sources, de causes d'erreur et d'illusion, multiples et sans cesse renouvelés dans les connaissances. D'où la nécessité, pour toute éducation, de dégager les grandes interrogations sur notre possibilité de connaître. Pratiquer ces interrogations constitue l'oxygène de toute entreprise de connaissance. De même que l'oxygène tuait les êtres vivants primitifs jusqu'à ce que la vie utilise ce corrupteur comme détoxifiant, de même l'incertitude, qui tue la connaissance simpliste, est le détoxifiant de la connaissance complexe. De toute façon, la connaissance reste une aventure pour laquelle l'éducation doit fournir les viatiques indispensables.
- La connaissance des problèmes clés du monde, si aléatoire et difficile soit-elle, doit être tentée sous peine d'infirmité cognitive. L'ère planétaire nécessite de tout situer dans le contexte et le complexe planétaires. La connaissance du monde en tant que monde devient nécessité à la fois intellectuelle et vitale. C'est le problème universel pour tout citoyen du nouveau millénaire : comment acquérir l'accès aux informations sur le monde et comment acquérir la possibilité de les articuler et de les organiser ? Comment percevoir et concevoir le Contexte, le Global (la relation tout/parties), le Multidimensionnel, le Complexe ? Pour articuler et organiser les connaissances, et par là reconnaître et connaître les problèmes du monde, il faut une réforme de pensée. Or, cette réforme est paradigmatique et non pas programmatique : c'est la question fondamentale pour l'éducation, car elle concerne notre aptitude à organiser la connaissance.
- La connaissance de la connaissance, qui comporte l’intégration du connaissant dans sa connaissance, doit apparaître à l’éducation comme un principe et une nécessité permanente.
- La connaissance du monde en tant que monde devient nécessité à la fois intellectuelle et vitale. C’est le problème universel pour tout citoyen du nouveau millénaire : comment acquérir l’accès aux informations sur le monde et comment acquérir la possibilité de les articuler et de les organiser ? Comment percevoir et concevoir le Contexte, le Global (la relation tout/parties), le Multidimensionnel, le Complexe ? Pour articuler et organiser les connaissances, et par là reconnaître et connaître les problèmes du monde, il faut une réforme de pensée. Or, cette réforme est paradigmatique et non pas programmatique : c’est la question fondamentale pour l’éducation, car elle concerne notre aptitude à organiser la connaissance. A ce problème universel est confrontée l’éducation du futur, car il y a inadéquation de plus en plus ample, profonde et grave entre, d’une part, nos savoirs disjoints, morcelés, compartimentés et, d’autre part, des réalités ou problèmes de plus en plus polydisciplinaires, transversaux, multidimensionnels, transnationaux, globaux, planétaires.
- L’éducation doit favoriser l’aptitude naturelle de l’esprit à poser et à résoudre les problèmes essentiels et, corrélativement, stimuler le plein emploi de l’intelligence générale. Ce plein emploi nécessite le libre exercice de la curiosité, faculté la plus répandue et la plus vivante de l’enfance et de l’adolescence, que trop souvent l’instruction éteint et qu’il s’agit au contraire de stimuler ou, si elle dort, d’éveiller.
- L’éducation du futur devra être un enseignement premier et universel portant sur la condition humaine. Nous sommes en l’ère planétaire ; une aventure commune emporte les humains où qu’ils soient. Ceux-ci doivent se reconnaître dans leur humanité commune et en même temps reconnaître la diversité culturelle inhérente à tout ce qui est humain.
- L’éducation du futur devra veiller à ce que l’idée d’unité de l’espèce humaine n’efface pas celle de sa diversité et que celle de sa diversité n’efface pas celle de l’unité. Il y a une unité humaine. Il y a une diversité humaine. L'unité n'est pas seulement dans les traits biologiques de l'espèce homo sapiens. La diversité n'est pas seulement dans les traits psychologiques, culturels, sociaux de l'être humain. Il y a aussi une diversité proprement biologique au sein de l'unité humaine ; il y a une unité non seulement cérébrale mais mentale, psychique, affective, intellectuelle ; de plus, les cultures et les sociétés les plus diverses ont des principes génératifs ou organisateurs communs.
- l’éducation devrait montrer et illustrer le Destin à multiples faces de l’humain : le destin de l’espèce humaine, le destin individuel, le destin social, le destin historique, tous destins entremêlés et inséparables. Ainsi, l’une des vocations essentielles de l’éducation du futur sera l’examen et l’étude de la complexité humaine. Elle déboucherait sur la prise de connaissance, donc de conscience, de la condition commune à tous les humains et de la très riche et nécessaire diversité des individus, des peuples, des cultures, sur notre enracinement comme citoyens de la Terre…
- C'est la complexité (la boucle productive/destructive des actions mutuelles des parties sur le tout et du tout sur les parties) qui fait problème. Il nous faut, dès lors, concevoir l'insoutenable complexité du monde dans le sens où il faut considérer à la fois l'unité et la diversité du processus planétaire, ses complémentarités en même temps que ses antagonismes. La planète n'est pas un système global, mais un tourbillon en mouvement, dépourvu de centre organisateur. Elle demande une pensée polycentrique capable de viser à un universalisme, non pas abstrait, mais conscient de l’unité/diversité de l’humaine condition ; une pensée polycentrique nourrie des cultures du monde. Eduquer pour cette pensée, telle est la finalité de l’éducation du futur qui doit œuvrer, à l’ère planétaire, pour l’identité et la conscience terrienne.
- S’il est vrai que le genre humain, dont la dialogique cerveau/esprit n’est pas close, possède en lui des ressources créatrices inépuisées, alors on peut entrevoir pour le troisième millénaire la possibilité d’une nouvelle création dont le XX siècle a apporté les germes et embryons : celle d’une citoyenneté terrestre. Et l’éducation, qui est à la fois transmission de l’ancien et ouverture d’esprit pour accueillir le nouveau, est au cœur de cette nouvelle mission.
- Nous sommes engagés, à l’échelle de l’humanité planétaire, à l’œuvre essentielle de la vie qui est de résister à la mort. Civiliser et Solidariser la Terre, Transformer l’espèce humaine en véritable humanité, deviennent l’objectif fondamental et global de toute éducation aspirant non seulement à un progrès mais à la survie de l’humanité. La conscience de notre humanité dans cette ère planétaire devrait nous conduire à une solidarité et une commisération réciproque de chacun à chacun, de tous à tous. L’éducation du futur devra apprendre une éthique de la compréhension planétaire.
- Le problème de la compréhension est devenu crucial pour les humains. Et, à ce titre, il se doit d’être une des finalités de l’éducation du futur. Rappelons que nulle technique de communication, du téléphone à Internet, n'apporte d'elle-même la compréhension. La compréhension ne saurait être numérisée. Eduquer pour comprendre les mathématiques ou telle discipline est une chose ; éduquer pour la compréhension humaine en est une autre. L’on retrouve ici la mission proprement spirituelle de l’éducation : enseigner la compréhension entre les personnes comme condition et garant de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité.
- La compréhension est à la fois moyen et fin de la communication humaine. La planète nécessite dans tous les sens des compréhensions mutuelles. Etant donné l’importance de l’éducation à la compréhension, à tous les niveaux éducatifs et à tous les âges, le développement de la compréhension nécessite une réforme planétaire des mentalités ; telle doit être l’œuvre pour l’éducation du futur. (SSEF-00)
Elohim : -
L'être humain est troué comme gruyère, multiple comme polypier, ouvert comme corridor. Toute l'éducation sociale vise à calfeutrer les orifices, à corseter la multiplicité, à condamner la plupart des ouvertures, à baliser la piste aux elohim (démons). (VS-69)
ÉMERGENCE -
On peut appeler émergences les qualités ou propriétés d'un système présentant un caractère de nouveauté par rapport aux qualités ou propriétés des composants considérés isolément ou agencés différemment dans un autre type de système.
- Tout état global présente des qualités émergentes. L'atome est un système disposant de propriétés originales, notamment la stabilité, par rapport aux particules qui le constituent, et il confère rétroactivement cette qualité de stabilité aux particules labiles qu'il intègre. Quand aux molécules, "la nouvelle espèce apparue n'a aucun rapport avec les constituants primitifs, ses propriétés ne sont nullement la somme des leurs, et elle se comporte différemment en toutes circonstances. Si la masse, la quantité de substance totale reste la même, sa qualité, son essence est toute nouvelle". L'exemple apparemment banal, en fait très complexe, de l'eau nous montre que son caractère liquide (aux températures ordinaires) est dû aux propriétés, non des atomes, mais des molécules de H2O de se lier entre elles de façon très souple.
- L'idée d'émergence est inséparable de la morphogénèse systémique, c'est-à-dire de la création d'une forme nouvelle qui constitue un tout : l'unité complexe organisée. Il s'agit bien de morphogénèse, puisque le système constitue une réalité topologiquement, structurellement, qualitativement nouvelle dans l'espace et le temps. L'organisation transforme une diversité discontinue d'éléments en une forme globale. Les émergences sont les propriétés, globales et particulières, issues de cette formation, inséparable de la transformation des éléments.
(M1-77)
Émergence :
La réalité de l'émergence
- Qualité nouvelle
- Entre épiphénomène et phénomène
Émergence :
L'émergence de la réalité
Émergence :
L'émergence de l'émergence
Entropie-Négentropie :
- Alors que le deuxième principe signifie entropie croissante, c’est-à-dire tendance au désordre moléculaire et à la désorganisation, la vie au contraire signifie tendance à l’organisation, à la complexité croissante, c’est-à-dire à la négentropie. Désormais est ouvert le problème de la liaison et de la rupture entre entropie et négentropie, qui a été éclairé par Brillouin (1959) à partir de la notion d’information. C’est le paradoxe de l’organisation vivante, dont l’ordre informationnel qui se construit dans le temps semble contredire un principe de désordre qui se diffuse dans le temps;
(PP-73)
Le second principe, esquissé par Carnot, formulé par Clausius (1850), introduit l'idée, non pas de déperdition qui contredirait le premier principe, mais de dégradation de l'énergie. Alors que toutes les autres formes d'énergie peuvent se transformer intégralement de l'une en l'autre, l'énergie qui prend forme calorifique ne peut se reconvertir entièrement, et perd donc une partie de son aptitude à effectuer un travail. Or toute transformation, tout travail dégagent de la chaleur, donc contribuent à cette dégradation. Cette diminution irréversible de l'aptitude à se transformer et à effectuer un travail, propre à la chaleur, a été désignée par Clausius du nom d'entropie.
Elle signifie en même temps que cette triple dégradation obéit à un processus irréversible au sein des systèmes physiques clos.
Le même, l’inverse, l’autre : En termes de mesure, entropie et néguentropie sont deux lectures, l’une selon le signe +, l’autre selon le signe - , de la même grandeur, comme l'accélération et la décélération pour la vitesse, l'alourdissement et l’al1égement pour le poids. Tout système macroscopique peut donc être lu selon son entropie S ou sa néguentropie - S, selon qu’on considère son désordre ou son ordre. Dans ce sens (et a l’inverse d’un compte bancaire), le signe + regarde le débit organisationnel (désorganisation), le signe - regarde le crédit organisationnel.
Evangile :
- Il nous faut réexplorer ce monde sans salut. Nous sommes, rappelons-le, dans une petite toupie qui tourne autour d'une boule de feu. Il nous faut enfin admettre que tous les existants, dont nous-mêmes, sommes perdus. Toute création est perdue. Toute beauté est perdue. Toute existence est perdue à jamais. Mais toute mauvaise nouvelle porte en son verso une nouvelle bonne nouvelle. La perte, donc la reconnaissance, de nos illusions et de nos erreurs, nous ouvre la possibilité d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle intelligence , d'un nouveau développement , d'une solidarité radicale. Plus encore : de la mauvaise nouvelle naît irrésistiblement le nouvel évangile, qui porte en lui, sans religion, la sève du vieil évangile. Mais le nouvel évangile d'amour ne se voue plus à l'éternel : il s'y oppose. Il se voue à la vérité périssable. Il se voue aux valeurs fragiles de liberté et de communauté. Il se voue aux êtres éphémères. L'idée d'amour elle-même est une idée ultime, périssable, fragile, mortelle… Et c'est pourquoi le nouvel évangile apporte, appelle, l'infinie pitié, commisération et miséricorde que l'homme devrait éprouver pour le condamné à mort qu'est l'homme.
- Voilà donc la bonne-mauvaise nouvelle (bonne parce qu'elle dissipe erreur et illusion dans le "croire"), la mauvaise-bonne nouvelle (mauvaise parce qu'elle anéantit toute idée de salut). Voici l'Evangile anti-évangile :
Ne plus Croire :
- Voici la mauvaise nouvelle : nous sommes perdus, irrémédiablement perdus. S'il y a un évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle, elle doit partir de la mauvaise : nous sommes perdus, mais nous avons un toit, une maison, une patrie : la petite planète où la vie s'est créé son jardin, où les humains ont formé leur foyer, où désormais l'humanité doit reconnaître sa maison commune. Ce n'est pas la Terre promise, ce n'est pas le paradis terrestre. C'est notre patrie, le lieu de notre communauté de destin de vie et mort terriennes. Nous devons cultiver notre jardin terrestre, ce qui veut dire civiliser la Terre.
- L'évangile des hommes perdus et de la Terre-Patrie nous dit : soyons frères, non parce que nous serons sauvés, mais parce que nous sommes perdus. Soyons frères, pour vivre authentiquement notre communauté de destin de vie et de mort terriennes. Soyons frères, parce que nous sommes solidaires les uns des autres dans l'aventure inconnue.
- L'évangile de fraternité Expliquer :- C'est tout ce qui prétend expliquer que nous devrions chercher à expliquer. (ARG18-60)
- Que l'univers soit fini et limité, infini et illimité, ces deux hypothèses sont aussi irritantes pour l'esprit l'une que l'autre. Plus généralement : dans toute explication, et quel que soit son objet, il reste un pourquoi, un comment; ou il se lève un pourquoi, un comment nouveau. Tout ce que pourra comprendre, expliquer notre esprit, ses plus géniales découvertes comme ses plus exactes constructions, tout cela demeurera en un sens profondément insatisfaisant pour l'esprit lui-même. Quelque chose dans l'explication reste inexplicable, quelque chose dans l'intelligence reste inintelligible. (VS-69)
Ethique - Auto-éthique:
- Je crois qu'il ne suffit pas de s'affirmer verbalement "révolutionnaire" pour se Croire en dehors de notre société, étant donné que, sauf ruptures violentes dans les soubassements, la révolution que nous rêvons n'y viendra pas, ou elle sera confisquée par le système d'appareil. Il faut plutôt s'efforcer d'appliquer une auto-éthique permanente : lutter contre la pétrification jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'heure de la putréfaction. (ARG14-59)
- L'auto-éthique est une émergence, c'est-à-dire une qualité qui ne peut apparaître que dans certaines conditions historiques et culturelles. Les éthiques traditionnelles sont des éthiques intégrées (dans la religion, la famille, la cité) avec des impératifs de solidarité, d'hospitalité et d'honneur. L'auto-éthique ne peut apparaître que dans la civilisation individualiste avec l'érosion et, souvent, la dissolution des éthiques traditionnelles. Son champ s'élargit à partir du moment où l'économie, la science, la politique, les arts sont libérés des considérations et contraintes morales autres qu'intrinsèques. L'auto-éthique signifie que l'éthique s'autonomise et ne se fonde que sur elle-même, mais cette autonomie est bien sûr dépendante des conditions historiques, sociales, culturelles, psychiques où elle émerge.
- L'auto-éthique ne se fonde que sur elle-même, mais elle ne pourrait s'affirmer sans une "foi" qui la nourrit et l'éclaire. Mon Auto-éthique relève surtout de la "foi" en l'amour , en la compassion, en la fraternité - Ce qui me semble différencier mon auto-éthique relève de trois exigences : le souci autocritique dans l'éthique-pour-soi ; la conscience de la complexité et des dérives humaines; une morale de la compréhension.
- Le problème clé de l'éthique-pour-soi est celui de la relation avec notre propre égocentrisme. Il y a en chacun un noyau égocentrique inéliminable et, de ce fait, il y a dans la vie morale une part amorale, du reste nécessaire à l'exercice de la morale, ne serait-ce que parce qu'elle permet la survit. Un cal d'indifférence est nécessaire pour ne pas être décomposé par la douleur du monde : on ne peut vivre sans être partiellement bouché et obtus, aveugle et pétrifié. Mais du coup, il est nécessaire d'être conscient de ses propres zones aveugles et de ses carences, et c'est ici que l'auto-examen critique nous permet de nous décentrer relativement par rapport à nous-mêmes, donc de reconnaître et juger notre égocentrisme.
- Ainsi l'éthique-pour-soi nous demande de ne pas nous Croire au centre du monde, de ne pas nous poser en juges de toutes choses. ("c'est un con", "c'est un salaud" sont les deux expressions qui expriment ordinairement la prétention à la souveraineté intellectuelle et morale).
- Mais surtout l'éthique-pour-soi doit comporter l'éthique de l'honneur, qui ennoblit l'égocentrisme. L'auto-éthique de l'honneur est à la fois différente des éthiques traditionnelles de l'honneur, et analogue. L'analogie concerne la nature de l'honneur, qui est le maintien d'une image de soi sans tâche. Mais, dans les morales traditionnelles, l'image de soi est sociale : l'honneur est déterminé par les normes et les interdits de la société. Dans l'auto-éthique, l'image de soi est personnelle : c'est pour soi-même, en fonction de normes qu'on a personnellement adoptées et assumées, qu'il faut préserver l'honneur. L'honneur est la morale de l'égocentrisme. Ainsi l'honneur nous demande qu'il n'y ait pas disjonction et, surtout, contradiction entre notre vie et nos idées.
- Comme je l'ai écrit, la seule morale qui survive à la lucidité est celle où il y a conflit ou incompatibilité de ses exigences, c'est-à-dire une morale toujours inachevée, infirme comme l'être humain, et une morale en problèmes, en combat, en mouvement comme l'être humain lui-même. Ainsi donc, en chacune de nos intentions, en chacun de nos actes, notre auto-éthique est soumise à l'incertitude, à l'opacité, au déchirement à l'affrontement.
- Voici donc une étique sans fondement autre qu'elle même, mais qui a besoin d'appuis à l'extérieur d'elle même : elle a besoin de se nourrir d'une foi, de s'appuyer sur une anthropologie et de connaître les conditions et situations où elle se pratique.
- C'est une éthique de la compréhension. C'est une éthique qui n'impose pas une vision manichéenne du monde. C'est une éthique sans salut, sans promesse. C'est une éthique de la communauté en perdition. C'est une étique qui rencontre sans cesse l'incertitude et la contradiction en son sein. C'est une éthique du pari. C'est une éthique qui nous demande de l'exigence pour nous-mêmes et de l'indulgence pour autrui et non l'inverse.
- Dans l'auto-éthique, la conscience morale nécessite, d'une part une foi ou une mystique qui l'inspirent, d'autre part l'exercice permanent d'une conscience éclairante. La morale est un éclairage qui a besoin d'être éclairé par l'intelligence et l'intelligence est un éclairage qui a besoin d'être éclairé par la morale. D'où le sens de la phrase de Pascal : "travailler à bien penser - L'éthique doit mobiliser l'intelligence pour affronter la complexité de la vie, du monde, de l'éthique elle-même. Ainsi ce n'est pas une norme arrogante ni un évangile mélodieux qu'énonce l'auto-éthique que je fais mienne ; c'est l'affrontement avec la difficulté de penser - Le problème le plus fondamental aujourd'hui demeure celui de l'auto-éthique. Car, dans une société qui impose naturellement ses impératifs aux individus, le problème de l'auto-éthique est évacué. Les normes du Bien et du Mal sont connues. La Morale, le Droit, la religion disent les critères de l'extérieur. L'auto-éthique choisit ses finalités, résout les conflits de devoirs (euthanasie ou prolongation de la vie...) car il n'y a plus d'impératifs extérieurs; et, en outre comme l'auto-éthique n'a pas de fondements (pas de vérités sacrées pour la justifier) elle ne peut que nous relier aux forces de reliance sans lesquelles il n'y aurait pas notre univers : si je pars de l'hypothèse où notre univers naît dans cette explosion thermique et tend à s'auto-détruire mais au contraire se développe car des forces de reliance électro-magnétiques, gravitationnelles vont permettre la formation des noyaux puis des galaxies, des atomes... et même si les forces de reliance sont très minoritaires dans l'univers, la vie est née de l'aptitude à regrouper des macro-molécules en très grand nombre, molécules qui n'auraient jamais pu se regrouper dans la stricte organisation physico-chimique et que la vie se développe dans sa reliance dans les polycelullaires, les sociétés ...mais elle est obligée d'intégrer en elle des forces de destruction et de mort dans la pure dialogie héraclitéenne. Selon moi l'éthique consiste à se raccorder à la source cosmique de reliance très minoritaire mais débouche sur cette volonté de résistance à la cruauté du monde. (EAP-95)
- Les sources de l'éthique sont également naturelles dans le sens où elles sont antérieures à l'humanité, où le principe d'inclusion est inscrit dans l'auto-socio-organisation biologique de l'individu et se transmet via la mémoire génétique. Les sociétés de mammifères sont à la fois communautaires et rivalitaires." (...) Les individus sont dévoués à leur progéniture, mais aussi parfois capables de manger leurs enfants.
- Le sentiment de communauté, au sein des sociétés historiques est et sera source de responsabilité et de solidarité, elles-mêmes sources de l'éthique. Grâce au langage, l'éthique de communauté devient explicite dans les sociétés archaïques, avec ses prescriptions, ses tabous, et son mythe d'ancêtre commun.
- Les progrès de la conscience morale individuelle et ceux de l'universalisme éthique sont liés.
- Depuis Machiavel, l'éthique et la politique se sont trouvés officiellement disjointes dans la conception où le Prince (le gouvernant) est tenu d'obéir à l'utilité, et l'efficacité et non à la morale.
- Il y a érosion du sens sacré de la parole donnée, du sens sacré de l'hospitalité, soit l'une des racines les plus anciennes de l'éthique. La profanation de ce qui fut sacré entraîne sa profanation.
- L'auto-éthique se forme au niveau de l'autonomie individuelle, au-delà des éthiques intégrées et intégrantes, encore que des racines ou des rameaux de ces éthiques demeurent souvent dans l'esprit individuel. En tout cas, les deux autres branches de l'éthique (éthique civique ou socio-éthique, anthropo-éthique ou éthique du genre humain) doivent aujourd'hui passer par conscience et décision personnelle.
- Le problème éthique central, pour chaque individu, est celui de sa propre barbarie intérieure. C'est pour surmonter cette barbarie que l'auto-éthique constitue une véritable culture psychique, plus difficile mais plus nécessaire que la culture physique.
- Si la liberté se reconnaît à la possibilité de choix - possibilité mentale d'examiner et de formuler les choix, possibilité extérieur d'exercer un choix - l'éthique de liberté pour autrui se résumerait à la parole de von Forester : "Agis en sorte qu'autrui puisse augmenter le nombre de choix possible.
- Les humiliés, les haïs, les victimes, ne doivent pas se transformer en humiliants, haïssants, oppresseurs : voilà l'impératif éthique.
- Il y a aussi une autre leçon qui est une leçon éthique clé : incorporer nos idées dans notre vie. Tant d'humanitaires et de révolutionnaires en idées vivent de façon égocentriques et mesquine. Tant d'émancipateurs en paroles sont incapables de laisser un peu de liberté à leurs proches. Tant de professeurs de philosophie oublient de s'enseigner à eux-mêmes un peu de sagesse. Il faudrait essayer de ressembler un peu à ses idées.
- Le sens que je donne, finalement, à l'éthique, s'il faut un terme qui puisse englober tous ses aspects, c'est la résistance à la cruauté du monde et à la barbarie humain. (M6-04)
Ethique de la compréhension - L'auto-éthique est d'abord une éthique de la compréhension. Nous devons comprendre que les êtres humains sont des êtres instables, chez qui il y a la possibilité du meilleur et du pire, certains ayant de meilleures possibilités que d'autres; nous devons comprendre aussi que les êtres ont de multiples personnalités potentielles, et que tout dépend des événements, des accidents qui leur arrivent et peuvent libérer certaines d'entre elles. […] Lorsque nous allons au cinéma, nous participons plus que dans la vie : nous aimons un vagabond, un clodo, un Charlot-Chaplin, mais, à la sortie du film, nous nous détournons de ceux que nous croisons et nous trouvons qu'ils sentent mauvais. C'est le message du cinéma, considéré comme un art mineur, que l'on oublie toujours. Le message est cependant passé l'espace d'un instant. Il y a eu une compréhension anthropologique. (APS-97)
- L'éthique de la compréhension est un art de vivre qui nous demande d'abord de comprendre de façon désintéressée. Elle demande un grand effort, car elle ne peut attendre aucune réciprocité : celui qui est menacé de mort par un fanatique comprend pourquoi le fanatique veut le tuer, en sachant que celui-ci ne le comprendra jamais. Comprendre le fanatique qui est incapable de nous comprendre, c'est comprendre les racines, les formes et les manifestations du fanatisme humain. C'est comprendre pourquoi et comment on hait et on méprise. L’éthique de la compréhension nous demande de comprendre l’incompréhension.
- L'éthique de la compréhension demande d'argumenter, de réfuter au lieu d'excommunier et d'anathématiser. Enfermer dans la notion de traître ce qui relève d'une intelligibilité plus ample empêche de reconnaître l'erreur, le fourvoiement, les idéologies, les dérives.
- La compréhension n'excuse ni n'accuse : elle nous demande d'éviter la condamnation péremptoire, irrémédiable, comme si l'on n'avait jamais soi-même connu la défaillance ni commis des erreurs. Si nous savons comprendre avant de condamner, nous serons sur la voie de l’humanisation des relations humaines.
- Nous devons lier l’éthique de la compréhension entre personnes avec l’éthique de l'ère planétaire qui demande de mondialiser la compréhension. La seule vraie mondialisation qui serait au service du genre humain est celle de la compréhension, de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité. (SSEF-00)
Ethique politique En-cyclo-pédie :
- Le terme encyclopédie ne doit plus être pris dans le sens accumulatif et alphabébéte où il s'est dégradé. Il doit être pris dans son sens originaire agkuklios paidea, apprentissage mettant le savoir en cycle ; effectivement, il s'agit d'en-cyclo-péder, c'est-à-dire d'apprendre à articuler les points de vue disjoints du savoir en un cycle actif.
Enigme :
- Après toute explication, tout éclaircissement, toute rationalisation, le caractère énigmatique persiste. L'énigme résolue, cette solution devient elle-même la grande énigme.
- Il faut admettre ce trait consubstantiel à l'univers, à la réalité, à l'être, au non-être, à la raison, aux sciences, à l'homme ; l'énigme.
- La saine pensée ne se propose pas de déchiffrer l'énigme - le caractère énigmatique se retrouvant à nouveau dans ce qu'elle a déchiffré. Elle porte avec elle la conscience de l'énigme. (VS-69)
- Quelle est cette énigme, dans cet univers de catastrophe, de turbulence, de dispersion, et qui apparaît dans la catastrophe, la turbulence, la dispersion : l’organisation ? (M1-77)
Ere planétaire - Planétarisation :
- La petite planète vivante doit être reconnue comme la matrice, la matrie des humains. C'est le jardin commun à la vie et à l'humanité. C'est la maison commune de tous les humains.... Réintroduire l'humain dans la planète, c'est le réintroduire aussi dans la vie dont il est issu, dont il fait partie, qui le nourrit, et c'est le réintroduire dans sa destinée concrète, inséparable de la biosphère - étant donné la relation d'autonomie/dépendance homme/nature.... La Terre est notre réalité objective et notre patrie subjective. Nous avons objectivé la terre sur nos écrans de télévision. Nous la voyons, objet céleste, bleue comme une orange. C'est la rationalité même qui nous ramène à la Terre : les deux trous d'ozone qui se sont formés dans l'Arctique et l'Antarctique, l'effet de serre provoqué par l'accroissement du CO2 dans l'atmosphère, les déforestations massives des grandes sylves tropicales, productrices de notre oxygène commun, la stérilisation des océans, mers et fleuves nourriciers, les pollutions sans nombre, les catastrophes sans frontière, tout cela nous montre que la patrie est en danger. Et l'affectivité nous y enracine : c'est notre seule maison, le seul lieu vivable et aimable dans le cosmos, notre matrie et notre patrie.
- Réintroduire l'humanité dans la planète, c'est introduire la planète dans la politique. Ce n'est pas seulement concevoir la «mondialisation» actuelle, c'est concevoir l'ère planétaire où toutes les parties sont devenues interdépendantes les unes des autres, et qui commence, aux Temps modernes, avec la domination, la guerre, la destruction. (PC-97)
- Nous sommes dans l'ère planétaire. L'ère a commencé en 1492 avec la découverte de l'Amérique, avec les premiers échanges de microbes, de végétaux, d'animaux etc. Et, au XX siècle, s'épanouit l'ère planétaire, à la fois dans l'unité, c'est-à-dire que tous les fragments de l'humanité sont unis les uns aux autres par des liens économiques, télécommunicationnels et autres mais, en même temps, à travers les déchirements parce que chaque fragment de l'humanité est en conflit avec d'autres fragments de l'humanité, et il y a convulsions. (NCJN-00)
- A partir de 1492, ce sont ces jeunes et petites nations qui s'élancent à la conquête du Globe et, à travers l'aventure, la guerre, la mort, suscitent l'ère planétaire qui fait désormais communiquer les cinq continents pour le meilleur et pour le pire. La domination de l’Occident européen sur le reste du monde provoque des catastrophes de civilisation, dans les Amériques notamment, des destructions culturelles irrémédiables, des asservissements terribles. Ainsi, l'ère planétaire s'ouvre et se développe dans et par la violence, la destruction, l'esclavage, l'exploitation féroce des Amériques et de l'Afrique. […]La planétarisation se développe par l’apport sur les continents de la civilisation européenne, de ses armes, de ses techniques, de ses conceptions dans tous ses comptoirs, avant-postes, zones de pénétration. L'industrie et la technique prennent un essor que n'a connu encore nulle civilisation. L'essor économique, le développement des communications, l'inclusion des continents subjugués dans le marché mondial déterminent de formidables mouvements de population que va amplifier la croissance démographique généralisée. […]La planétarisation engendre au XX siècle deux guerres mondiales, deux crises économiques mondiales et, après 1989, la généralisation de l'économie libérale nommée mondialisation. (SSEF-00)
- Nous savons qu'il faut solidariser la planète, qu'il faut en finir avec les guerres, résorber les inégalités les plus criantes. Certaines choses peuvent être faites comme un service civique des pays riches pour aider concrètement là où il y a des besoins dans les pays pauvres et ne pas fournir des aides, des crédits qui disparaissent dans des trafics de corruption. Nous savons que l'Occident souffre de la domination du calcul, du profit, de la technique. Dès lors, q'il ne trouve pas en lui les moyens de résoudre ses propres problèmes, comment faire ? L'une des solutions consisterait à favoriser l'émergence d'une société-monde ou bien à accroître le pouvoir des Nations unies. Il faudrait créer un Parlement mondial, mais aussi que des instances voient le jour pour lutter contre la dégradation de la biosphère. Ce sont des mesures qui sont rendues nécessaires par l'état d'urgence où se trouve actuellement la planète. (VM-03)
- Où en somme-nous de l'ère planétaire ? Ma thèse est que la globalisation - …j'ai essayé de concevoir l'Ère planétaire. Cette notion, empruntée à Heidegger mais travaillée à ma façon, est beaucoup plus pertinente que celle de " Temps modernes " à laquelle elle correspond chronologiquement. Les Temps modernes partent de la chute de Byzance en 1453. L'Ère planétaire commence en 1492 avec la découverte/conquête des Amériques par Christophe Colomb et, peu après, la navigation autour du globe de Vasco de Gama. L'Ère planétaire, c'est l'histoire de la domination, de l'asservissement et de l'exploitation d'une très grande partie du monde par des nations européennes. La fin de la période coloniale en 1975, avec l'abandon par le Portugal de ses colonies, annonce la nouvelle période dite de la globalisation.
- Les développements de l'Ère planétaire jusqu'à la fin du XXe siècle ne sont pas seulement ceux de la domination et de l'émancipation (du reste relative). Ce sont aussi ceux de l'interdépendance croissante entre les diverses parties du monde. La conscience de cette interdépendance se manifeste avec l'apparition, vers 1990, de la notion de globalisation.
(MC-08)
Errance :
- Nous le savons maintenant : aucun but vivant ne saurait être d'achèvement. Tous les buts vivants se confondent avec le chemin. Se hace el camino al andar. Nous sommes dans l'errance et ne sortirons pas de l'errance. Si nous entrons dans l'hyper-complexité, nous entrerons dans la connivence permanente avec l'aléa et l'incertitude, non dans leur élimination. Nous serons guidés par des finalités de plus en plus chercheuses et errantes. Nous serons, non dans la stabilité, mais dans le devenir. L'hyper-complexité est vouée au devenir. (M2-80)
- Il nous faut progresser dans l'errance, en sachant que tout progrès comporte, voire nécessite quelque régression. (JL-81)
Espérance - Improbabilité :
- Nous avons appris le désenchantement. Le monde que nous regardons est un monde désenchanté, sans démiurge, sans grand Médiateur, Parti, Nation, Héros, Classe. Mais le désenchantement est-il le désespoir ? Cette confusion est fort répandue, puisqu'on nous dit "désespérés". Cette confusion implique la très conformiste doctrine que seule l'illusion peut aider à vivre. Mais l'espoir véritable est l'espoir qui s'affirme dans un monde désenchanté. L'espoir, c'est la confiance dans les ressources, l'invention, le génie, la bonté qui sont dispensés dans les chromosomes de l'espèce humaine. L'espoir, c'est de conserver les élans, les aspirations vers une vie nouvelle, c'est de demeurer mobiles et mobilisables. Le contraire de l'espoir n'est pas la lucidité - le désenchantement - mais la résignation. (ARG16-59)
- En entrant dans ses vingt dernières années, le dix-neuvième siècle attendait du vingtième l'accomplissement des promesses de la science, le triomphe de la raison, l'épanouissement des libertés, le règne du progrès. Le vingtième siècle a donné deux guerres mondiales, des tueries sans fin, le nazisme, le stalinisme. La faim, la misère ont plus progressé que le bien-être et, en même temps que le bien-être, du mal-être a progressé. Une menace d'asservissement ou d'anéantissement planétaire guette l'humanité. Il est temps de sortir du vingtième siècle. Il est temps de forger le troisième millénaire. (JL-81)
- Ce qui est créateur, innovateur est imprévisible, improbable et même invisible.. Nul n'a les moyens de le concevoir. C'est pourquoi je suis optimiste : je pense que l'improbable a sa chance. Cette spirale de mort dans laquelle nous sommes, l'improbable c'est qu'elle se brise. Einstein disait, en termes un peu trop statistiques, que 10% seulement de notre esprit est utilisé : nous avivons une période très primitive, une sorte de "préhistoire" de l'esprit humain ; toutes ses potentialités ne sont pas encore développées. (SCC-84)
- L'histoire a été tragique, est tragique, risque d'être irrémédiablement tragique. Mais elle est également incertaine, et le principe d'incertitude nous dit que si improbable que ce soit, il n'est pas impossible de pouvoir améliorer les relations entre humains, ni impossible qu'on puisse civiliser la terre. Il laisse la porte ouverte à l'espérance mais n'apporte aucune assurance. (PC-97)
- L'histoire nous enseigne qu'il faut miser sur l'improbable. j'ai vécu historiquement deux fois la victoire de l'improbable. D'abord, avec la défaite du nazisme en 1945, alors que la victoire allemande était probable en Europe en 1941, et puis avec l'effondrement du système communiste en 1989-90. (LFM-97)
- Je crois en l'improbable. Je crois en l'improbable parce que si l'on en croit les probabilités, nous allons vers le chaos démographique, le chaos économique, le chaos nucléaire… mais l'improbable peut arriver.(tab-5) Pourquoi peut-il arriver ? J'ai un deuxième principe d'espérance, le principe d'Hölderlin : "Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve". Le danger croissant amène à une prise de conscience qui provoque un sursaut. Nous sommes au début d'un sursaut, par exemple pour le problème de la biosphère. Je ne suis pas sûr qu'on va réussir, mais nous voyons qu'il y a une conscience - pas seulement dans le mouvement des Verts - elle commence à se généraliser. Inversement, nous n'avons pas encore eu de sursaut en ce qui concerne, par exemple, notre civilisation qui se déshumanise de plus en plus, de plus en plus abstraite, mécanique, chronométrique. Mais ce sursaut pourra venir ! Donc je crois que, d'une façon tragique, plus nous nous approcherons du danger, plus nous aurons des chances d'en sortir, mais plus aussi augmenteront les risques d'y plonger. C'est un deuxième principe d'espérance. et le troisième principe d'espérance, c'est ce que Hegel appelait la vieille taupe. Dans les profondeurs de l'humanité, dans l'inconscient, les forces de régénérescence travaillent, les forces qui veulent sauver. Ces forces, on ne les voit pas, mais un jour elles germent. Nous ne sommes donc peut-être pas condamnés. Mais je ne peux rien prévoir. En attendant, il y a ce Moyen Age planétaire dans lequel nous entrons. (NCJN-00)
- Il faut passer par la désespérance pour retrouver l'espérance. (LM-12/03)
ESPRIT/CERVEAU
- L'esprit humain est le plus admirable gadget à justifier n'importe quoi qui ait été jamais créé dans le cosmos.
(VS-69)
- Voici deux notions, le cerveau et l'esprit liées en un nœud gordien indénouable, autour duquel tournent les visions du monde, de l'homme, de la connaissance, et que l'on ne peut trancher que par un coup d'épée barbare.
-Les aptitudes organisatrices du cerveau humain ont besoin de conditions socio-culturelles pour s'actualiser, lesquelles ont besoin des aptitudes de l'esprit humain pour s'organiser. Les " logiciels " culturels qui cogénèrent les connaissances de l'esprit/cerveau ont été eux-mêmes historiquement cogénérés par des interactions entre esprits/cerveaux. La culture est dans les esprits, vit dans les esprits, lesquels sont dans la culture, vivent dans la culture. Mon esprit connaît à travers ma culture, mais, dans un sens, ma culture connaît à travers mon esprit. Ainsi donc, les instances productrices de la connaissance se co-produisent les unes les autres ; il y a unité récursive complexe entre producteurs et produits de la connaissance, en même temps qu'il y a relation hologrammatique entre chacune des instances productrices et produites, chacune contenant les autres, et, dans ce sens, chacune contenant le tout en tant que tout.
- L'intelligence, ses formes multiples, l'ingegno, la pensée, la conscience, l'âme, sont des formes diverses d'une activité polyphonique de l'esprit... La société elle-même est transformée, complexifiée par l'émergence de l'esprit humain, puisque ce sont les interactions entres esprits individuels qui la produisent et que le langage multiplie les intercommunications, nourrit la complexité des relations entre individus et les complexités de la relation sociale.
Nœud gordien où s'associent intelligence, pensée, conscience, individu, langage, culture, société, l'esprit est à la fois une innovation dans l'évolution hominisante et un innovateur dans l'évolution humaine. Désormais, ce ne sont plus les réorganisations génétiques qui innovent, mais les aptitudes de l'esprit.
- L'esprit humain s'ouvre au monde. L'ouverture au monde se révèle par la curiosité, l'interrogation, l'exploration, la recherche, la passion de connaître. Elle se manifeste sur le mode esthétique, par émotion, sensibilité, émerveillement devant les levers et couchers de soleil, la lune nocturne, le déferlement des vagues, les nuages, les montagnes, les abîmes, les parures animales, le chant des oiseaux, et ces émotions vives pousseront à chanter, dessiner, peindre.
Elle incite à tous les départs.
L'esprit humain se sentira animé par son appartenance au monde, d'une part, son sentiment d'étrangeté au monde, de l'autre, ce qui correspond à notre statut d'enfants du cosmos étrangers au cosmos.
(M5-01)
Esprit/Cerveau :
Le grand schisme
Esprit/Cerveau :
Unidualité cerveau/esprit
Esprit/Cerveau :
Néo-dualisme - Néo-monisme
Esprit/Cerveau :
Trinité cerveau/esprit/culture
Esprit/Cerveau :
La machine hyper-complexe
Voici une machine totalement physico-chimique dans ses interactions ; totalement biologique dans son organisation ; totalement humaine dans ses activités pensantes et conscientes. Elle associe en elle tous les paliers de ce que nous appelons réalité. C'est bien, pour reprendre l'expression de Schopenhauer, le " noeud du monde ".
Esprit/Cerveau :
Unitas multiplex
L'organisation du cerveau combine spécialisations et non-spécialisations, localisations et non-localisations. Ainsi, il y a des neurones, des centres et des zones spécialisés, mais il y a également de vastes régions non fonctionnellement spécialisées dans le néo-cortex. Par ailleurs, l'altération de zones fonctionnellement spécialisées peut être compensée par déplacement et reconstruction des fonctions dans une zone non spécialisée (il y a, chez des sourds, récupération du cortex auditif pour la fonction visuelle).
Esprit/Cerveau :
Cerveau bi-hémisphèrique
(M3-86)
Esprit/Cerveau :
Unidualité hémisphèrique
La dissymétrie entre les deux hémisphères s'opère durant l'embryoge-nèse. Une hypothèse récente attribue à une hormone sexuelle, la testosté-rone, le développement préférentiel d'un hémisphère, ce qui voudrait dire qu'il y aurait une détermination " masculine " ou " féminine " innée dans la dominance de l'un ou l'autre hémisphère. Toutefois, comme l'a suggéré Danchin, il est possible que ce soit le développement de la dissymétrie qui règle le taux de production de la testostérone. De toute façon, il y a sexualisation des hémisphères, et il y a dominance du gauche chez l'homme, du droit chez la femme. Il y a donc deux types de dominance dans une connaissance qui demeure " uniduelle ", c'est-à-dire où le type dominé demeure actif, complémentaire mais subordonné à l'autre.
Esprit/Cerveau :
Les deux sexes de l'esprit
Esprit/Cerveau :
Le cerveau triunique
Esprit/Cerveau :
Les "hormonies" cérébrales
d'autre part, la tristesse, la morosité, la dépression sont entretenues et aggravées par le blocage de l'action. Nos idées, nos perceptions, nos conceptions ne peuvent être que très difficilement isolées de ces états psycho-affectifs, eux-mêmes chimiquement dépendants ; mais cette chimie dépend elle-même des conditions extérieures qui offrent des occasions de plaisir ou, au contraire, apportent douleur et frustration. Ce n'est donc pas sur un bébête déterminisme chimique des hormones que débouche la conception complexe des faisceaux hormonaux, mais sur l'interrelation et l'interaction de l'action, de la pensée et de l'être au sein d'un environnement (naturel, familial, culturel, social).
(M3-86)
Esprit/Cerveau :
Le complexe des complexes
Esprit/Cerveau :
L'arkhe-Esprit
Esprit/Cerveau :
L'esprit est dans le monde qui est dans l'esprit
Ainsi le sujet transcende l'expérience sensible dans son mode a priori de former la connaissance.
Leibniz avait formulé la première conception en boucle de la relation entre l'esprit et les données fournies par les sens : rien n'est dans l'esprit qui n'ait été auparavant dans les sens, si ce n'est l'esprit lui-même. Mais il faut aussi, en vertu du principe dialogique / récursif/hologrammatique, réintroduire l'esprit dans le monde et le monde dans l'esprit, et énoncer complémentairement : le monde est dans notre esprit qui est dans le monde. Disons autrement : notre monde est enfermé dans notre esprit/cerveau, lequel est enfermé dans notre être, lequel est enfermé dans notre monde.
Esprit/Cerveau :
L'erreur est humaine
La certitude de connaître la vérité est loin d'être une garantie contre l'erreur. Comme disait Romain Gary : " Méfiez-vous de la vérité, elle commet toujours des erreurs. " Les évidences reconnues ne sont pas nécessairement telles ; seul l'esprit non conforme discerne que les évidences reçues sont illusoires, et perçoit des évidences auxquelles la plupart sont aveugles. (M5-01)
(M5-01)
Esprit/Cerveau :
Le cerveau et l'ordinateur
Esprit/Cerveau :
Les aventures de l'esprit
Esprit/Cerveau :
L'esprit créateur
Esprit/Cerveau :
Cerveau piano
Esprit/Cerveau :
L'esprit tout puissant et débile
Esprit/Cerveau :
Les libertés de l'esprit
Esprit/Cerveau :
La sagesse de l'esprit
Esprit/Cerveau :
Réforme de l'esprit
… l'esprit humain est capable de pratiquer la connaissance de sa propre connaissance, d'intégrer en lui les moyens autocritiques et critiques qui lui permettent de lutter contre erreur et illusion, de ne pas subir passivement l'imprinting de sa culture, mais au contraire de se nourrir d'une culture régénérée née de l'union de la culture humaniste et de la culture scientifique ; il est capable de ne pas se laisser séquestrer par des idées Maîtresses possessives et autoritaires, de développer et affermir une conscience encore vacillante et trop fragile, bref de développer ses potentialités encore inexprimées. Sortir de la préhistoire de l'esprit humain est nécessaire pour sortir de l'âge de fer planétaire, et sortir de l'âge de fer planétaire est nécessaire pour sortir de la préhistoire de l'esprit humain. (M6-04)
(M6-04)
Esprit/Cerveau :
L'esprit de la vallée
- …j'étais animé par ce que le tao appelle l'esprit de la vallée, "qui reçoit toutes les eaux qui se déversent en elle". Mais je ne me vois pas comme une majestueuse vallée; je me vois plutôt comme une abeille qui s'est enivrée à butiner aux mille fleurs pour faire de tant de pollens divers un seul et même miel. Aujourd'hui, considérant rétrospectivement mon cheminement, je vois que l'absence de culture est à la source de ma culture. Mon vide culturel originaire a crée un appel d'air pour la curiosité, le savoir, l'imaginaire, la recherche de vérité, la recherche du bien, l'élaboration de mes propres normes. J'ai été fait par ce dont j'avais soif. Mon ouverture omnivore a entretenu mon autodidactisme, lequel a entretenu mon ouverture omnivore.
(MD-94)
ESPRIT/MATIÈRE
Comment surmonter la difficulté séculairement insurmontable de la relation entre d'une part matière, corps, cerveau, d'autre part esprit et âme, c'est-à-dire la disjonction entre la substantialité de l'être et l'immatérialité du connaître ?
De fait, c'est à de multiples niveaux qu'on peut désormais lever la disjonction :
La levée physique
La levée biologique
Ainsi, l'esprit surgit avec la cogitation (pensée) et la conscience. L'esprit donc est bien une émergence, dans le sens que nous avons défini (Méthode 1, p. 106-114), c'est-à-dire un complexe de propriétés et qualités qui, issu d'un phénomène organisateur, participe à cette organisation et rétroagit sur les conditions qui le produisent. L'esprit est une émergence propre au développement cérébral d'homo sapiens, mais seulement dans les conditions culturelles d'apprentissage et de communication liées au langage humain, conditions qui n'ont pu apparaître que grâce au développement cérébral-intellectuel d'homo sapiens au cours de cette dialectique multidimensionnelle que fut l'hominisation. Ainsi, l'esprit rétroagit sur l'ensemble de ses conditions (cérébrales, sociales, culturelles) d'émergence en développant ce qui permet son développement. De même, la conscience rétroagit sur ses conditions de formation, et peut éventuellement contrôler ou dominer ce qui la produit, voire étendre son contrôle au-delà (comme ces yogis déjà évoqués qui contrôlent consciemment les battements de leur coeur). Or ceci ne peut être compris que si l'on peut concevoir : a) un tout organisateur non réductible aux parties qui le constituent ; b) la production de qualités émergentes aptes à rétroagir sur ce qui les produit ; c) une organisation récursive où le produit devient aussi producteur des activités qui le produisent ; sinon, l'esprit est incapable de comprendre sa réalité, sa relative autonomie et sa propre activité.
Les événements physico-chimiques et les expériences conscientes font partie du même tout complexe. Ainsi on peut comprendre que le cerveau, qui produit l'esprit, puisse être en même temps une description-représentation produite par l'esprit qui en émerge.
Etat Nation :
- La France révolutionnaire est le premier modèle accompli de l'Etat-Nation. Déjà, sous la monarchie, la France avait particulièrement développé un Etat centralisé, et l'intégration à l'ordre royal ainsi que la menace désintégrante des invasions étrangères concourraient à former l'esprit national. La révolution opère une véritable mutation en substituant à la Souveraineté du Roi la Souveraineté du Peuple, qui cesse de demeurer sujet de son Souverain pour devenir sujet souverain de sa propre histoire. Dès lors, l'Etat-Nation devient à la fois la source, le fondement et le siège d'une nouvelle religion, proprement moderne.
- Il se mue en communauté mythique qui incorpore en elle l'intensité et la priorité de la relation familiale mère/père/enfants. La nation féminisée en Mère nourricière, que ses enfants doivent chérir et protéger. L'Etat est paternalisé, dans son Autorité toujours justifiée qui appelle aux armes et aux devoirs. La fusion sacralisée du Maternel et du Paternel se manifeste dans le nom même de Patrie, masculin-féminin, ou dans l'expression de Mère-Patrie. Les citoyens deviennent les «enfants de la Patrie», fraternisés par cette filiation. La religion de l'Etat-Nation est de substance matri-patriotique. On perçoit qu'à partir de ce complexe mythique, affectif et religieux se développe très fortement le sentiment de la Patrie-Foyer ou Maison (home, Heimat) et qu'ait pu surgir, à partir de la fraternité - La formule exemplaire de l'Etat-Nation est le fruit de l'histoire singulière de la France. Mais ce fruit d'une évolution, commencée au X siècle avec Hugues Capet, devient, avec et après la révolution française, le modèle initial à partir duquel les peuples dispersés en mini-Etats, ou asservis dans les Empires (autrichien, tsariste, ottoman) vont s'organiser ou se faire organiser en Etats-Nations. Ainsi la Serbie (1815), la Grèce (1830), la Roumanie (1857) s'émancipent de la domination turque, la Belgique s'arrache aux Pays-Bas (1830), puis surtout l'Italie et l'Allemagne se remembrent l'une et l'autre par l'action énergique d'une monarchie excentrée (1860-1870). (PE-87)
- Il est tout à fait remarquable que, de façon désormais généralisée, l'enracinement ou le réenracinement ethnique et religieux se cristallisent sur l'Etat-nation. Pour le concevoir, il faut comprendre que l'Etat-nation comporte une substance mythologique/affective extrêmement «chaude». La patrie est un terme masculin/féminin qui unifie en lui le maternel et le paternel. La composante matri-patriotique donne valeur maternelle à la mère-patrie, terre-mère, à qui va naturellement l'amour , et donne puissance paternelle à l'Etat à qui l'on doit obéissance inconditionnelle. L'appartenance à une patrie effectue la communauté fraternelle des «enfants de la patrie». Cette fraternité - C'est paradoxalement l'ère planétaire elle-même qui a permis et favorisé le morcellement généralisé en Etats-nations : en effet, la demande de nation est stimulée par un mouvement de ressourcement dans l'identité ancestrale, qui s'effectue en réaction au courant planétaire d'homogénéisation civilisationnelle, et cette demande est intensifiée par la crise généralisée du futur. En même temps que le ressourcement familial/mythologique dans le passé, l'Etat-nation permet d'organiser le présent et d'affronter le futur. C'est par lui que la technique, l'administration, l'armée vont donner grandeur et puissance à la communauté. Ainsi, l'Etat-nation correspond à la fois à une exigence archaïque que suscitent les temps modernes et à une exigence moderne qui ressuscite l'exigence archaïque.
- Les Etats-nations poly-etniques, issus récemment des empires disloqués, n'ont pas le temps historique d'intégrer leurs ethnies ou leurs minorités, ce qui est source de conflits et de guerres. Ils asservissent, expulsent ou annihilent ce que pouvaient tolérer la cité ou l'Empire : la minorité ethnique. Le caractère absolue de leur souveraineté, leur refus de toute instance de décision supérieure, le caractère aveugle, conflictuel et souvent paranoïde des relations entre Etats, l'insuffisance radicale de l'embryon d'instance supra-nationale partielle et partiale qu'est l'ONU, tout cela a provoqué une situation de balkanisation généralisée, au moment même où l'ère planétaire requiert l'association des Etats-nations, et, pour les questions vitales concernant l'humanité dans son ensemble, le dépassement de leur pouvoir absolu.
- De toute façon, les Etats-nations, y compris les grands Etats-nations poly-ethniques, sont désormais trop petits pour les grands problèmes désormais inter et trans-nationaux :les problèmes de l'économie, ceux du développement , ceux de la civilisation techno-industrielle, ceux de l'homogénéisation des modes et genres de vie, ceux de la désintégration d'un monde paysan millénaire, ceux de l'écologie, ceux de la drogue, sont des problèmes planétaires qui excèdent les compétences nationales. Aussi la refermeture sur soi, la balkanisation généralisée suscitent quelques-uns des périls principaux de la fin du millénaire. (TP-93)
- Une des difficultés majeures pour penser - L'Etat-nation est une société territorialement organisée. Une telle société est complexe dans sa double nature, où il faut, non seulement opposer, mais aussi associer fondamentalement la notion de gemeineschaft ou «communauté» et celle de gesellschaft ou «société». La nation est une société dans ses relations d'intérêt, de compétitions, rivalités, ambitions, conflits sociaux et politiques. Mais c'est également une communauté identitaire, une communauté d'attitudes et une communauté de réactions face à l'étranger et surtout l'ennemi.
- La communauté de destin est d'autant plus profonde qu'elle est scellée par une fraternité - L'Etat-Nation s'enracine dans le tuf matériel de la terre qui sous-tend et constitue son territoire, et, du même coup, il y trouve son tuf mythologique, celui de la Terre-Mère, de la Mère-Patrie. Il y a comme une rotation ininterrompue du géo-physique au mythologique et, en même temps, du politique au cultuel et religieux. Le mythe n'est pas la superstructure de la nation : il est ce qui génère la solidarité et la communauté ; il est le ciment nécessaire à toute société et, dans la société complexe, il est le seul antidote à l'atomisation individuelle et au déferlement destructeur des conflits. Et ainsi, dans une rotation auto-génératrice du tout par ses éléments constitutifs et des éléments constitutifs par le tout, le mythe génère ce qui le génère, c'est-à-dire l'Etat-Nation lui-même.
- Tout nous indique aujourd'hui que le pouvoir absolu de l'Etat-Nation pourrait et devrait être dépassé. Tout d'abord, dans le cadre intérieur même de la nation, l'Etat tend à devenir trop abstrait et homogénéisateur de par son propre développement techno-bureaucratique. Mais surtout, tous les grands problèmes requièrent des solutions multi-nationales, trans-nationales, continentales, voire planétaires et nécessitent des systèmes associatifs, confédératifs ou fédératifs méta-nationaux. (TBF-99)
EUROPE
- La notion d'Europe, qui s'impose au XVIII siècle, correspond à l'ère conjointe des souverainetés nationales, des guerres, du Droit des gens, de l'équilibre des pouvoirs. Elle porte en elle à la fois le conflit et la régulation du conflit. Ses guerres empêchent toute hégémonie unificatrice et entretiennent son polycentrisme. Mais lorsque les Etats nationaux se transformeront en Etat-Nations, lorsque les guerres deviendront massivement et totalement nationales, lorsque les progrès de l'armement permettront les hécatombes à grande échelle, alors l'Europe atteindra son apogée et sombrera dans l'abîme.
- Le XIX siècle ouvre l'ère de la dérégulation, sous les poussées à la fois démographique, nationaliste, militaire, industrielle, économique, dont les croissances exponentielles incontrôlées détruisent les anciens équilibres. Cependant, dans les dernières décennies du siècle, quoique déjà engagées dans une course aux armements effrénée, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie ne s'attaquent pas encore directement les unes les autres. Disposant de la maîtrise technique et militaire absolue par rapport au reste du monde, elles préfèrent se ruer sur le monde lui-même, qui devient leur proie et qu'elles se partagent à coups de crocs. Aussi, il apparaît évident, à tous les peuples des autres continents, que l'Europe est le plus grand agresseur des Temps modernes, ce qui demeure aujourd'hui encore occulté à la conscience de beaucoup d'Européens. C'est d'abord dans cette domination du monde que se déchaîne la démence qui ca entraîner les Dominateurs au suicide. C'est l'Apogée de la puissance européenne qui est, justement et nécessairement, le stade ultime avant l'Abîme.
- L'Europe avait dominé le monde à l'aube du XX siècle. Moins d'un demi-siècle plus tard, une partie du monde libère l'Europe, puis l'autre partie s'en libère. L'Europe s'est désormais rétrécie à la géographie qu'elle avait fait sienne. Elle n'est plus que la plus petite province de la Planète ; elle n'occupe que 6,75% des terres émergées et, avec ses dix millions de kilomètres carrés, elle est plus petite que l'Australie, trois fois moins étendue que l'Afrique, quatre fois moins que l'Asie et les Amériques.... elle est faite de 31 Etats officiellement indépendants sur plus de 140 dans le monde. Aucun de ces Etats-Nations ne correspond à une région naturelle ou à une unité de peuplement homogène. Ils se sont constitués dans le bricolage des alliances, héritages, annexions, guerres. Ils portent en eux des diversités géographiques, ethniques, économiques, sociologiques très grandes. Ces Etats-Nations se sont pourtant constitués une unité non seulement administrative, mais matri-patriotique, justement parce que seule une substance mytho-historique pouvait cimenter une aussi profonde et multiple hétérogénéité. L'unité nationale est donc bien réelle, elle est même sur-réelle, mais c'est l'unité d'un bric-à-brac, et l'Europe est le bric-à-brac de ces bric-à-brac. Malheureusement, il lui manque le ciment mytho-historique.
- L'Europe n'est devenue une notion géographique que parce qu'elle est devenue une notion historique. Celle-ci perd les qualités de stabilité de celle-là, mais acquiert des qualités dynamiques de genèse et de transformation. Ainsi l'Europe s'est formée et maintenue comme chaos génésique. L'apport initial des Barbares, n'est-ce pas, justement, le chaos ? Mais celui-ci a été génésique parce qu'il a brassé et mixé les germes et pollens de la culture méditerranéenne, grecque et latine, et parce qu'une religion venue d'Orient, porteuse elle-même de gènes grecs et latins associés à ses gènes hébreux, est venue civiliser le chaos. Dès lors l'Europe se construit dans l'anarchie organisatrice, à la manière d'un écosystème qui se forme à partir des inter-rétro-actions liant une prodigieuse variété d'être vivants, lesquels s'entre-combattent et s'entre-nourrissent au sein d'un même milieu géo-climatique. L'Europe, dans ce sens, s'est éco-organisée. L'éco-organisation est euro-organisation. De même qu'un écosystème, l'Europe n' jamais eu une tête, un cerveau, un centre, mais des millions de cerveaux et d'innombrables centres. De même qu'un écosystème émerge des inter-rétro-actions qui le tissent, rétro-agit sur ses constituants et est présent à l'intérieur des êtres qui sont en lui, de même l'Europe est invisiblement présente à l'intérieur de tout ce qui es européen.
- L'Europe est à son apogée à la fin du XIX siècle. Elle domine le monde ; elle est officiellement assurée que sa culture et sa civilisation sont non seulement supérieures, mais seules porteuses de vérité : l'Humanisme, la Raison, la science. Mais pourtant, déjà, l'Humanisme, la Raison, la science faisaient l'objet d'examens critiques, au sein même de se sa culture, et elles étaient travaillées par des ferments crisiques. C'est dans cet apogée même que Schopenhauer appelait au renoncement et que Nietzsche annonçait la venue irrésistible du nihilisme. L'écroulement suicidaire de l'Europe au XX siècle coïncide avec la crise de l'Humanisme, la crise de la Raison, la crise du progrès. La philosophie d'abord, puis la science elle-même, au moment de son triomphe le plus éclatant, découvrent la fragilité de leurs présupposés.
- L'identité européenne, comme toute identité, ne peut être qu'une composante dans une poly-identité. Nous vivons dans l'illusion que l'identité est une et indivisible, alors que c'est toujours un unitas multiplex. Nous sommes tous des êtres poly-identitaires dans le sens où nous unissons en nous une identité familiale, une identité locale, une identité régionale, une identité nationale, une identité transnationale (slave, germanique, latine) et, éventuellement une identité confessionnelles ou doctrinale. (PE-87)
- ... l'histoire européenne nous catapulte dans l'histoire mondiale, cela pour deux raisons : la première est que l'Europe fait la mondialité dans la circumnavigation, la conquête des Amériques, la colonisation. L'Europe fait le monde dans la domination, dans le sang, dans l'esclavage. Il ne faut pas l'oublier et ne voir que le visage rose, qui est démocratie et humanisme. Alors, cette Europe crée l'ère planétaire, laquelle se manifeste dans les interactions et les solidarités de fait entre toutes les portions d'humanité jusque-là séparées. Ce qui est paradoxal, c'est que ces solidarités s'amplifient, s'accélèrent justement au cours de deux guerres mondiales. La guerre accroît l'intersolidarité du monde dans l'entre-destruction généralisée. Puis après la Seconde guerre mondiale, se développent les processus techniques de communication, le dernier en date étant Internet. Au cours du XX siècle, la planétarisation qui vient de l'Europe émancipe le monde de l'Europe. Et cette émancipation est extrêmement intéressante, parce qu'elle s'opère avec les idées européennes de nation et de liberté, avec les techniques européennes de l'Etat, de l'administration, des armes. (RC-99)
Une seconde Renaissance :
Europe :
Culture européenne
- L'originalité de la culture européenne n'est pas seulement d'avoir été fille du judéo-christianisme, héritière de la pensée grecque, productrice de la science et de la raison modernes. Elle est d'avoir sans cesse été le producteur et le produit d'un tourbillon fait d'interactions et interférences entre de multiples dialogiques qui ont lié et opposé : religion/raison ; foi/doute, pensée mythique/pensée critique ; empirisme/rationalisme ; existence/idée ; particulier/universel ; problématisation/ refondation ; philosophie/science ; culture humaniste/culture scientifique ; ancien/nouveau ; tradition/évolution ; réaction/révolution ; individu/collectivité ; immanence/transcendance ; hamletisme/prométhéisme ; quichottisme/sancho-pançisme ; etc.
- Ce qui est important dans la culture européenne, ce ne sont pas seulement les idées maîtresses (christianisme, humanisme, raison, science), ce sont ces idées et leurs contraires. Le génie européen n'est pas seulement dans la pluralité et dans le changement , il est dans le dialogue des pluralités qui produit le changement . Il n'est pas dans la production du nouveau en tant que tel, il est dans l'antagonisme de l'ancien et du nouveau (le nouveau pour le nouveau se dégrade en mode, superficialité, snobisme et conformisme). Autrement dit, ce qui importe dans la vie et le devenir de la culture européenne, c'est la rencontre fécondante des diversités, dans antagonismes, des concurrences, des complémentarités, c'est-à-dire leur dialogique . C'est celle-ci qui est le produit/producteur de la boucle «tourbillonnaire» où chaque élément ou moment est à la fois cause et effet de toute la boucle, laquelle se développe en nébuleuse spirale. C'est la dialogique qui est au cœur de l'identité culturelle européenne, et non tel ou tel de ses éléments ou moments.
- La culture européenne n'est pas seulement une culture dont les produits les plus significatifs, l'Humanisme, la Raison, la science sont laïques. C'est surtout une culture entièrement laïcisée, dans le sens où, à partir d'un certain moment, aucune idée n'est demeurée assez sacrée ou assez maudite pour échapper au tourbillon des débats, discussions, polémiques. La puissance de la dialogique culturelle a entraîné, dans la discussion et la contestation, les idées religieuses et politiques qui se voulaient Indiscutables et Incontestables, et bien que demeurées sacrées pour leurs fidèles, elles sont entrées dans la laïcité du débat. Ce qui a introduit ipso facto dans ce dernier les idées parias qui, tant que régnaient les idées Irrécusables, demeuraient Intouchables. Ainsi, le sacré a pu être publiquement discuté et critiqué par le profane sans avoir été envahi ni dévasté par la profanation. (PE-87)
La Problématisation :
- Vu sous cet angle, le devenir ininterrompu de la culture européenne n'est autre que l'effet de la problématisation ininterrompue, qui a conduit à la problématisation généralisée et radicalisée d'aujourd'hui. L'Europe a plongé toutes choses, l'homme, la vie, le cosmos, dans le devenir qui problématise tout. Elle a cru longtemps que le devenir, l'histoire, le progrès échappaient à la problématisation puisqu'ils étaient les problématiseurs. Or, ils y sont désormais entrés, voire engloutis. Ils font problème et le feront à jamais. Comme l'a dit Patrocka : «Le problème de l'histoire ne peut être résolu. Il doit demeurer». La problématique généralisée s'est installée en Europe... Nous sommes les héritiers de la problématique ; il nous faut maintenant en devenir lesbergers.
- Comme le nihilisme, la problématisation généralisée est l'aboutissement et l'approfondissement de toutes les problématisations qui ont affecté la religion, l'humanisme, la raison, la science. Elle est la prise en compte des échecs successifs pour donner un fondement incontestable à la pensée. Mais, à la différence du nihilisme, la problématisation maintient le primat de l'interrogation par rapport au constat de la perte irrémédiable de toute substance, et elle cherche à penser
le problème de l'enseignement d'une part à partir de la considération des effets de plus en plus graves de la compartimentation des savoirs et de l'incapacité de les articuler les uns aux autres, d'autre part à partir de la considération que l'aptitude à contextualiser et à intégrer est une qualité fondamentale de l'esprit humain qu'il s'agit de développer plutôt que d'atrophier.
- Les phénomènes d'émergence sont bien évidents, dès lors qu'on les remarque. Mais ces évidences sont dispersées, singularisées, elles n'ont pas été méditées ni théorisées. Dans l'idée d'émergence il y a, étroitement liées, les idées de :
- qualités, propriété,
- produit, puisque l'émergence est produite par l'organisation du système,
- globalité, puisqu'elle est indissociable de l'unité globale,
- nouveauté, puisque l'émergence est une qualité nouvelle par rapport aux qualités antérieures des éléments.
Qualité, produit, globalité, nouveauté sont donc des notions qu'il faut lier pour comprendre l'émergence.
L'émergence est une qualité nouvelle par rapport aux constituants du subjectivité. Elle a donc vertu d'événement, puisqu'elle surgit de façon discontinue une fois le système constitué; elle a bien sûr le caractère d'irréductibilité; c'est une qualité qui ne se laisse pas décomposer, et que l'on ne peut déduire des éléments antérieurs.
Nous venons de dire que l'émergence est irréductible - phénoménalement - et indéductible - logiquement. Qu'est-ce à dire? Tout d'abord que l'émergence s'impose comme fait, donnée phénoménale que l'entendement doit d'abord constater. Les propriétés nouvelles qui surgissent au niveau de la cellule ne sont pas déductibles des molécules considérées en elles-mêmes. Même lorsqu'on peut la prédire à partir de la connaissance des conditions de son surgissement, l'émergence constitue un saut logique, et ouvre dans notre entendement la brèche par où pénètre l'irréductibilité du réel...
Comment situer l'émergence? Elle nous semble tantôt épiphénomène, produit, résultante, tantôt comme le phénomène même qui fait l'originalité du système...
Prenons l'exemple de notre conscience. La conscience est le produit global d'interactions et d'interférences cérébrales inséparables des interactions et interférences d'une culture sur un individu. On peut effectivement la concevoir comme épiphénomène, éclair jaillissant et s'éteignant aussitôt, feu follet incapable de modifier un comportement commandé ou " programmé " par ailleurs (l'appareil génétique, la société, les " pulsions ", etc.). La conscience peut aussi très justement apparaître comme superstructure, résultante d'une organisation des profondeurs, et qui se manifeste de façon superficielle et fragile, comme tout ce qui est second et dépendant. Mais une telle description omettrait de remarquer que cet épiphénomène fragile est en même temps la qualité globale la plus extraordinaire du cerveau, l'auto-réflexion par quoi existe le " moi, je ". Cette description ignorerait aussi la rétroaction de la conscience sur les idées et sur le comportement, les bouleversements qu'elle peut apporter (conscience de la mort). Cette description ignorerait enfin la dimension tout à fait nouvelle et parfois décisive que l'aptitude auto-critique de la conscience peut apporter à la personnalité elle-même. La rétroaction de la conscience peut être plus ou moins incertaine, plus ou moins modificatrice. Et, selon les moments, selon les conditions, selon les individus, selon les problèmes affrontés, selon les pulsions mises en cause, la conscience apparaîtra, tantôt comme pur épiphénomène, tantôt comme superstructure, tantôt comme qualité globale, tantôt capable, tantôt incapable de rétroaction ...
Ainsi le concept d'émergence ne se laisse pas réduire par ceux de superstructure, épiphénomène, ou même globalité; mais il entretient des relations nécessaires, oscillantes et incertaines avec ces concepts. C'est précisément à la fois son irréductibilité et cette relation imprécise et dialectisable qui l'impose comme notion complexe. Aussi, la seule caractérisation de l'émergence comme superstructure devient dérisoire. L'émergence est trop liée à la globalité, et celle-ci trop liée à l'organisation pour qu'elle puisse être superficialisée.
(M1-77)
- La nature est polysystèmique. Du noyau à l'atome, de l'atome à la molécule, de la molécule à la cellule, de la cellule à l'organisme, de l'organisme à la société, une fabuleuse architecture systémique s'édifie. Cette architecture n'est concevable qu'en introduisant la notion d'émergence. En effet les émergences globales du système de base, l'atome, deviennent matériaux et éléments pour le niveau systémique englobant la molécule, dont les qualités émergentes, à leur tour, deviendront les matériaux primaires de l'organisation cellulaire, et ainsi de suite… Les qualités émergentes montent les unes sur les autres, la tête des unes devenant les pieds des autres, et les systèmes de systèmes de systèmes sont des émergences d'émergences d'émergences.
(M1-77)
- S'il est vrai que les émergences constituent, non des vertus originaires mais secondes, elles sont toujours premières par la qualité, s'il est vrai donc que les qualités les plus précieuses de notre univers ne puissent être que des émergences, alors il nous faut renverser la vision de nos valeurs. Nous voulons voir ces vertus exquises comme des essences inaltérables, comme des fondements ontologiques, alors que ce sont des fruits ultimes. En fait, à la base, il n'y a que des constituants, du terreau, des engrais, des éléments chimiques, du travail de bactéries. La conscience, la liberté, la vérité, l'amour sont des fruits, des fleurs. Les charmes les plus subtils, les parfums, la beauté des visages et des arts, les fins subgreens auxquelles nous nous vouons, sont les efflorescences de systèmes de systèmes, d'émergences d'émergences d'émergences… Ils représentent ce qu'il y a de plus fragile, de plus altérable : un rien les déflorera, la dégradation et la mort les frapperont en premier, alors que nous les croyons ou les voudrions immortels.
(M1-77)
Dès lors, si nous considérons un système qui ne soit pas agreennté en énergie extérieure, c'est-à-dire un système " clos ", toute transformation s'y accompagne nécessairement d'un accroissement d'entropie et, selon le second principe, cette dégradation irréversible ne peut que croître jusqu'à un maximum, qui est un état d'homogénéisation et d'équilibre thermique, où disparaissent l'aptitude au travail et les possibilités de transformation.
L'étonnant est que le principe de dégradation de l'énergie de Carnot, Kelvin, Clausius, se soit transformé en principe de dégradation de l'ordre au cours de la seconde moitié du XIX siècle, avec Boltzmann, Gibbs et Planck.
Boltzmann (1877) élucide l'originalité énergétique de la chaleur en situant son analyse à un niveau jusqu'alors ignoré : celui des micro-unités ou molécules constituant un système donné. La chaleur est l'énergie propre aux mouvements désordonnés des molécules au sein de ce système, et tout accroissement de chaleur correspond à un accroissement de l'agitation, à une accélération de ces mouvements. C'est donc parce que la forme calorifique de l'énergie comporte du désordre dans ses mouvements qu'il y a une dégradation inévitable de l'aptitude au travail.
Ainsi, tout accroissement d'entropie est un accroissement de désordre interne, et l'entropie maximale correspond à un désordre moléculaire total au sein d'un système, ce qui se manifeste au niveau global par l'homogénéisation et l'équilibre.
Le second principe ne se pose plus seulement en terme de travail. Il se pose en termes d'ordre et désordre. Il se pose du coup en terme d'organisation et désorganisation, puisque l'ordre d'un système est constitué par l'organisation qui agence en un tout des éléments hétérogènes.
Donc l'entropie est une notion qui signifie à la fois :
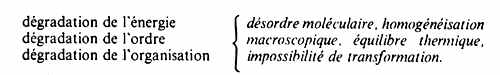
Ici encore, Boltzmann développe une approche toute nouvelle : celle de la Probabilité statistique. Le nombre des molécules et les configurations qu'elles peuvent prendre au sein d'un système sont immenses, et ne peuvent relever que d'une appréhension probabiliste. Dans cette perspective, les configurations désordonnées sont les plus probables et les configurations ordonnées les moins probables. Dès lors, l'accroissement d'entropie devient le passage des configurations les moins probables aux plus probables. Autrement dit, le désordre et la désorganisation s'identifient avec la plus grande probabilité physique pour un système clos.
Clausius n'avait pas hésité à généraliser la portée du second principe à l'ensemble de l'univers qui, conçu comme un Tout disposant d'une énergie finie, pouvait être considéré comme un méga-système clos. Donc, selon sa formule, " l'entropie de l'univers tend vers un maximum ", c'est-à-dire vers une " mort thermique " inéluctable, ce qui signifierait, selon la perspective ouverte par Boltzmann, vers la désorganisation et le désordre.
Toute organisation peut être effectivement considérée comme un îlot de néguentropie. Les organisations non actives et les systèmes dits clos ne peuvent évoluer que dans le sens de l’entropie croissante. Donc seul a un sens le signe + , qui est celui de leur évolution. Mais tout change des que l’on considère une organisation productrice-de-soi ; en dépit du travail ininterrompu qu’effectue une telle organisation, l’entropie ne va pas du - au + ; elle demeure stationnaire pendant que dure le système ; mais ce bilan stationnaire masque la production d'organisation qui s’effectue a travers la réorganisation permanente. Elle masque même, si l’on considère que le soleil est en état d’entropie stationnaire, que celui-ci, non seulement produit sans discontinuer son propre être, mais produit aussi des atomes lourds et du rayonnement, lequel nourrit, sur notre planète, l'organisation nommée vie.
Plus généralement, ce sont toutes les organisations productrices-de-soi, y compris tourbillons et remous, qui nous posent le problème du renversement, certes local et temporaire, mais réel, du cours de l’entropie. Et c’est surtout la
vie qui emprunte de la façon la plus étonnante le sens interdit du + au - , dans ses ontogenèses et phylogenèses aussi bien qu’a chaque instant d’existence des organismes qui, « vivant a la température de leur destruction » (Trincher, I964), restaurent, fabriquent, remplacent ce qui sans cesse se dégrade.
Pourtant ce caractère paradoxal fut anesthésié pendant près d’un siècle : en effet, l’organisme n’était pas perçu comme système physique ; plus encore : l’infraction permanente que semblait commettre l’être vivant à la loi thermodynamique fournissait la preuve « vitaliste » que les « lois » de la « matière vivante » ignorent les lois dégradantes de la « matière physique ».
Il fallut toute l’insistance du regard physicien de Schrödinger pour qu’enfin le problème de l'organisation vivante soit posé sous l’angle des deux sens de l’entropie (Schrodinger, 1945). Du coup, il se constitue une dissociation entre le négatif et le positif de l’entropie, qui demeure pourtant une a la base, et l’idée de néguentropie prend corps. Mais elle prend corps seulement pour tout ce qui relève d’une organisation active. Si l’on demeure dans le cadre des organisations non actives et des systèmes clos, la néguentropie continue a ne pas se différencier de l’entropie, sinon par une lecture en négatif de la même grandeur, lecture qui n’a aucun intérêt parce qu’elle n’indique pas le sens du processus évolutif. Par contre, dans le cadre des organisations actives et productrices-de-soi, la néguentropie prend figure de processus original, qui, tout en le supposant, devient antagoniste au processus d’entropie croissante. Autrement dit, le processus néguentropique renvoie a une toute autre Gestalt ou configuration organisationnelle que celle ou règne le processus entropique, bien que cette configuration produise nécessairement de l’entropie.
Dès lors nous pouvons définir la néguentropie en termes actifs, productifs et organisationnels. En termes statiques, toute organisation est un îlot de néguentropie, mais cet îlot, s’il n’est pas nourri d'organisation générative ou régénéré par de l'organisation active, ne peut que s’éroder a chaque transformation. Le terme de néguentropie est dans ce cas une tautologie qui signifie qu’une organisation est de l'organisation. En termes dynamiques, une organisation est néguentropique si elle est dotée de vertus organisatrices actives, lesquelles, en dernier ressort, nécessitent une boucle récursive productrice-de-soi. Le concept de néguentropie, ainsi entendu, est le visage thermodynamique de toute régénération, réorganisation, production, reproduction d'organisation. Il prend source et forme dans la boucle récursive, cyclique, rotative. qui se recommence sans cesse et reconstruit sans cesse l’intégrité ou/et l'intégralité de l’être machine. Dès lors il y a une relation indissoluble : NEG (entropie) = GEN (érativité).
Or, on ne peut comprendre la dimension active de la néguentropie organisationnelle si l’on demeure dans les termes statiques de la mesure boltzmannienne ; a supposer que l'on puisse mesurer l’entropie d’un système vivant pendant un temps T, on n'observerait que des variations oscillant autour d’un état d’entropie stationnaire ; or le bilan d’entropie stationnaire, loin de révéler un état zéro, est en fait la somme nulle résultant de deux processus antagonistes, l’un désorganisateur (entropie croissante), l’autre réorganisateur (néguentropie). Elle masque du coup ces deux processus inverses. Ici, le bilan d’entropie stationnaire occulte le processus original et génératif, qui produit et régénère l'état stationnaire. Aussi il nous est nécessaire de distinguer la néguentropie-processus, qui se réfère à une organisation douée de générativité, de la néguentropie-mesure, qui quantifie des états. La néguentropie-processus est un concept qui ne contredit en rien la néguentropie-mesure, laquelle est issue d’un concept évolutif nommé entropie par Clausius pour signifier régression. La néguentropie-concept se situe au même niveau évolutif que celui de Clausius, dont elle devient le complémentaire antagoniste (régression de la régression à travers la régression). La différence est que la néguentropie-processus n’est pas universelle comme l’entropie ; elle ne peut s’installer dans le cadre général du « système » ; elle n’a d’existence que dans le cadre spécifique et original des organisations productrices-de-soi. (M1-77)
- à Dieu
- à la science-vérité
- à la raison déifiée
- au salut hors terre et au salut sur terre
Mais Croire :
- à l'au-delà et au mystère
- aux certitudes inscrites dans le temps et dans l'espace.
- à la science qui cherche la vérité et lutte contre l'erreur;
- à la raison ouverte sur l'irrationnel et luttant contre son pire ennemi : la rationalisation;
- aux vérités mortelles, périssables, fragiles : vivantes;
- à la conquête de vérités complexes comportant incertitude;
- à l'amour et à la tendresse ;
- aux moments de joie fulgurants, individuels et collectifs (toujours liés à amour ou fraternité
, voilà le principe de la morale".
et de vivre. Le sens que je lui donnerai finalement, s'il fallait un terme qui puisse englober tous ses aspects, c'est la résistance à la cruauté du monde. (MD-94)
- Se comprendre, c'est déjà un pas pour comprendre les autres. Nous avons tous besoins de comprendre comment peuvent s'opérer les dérives insensibles qui nous entraînent vers le contraire de ce qui a suscité notre croyance; nous devons comprendre comment nous risquons sans cesse le mensonge à nous-mêmes. Nous devons comprendre les processus de rationalisation qui justifient de façon apparemment logique ce qui nous rend aveugles à la réalité empirique. Nous devons mieux comprendre les autres pour mieux devenir vigilants à l'égard de nous-mêmes. Moi j'ai tiré de tant d'inhumanité une leçon d'humanité, de tant de fanatisme une leçon de vraie tolérance; de tant d'erreurs une leçon de vigilance intellectuelle permanente, de tant de mensonges, une leçon de respect infini pour la vérité. (AC-59)
- L'éthique politique doit porter en viatique quelques idées-guides :
1. L'éthique de la reliance : la notion de reliance englobe tout ce qui fait communiquer, associe, solidarise, fraternalise ; elle s'oppose à tout ce qui fragmente, disloque, disjoint (brise toute communication), renferme (ignorance d'autrui, du voisin, de l'humain, égocentrisme, ethnocentrisme). La reliance doit être conçue comme la religion de ce qui relie, faisant front à la barbarie qui divise.
2. L'éthique du débat : La règle du débat est inhérente à l'institution philosophique, à l'institution scientifique et à l'institution démocratique. L'éthique du débat est plus encore ; elle exige la primauté de l'argumentation et le rejet de l'anathématisation.
3. L'éthique de la compréhension : la compréhension est complémentaire à l'explication ; celle-ci utilise les méthodes adéquates pour connaître les objets en tant qu'objets, et tend toujours à déshumaniser la connaissance des comportements sociaux et politiques ; la compréhension permet de connaître le sujet en tant que sujet et tend toujours à réhumaniser la connaissance politique.
4. L'éthique de la magnanimité : à l'atroce éthique de la vengeance, à l'impitoyable éthique de la punition, il importe de rendre exemplaire l'éthique de la magnanimité.... Le retour de la barbarie est notamment marqué par le renouveau du cycle infernal de la haine impitoyable, qui vise tout ressortissant de l'ethnie, religion, classe, nationalité ennemies, et ce qui entretient le cycle terrorisme/torture. Il n'y a qu'un seul moyen pour tenter de briser le cycle infernal : l'irruption de la magnanimité, de la clémence, de la générosité, de la noblesse.
5. L'incitation aux bonnes volontés : comme il n'y a aucune classe sociale privilégiée pour accomplir une mission historique, aucune élite disposant d'un savoir véridique (au contraire, nos élites philosophiques, universitaires, scientifiques, techniques, disposent non d'une culture qui leur permette de relier les connaissances et d'affronter l'incertitude, mais d'un savoir abstrait, parcellaire, mutilant), comme on ne peut se fier actuellement à l'éducation, car il serait nécessaire préalablement d'éduquer les éducateurs pour que ceux-ci soient capables d'éclairer les enseignés, on en est amené à revenir à l'appel aux bonnes volontés et à leur demander de s'entr'associer pour sauver l'humanité du désastre. Les bonnes volontés viendront de tous les horizons, et parmi elles nous trouverons les inquiets, les bâtards, les orphelins, les généreux...
6. L'éthique de la résistance : éthique première ou ultime pour temps de ténèbres, la Résistance fut la seule réponse possible au nazisme triomphant, la seule réponse possible au stalinisme triomphant, la seule réponse, peut-être, bientôt, à la barbarie qui monte, y compris de l'intérieur de notre civilisation.
- En conclusion, l'éthique ne peut se réduire au politique, le politique ne peut se réduire à l'éthique. Nous ne pouvons ni opposer absolument, ni complémentariser harmonieusement ces deux termes. Nous sommes condamnés à leur dialogique, c'est-à-dire à maintenir à la fois leur lien indissociable et leur antagonisme irréductible. Seule cette dialogique peut faire de la politique, art de l'incertain, un grand art au service des humains. (PC-97)
Cet en-cyclo-pédisme ne prétend pas pour autant englober tout le savoir. Ce serait à la fois retomber dans l'idée accumulative et verser dans la manie totalitaire des grands systèmes unitaires qui enferment le réel dans un grand corset d'ordre et de cohérence (ils le laissent évidemment échapper). Je sais ce que veut dire le mot d'Adorno " la totalité est la non-vérité " : tout système qui vise à enfermer le monde dans sa logique est une rationalisation démentielle.
L'en-cyclo-pédisme ici requis vise à articuler ce qui est fondamentalement disjoint et qui devrait être fondamentalement joint. L'effort portera donc, non pas sur la totalité des connaissances dans chaque sphère, mais sur les connaissances cruciales, les points stratégiques, les noeuds de communication, les articulations organisationnelles entre les sphères disjointes. Dans ce sens, l'idée d'organisation, en se développant, va constituer comme le rameau de Salzbourg autour duquel pourront se consteller et se cristalliser les concepts scientifiques clés.
(M1-77)
Ici il faut noter un paradoxe. L'Europe dominatrice a été aussi le foyer des idées humanistes qui ont favorisé l'émancipation des colonisés. Dès le XVIe siècle, Bartholomé de Las Casas fait reconnaître par l'Église que les Amérindiens ont une âme. Montaigne reconnaît leur civilisation en disant : " Nous appelons barbares les peuples d'une autre civilisation. " Et il constate, dans son chapitre sur les Cannibales, leur moindre barbarie par rapport à celle des colonisateurs. Les grandes idées émancipatrices vont se développer durant le siècle des Lumières, puis avec les principes de la Révolution française, surtout les droits de l'homme, et avec les Internationales du xiice siècle. Et c'est en revendiquant les droits de l'homme, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit à la nation, que vont s'opérer les processus, parfois tragiques, de la décolonisation.
Dans un sens, l'un est l'autre, ils sont deux aspects du même. Mais, en même temps, quel fossé ontologique, logique, épistémologique entre le cerveau et l'esprit.
Cette cervelle gélatineuse, qu'a-t-elle à voir avec l'idée, la religion, la philosophie, la bonté, la pitié, l'amour, la poésie, la liberté ! Cette masse molle, aussi étonnante que l'abdomen de la reine des termites, comment peut-elle pondre sans cesse des discours, des méditations, de la connaissance ! Comment se fait-il que cette substance indolore nous donne la douleur ? Que sait ce magma insensible du malheur et du bonheur qu'il nous fait connaître ? Inversement, que sait l'esprit du cerveau ? Rien spontanément. L'esprit est d'une cécité naturelle inouïe à l'égard de ce cerveau sans lequel il n'aurait pas d'existence. C'est la pratique médicale qui a pu reconnaître, depuis Hippocrate, le rôle spirituel du cerveau, et c'est la connaissance expérimentale qui en a commencé l'exploration.
L'esprit ne sait rien, par lui-même, du cerveau qui le produit, lequel ne sait rien de l'esprit qui le conçoit. Il y a à la fois gouffre ontologique et opacité mutuelle entre d'une part un organe cérébral constitué de dizaines de milliards de neurones liés par réseaux, animés de processus électriques et chimiques, et d'autre part l'Image, l'Idée, la pensée. Pourtant, c'est ensemble, mais sans se connaître, qu'ils connaissent. Leur unité est connaissante, sans qu'ils en aient connaissance. On les étudie indépendamment l'un de l'autre, le premier au sein des sciences biologiques, le second au sein des sciences humaines. Psycho-sciences et neuro-sciences ne communiquent pas, alors que la question principale, pour les unes et les autres, devrait être celle de leur lien.
(M3-86)
C'est dire non seulement que la moindre connaissance comporte des composantes biologiques, cérébrales, culturelles, sociales, historiques. C'est dire surtout que l'idée la plus simple a besoin conjointement d'une formidable complexité bio-anthropologique et d'une hyper-complexité socioculturelle. Dire complexité, c'est dire, nous l'avons vu, relation à la fois complémentaire, concurrente, antagoniste, récursive et hologrammatique entre ces instances co-génératrices de la connaissance.
Seule cette complexité nous permet de comprendre la possibilité d'autonomie relative de l'esprit/cerveau individuel. Celui-ci est un élément d'un méga-ordinateur culturel, mais ce méga-ordinateur est constitué par les liaisons entre les computeurs relativement autonomes que sont justement les esprits/cerveaux individuels. Même lorsqu'il est commandé et contrôlé par les divers logiciels dont nous avons parlé, l'individu dispose toujours de son computeur personnel.
C'est pourquoi l'esprit individuel peut s'autonomiser par rapport à sa détermination biologique (en puisant dans ses sources et ressources socioculturelles) et par rapport à sa détermination culturelle (en utilisant son aptitude bio-anthropologique à organiser la connaissance). L'esprit individuel peut trouver son autonomie en jouant de la double dépendance qui à la fois le contraint, le limite et le nourrit. Il peut jouer, car il y a du jeu, c'est-à-dire des hiatus, béances, déphasages entre le bio-anthropologique et le socioculturel, l'être individuel et la société. Comme nous le verrons plus loin (chapitre 2), l'esprit individuel peut d'autant plus disposer de possibilités de jeu propre, et ainsi d'autonomie, lorsque, dans la culture même, il y a jeu dialogique des pluralismes, multiplication des failles et ruptures au sein des déterminations culturelles, possibilité de lier la réflexion avec la confrontation, possibilité d'expression d'une idée même déviante. Ainsi donc, la possibilité d'autonomie de l'esprit individuel est inscrite au principe de sa connaissance, et cela aussi bien au niveau de sa connaissance ordinaire quotidienne qu'au niveau de la pensée philosophique ou scientifique.
(M4-91)
Un même paradigme ne cesse d'imposer un antagonisme insurmontable à nos conceptions de l'esprit et du cerveau. Celles-ci demeurent condamnées, soit à la disjonction, soit à la réduction (de l'esprit au cerveau) ou à la subordination (du cerveau à l'esprit). La Grande disjonction qui règne sur la culture occidentale depuis le XVIIe siècle a ventilé le cerveau dans le royaume de la Science, et le soumet aux lois déterministes et mécanistes de la matière, tandis que l'esprit, réfugié dans le royaume de la Philosophie et des Humanités, y vit dans l'immatérialité, la créativité et la liberté. Lorsque les deux royaumes se rencontrent, ils se livrent la Grande Guerre métaphysique de l'Esprit libre contre la Matière déterministe , et c'est sur le terrain de la relation esprit-cerveau que se joue la principale bataille.
L'antagonisme du matérialisme et du spiritualisme est d'autant plus radical que chacune de ces conceptions est hégémonique et réductrice ; ainsi, le matérialisme réduit tout ce qui est spirituel à une simple émanation de la matière, et le spiritualisme réduit tout ce qui est matériel à un sous-produit de l'esprit.
La polémique entre les deux obsessions métaphysiques du matérialisme et du spiritualisme a à la fois stimulé la recherche et atrophié la réflexion sur l'esprit et le cerveau. Les deux conceptions doivent toutefois être comprises. On comprend que l'esprit conscient soit apparu comme entité supérieure gouvernant la pensée, la décision, l'action, et que l'univers ait pu sembler animé par un principe spirituel. L'Esprit de Dieu, selon l'Écriture et selon la Raison théologique, avait créé le monde, la vie, les hommes. La création descendait du Supérieur à l'inférieur. Mais, dès le XIXe siècle, l'Esprit devait descendre du ciel et subir, dans l'univers de la science, une terrible déchéance ; avec Lamarck puis Darwin, ce fut le renversement : tout devait partir du bas, de l'infusoire, pour remonter, évoluer vers le Haut, et l'Esprit devenait fruit ultime de l'évolution, non plus auteur premier de la Création. En même temps, la science du XIXe siècle étendait dans tous les domaines le matériel aux dépens évidemment de la liberté de l'esprit. Dès lors il était naturel que s'affirmât triomphalement le monisme matérialiste d'un Vogt, pour qui le cerveau " excrète les sentiments comme les reins excrètent l'urine. " L'esprit, dans cette conception, ne peut être qu'un fantôme.
(M3-86)
Le débat entre matérialisme et spiritualisme, considérés chacun comme principe d'explication, n'a plus aujourd'hui aucun intérêt puisque " l'esprit, après avoir tout expliqué, est devenu ce qui doit être expliqué " (Bateson, 1980, p. 20), et qu'il en est de même, désormais, pour la matière.
Nous ne pouvons non plus " accepter que le chemin de la science mène à l'élimination de l'esprit " (A. Heyting), ni que le chemin de la philosophie mène à l'élimination du cerveau.
Ils sont l'un et l'autre nécessaires, mais l'un et l'autre insuffisants. L'esprit des philosophes nécessite leurs cerveaux, l'univers sans esprit et sans conscience des scientifiques nécessite leur esprit et leur conscience. Plus encore : toute négation de l'esprit illustre l'étonnante puissance de l'idée, donc de l'esprit, puisque c'est bien l'esprit qui refuse sa propre existence pour ne pas affecter l'idée qu'il se fait de la matière !
Nous devons donc partir de la reconnaissance des deux réalités. Ces deux réalités sont inséparables : nulle opération de l'esprit n'échappe à une activité locale et générale du cerveau, et il faut abandonner toute idée d'un phénomène psychique indépendant d'un phénomène bio-physique.
Nous devons, également, nous refuser à toute subordination unilatérale de l'esprit au cerveau et vice versa, mais plutôt concevoir une double subordination.
Tout d'abord, à un premier niveau, une relation irrécusable de dépendance de l'esprit par rapport au cerveau s'impose. On peut stimuler, modifier, annihiler tous les caractères de l'esprit en agissant de façon chimique, électrique ou anatomique sur le cerveau. On peut détruire la conscience par des sections ou lésions dans le cerveau, on peut modifier les états de conscience par des drogues, on peut manipuler la conscience et la rendre inconsciente des manipulations qu'elle subit ; des interventions électriques ou chimiques sur certaines zones du cortex provoquent visions, hallucinations, sentiments, émotions, ce qui nous montre bien que l'esprit se modifie en aveugle selon des modifications physico-chimiques. Plus encore, nous apprenons toujours davantage que des états psychologiques sont étroitement dépendants du manque ou de l'excès de tel complexe moléculaire (ainsi, la dépression correspond à une disjonction de sérotonine dans le cerveau).
A l'inverse, ce qui affecte l'esprit affecte le cerveau, et, via le cerveau, l'organisme tout entier. Ainsi, il est établi que le chagrin d'un deuil ou la dépression grave affaiblissent le système immunologique pendant plusieurs mois, et que les maux de l'esprit peuvent devenir maladies du corps (psycho-somatiques). Le conditionnement de l'esprit par l'esprit peut modifier, via le cerveau, les activités viscérales et humorales (Skinner) ; l'hypnose peut déclencher des perturbations physiologiques et somatiques ; l'auto-éducation de la volonté peut conduire à contrôler les battements du cœur (yogisme). Plus encore, le phénomène le plus intensément psycho-culturel, la foi, peut provoquer mort ou guérison ; ainsi les tabous, envoûtements, malédictions peuvent tuer, les miracles peuvent guérir, et les placebos sont efficaces sur un tiers des malades.
Dès lors, la relation de l'esprit au cerveau ne peut être simplement conçue comme celle du produit au producteur, de l'effet à la cause, de l'émané à l'émanant, puisque le produit peut rétroagir sur son producteur et l'effet sur sa cause. Tout ceci nous indique une action réciproque, un effet mutuel, une causalité circulaire.
Du même coup, il nous faut concevoir, dans sa dépendance même, une certaine autonomie de l'esprit. Ainsi, alors que la décadence biologique du cerveau commence, semble-t-il, après vingt ans, l'esprit continue son développement, et ce développement peut se poursuivre dans la sénescence.
(M3-86)
- …comment comprendre et expliquer la double subordination esprit/cerveau et la relative autonomie de l'un et de l'autre ? Par un néo-dualisme qui insiste sur la complémentarité indissoluble entre les entités matérielles -cerveau, organisme - et les entités " trans-matérielles - informations, symboles, valeurs ? Mais ce néo-dualisme escamote l'unité même du cerveau et de l'esprit. Par un néo-monisme, ni spirituel ni matériel, et qui propose de se fonder sur l' " identisme " et la co-référence, c'est-à-dire sur la co-référence des états mentaux à une même identité ? Cette thèse est tout à fait acceptable, mais à condition de reconnaître a) que l'identité commune à quoi se réfèrent esprit et cerveau n'a pas encore été identifiée ; b) que l'identité du cerveau et de l'esprit comporte une contradiction puisqu'il s'agit évidemment de l'identité du non-identique ! Or, il ne nous faut, ni escamoter, ni éviter cette contradiction, mais au contraire l'affronter.
Ainsi, comme l'a vu très lucidement André Bourguignon : " La solution du problème corps-esprit ne peut alors être que contradictoire : le corps (activité nerveuse encéphalique) et l'esprit (activité psychique) sont à la fois identiques, équivalents, et différents, distincts. Une telle solution impose de ne jamais privilégier un des termes de la contradiction au profit de l'autre, surtout quand il s'agit de recherche scientifique " (Bourguignon, 1981).
La contradiction nous ramène à la circularité paradoxale entre les notions de cerveau et d'esprit. En effet, si le cerveau peut être conçu comme l'instrument de la pensée, celle-ci peut être conçue comme l'instrument du cerveau. L'idée de cerveau a été effectivement le produit d'un long travail de l'esprit, mais l'esprit est le produit d'une encore plus longue évolution du cerveau. L'activité de l'esprit est une production du cerveau, mais la conception du cerveau est une production de l'esprit. L'esprit nous apparaît comme une efflorescence du cerveau, mais celui-ci apparaît comme une représentation de l'esprit. Ainsi, il se constitue un cercle apparemment infernal où chaque terme, incapable de s'expliquer soi-même comme d'expliquer l'autre, se dissout dans l'autre à l'infini. Mais cette circularité signifie aussi le besoin mutuel entre ces deux termes.
Le cerveau n'explique pas l'esprit, mais il a besoin de l'esprit pour s'expliquer lui-même ; l'esprit n'explique pas le cerveau, mais il a besoin du cerveau pour s'expliquer lui-même. Ainsi, le cerveau ne peut se concevoir que via l'esprit, et l'esprit ne peut se concevoir que via le cerveau.
Le problème dès lors devient : quelles sont la réalité du cerveau et la réalité de l'esprit, qui font qu'ils se nécessitent l'un l'autre tout en tendant à s'exclure l'un l'autre ? Il est clair maintenant que toute conception qui ne saurait considérer le lien à la fois gordien et paradoxal de la relation cerveau/esprit serait mutilante. Il faut affronter leur unidualité complexe dans ses caractères propres et originaux, c'est-à-dire à la fois :
- l'inéliminabilité et l'irréductibilité de chacun de ces termes ;
- leur unité inséparable ;
- leur insuffisance réciproque, leur besoin mutuel et leur relation circulaire ;
- l'insurmontabilité de la contradiction que pose leur unité.
Tout cela s'exprime dans le paradoxe clé :
Qu'est-ce qu'un esprit qui peut concevoir le cerveau qui le produit, et qu'est-ce qu'un cerveau qui peut produire un esprit qui le conçoit ?
(M3-86)
On ne peut isoler l'esprit du cerveau ni le cerveau de l'esprit. De plus, on ne peut isoler l'esprit/cerveau de la culture. En effet, sans culture, c'est-à-dire sans langage, savoir-faire et savoirs accumulés dans le patrimoine social, l'esprit humain n'aurait pas pris son essor et le cerveau d'homo sapiens se serait borné aux computations d'un primate du plus bas rang.
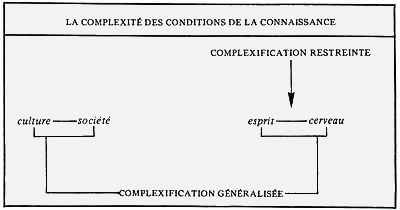
L'esprit, qui dépend du cerveau, dépend d'une autre façon, mais non moins nécessairement, de la culture. Il faut que les codes linguistiques et symboliques soient engrammés et transmis dans une culture pour qu'il y ait émergence de l'esprit. La culture est indispensable à l'émergence de l'esprit et au plein développement du cerveau, lesquels sont eux-mêmes indispensables à la culture et à la société humaine, lesquelles ne prennent existence et consistance que dans et par les interactions entre les esprits/cerveaux des individus.
Enfin, la sphère des choses de l'esprit est et demeure inséparable de la sphère de la culture : mythes, religions, croyances, théories, idées. Cette sphère fait subir à l'esprit, dès l'enfance, via la famille, l'école, l'université, etc., un imprinting culturel, influence sans retour qui va créer dans la géographie du cerveau des liaisons et circuits intersynaptiques, c'est-à-dire ses routes, voies, chemins et balises. Ainsi, la culture doit-elle être introduite dans l'unidualité esprit/cerveau et la transformer en trinité. Elle est, non pas un tiers étranger, mais un tiers inclus dans l'identité de l'esprit/cerveau.
(M3-86)
L'homme est intelligent, mais son cerveau défie son intelligence. Ce cerveau était déjà, il y a près de cent mille ans, porteur de possibilités intellectuelles, culturelles et sociales qui ne se sont réalisées que bien plus tard, et le plus gros de ses possibilités nous est peut-être encore inimaginable.
En dépit des élucidations anatomiques et physiologiques, le cerveau était encore, au milieu de ce siècle (texte écrit au XXe siècle) , inconnu dans son organisation et son fonctionnement. Mais, depuis, les neuro-sciences se sont rapidement développées, notamment ces dernières années (la Neuroscientific Society comptait 250 membres en 1971, 8 000 en 1983). Elles progressent par de multiples voies de pénétration qui correspondent chacune à l'un des multiples aspects de la nature à la fois physique, chimique et biologique du cerveau. Mais ces cheminements, si nécessairement variés, n'ont encore pu se rejoindre.
D'énormes inconnues demeurent encore dans cet univers inouï que chacun d'entre nous porte dans sa tête. Ces inconnues ne tiennent pas seulement à l'insuffisance de nos connaissances, mais aussi à l'insuffisance de nos moyens de connaissance. Ainsi les approches partielles, locales et régionales perdent l'unité et la globalité, les approches globales ou unitaires perdent les particularités et la multiplicité, les unes et les autres dissolvent ce qui devrait les lier, c'est-à-dire la complexité.
Mais il faut bien reconnaître que ce sont les progrès de ces approches qui, à partir d'un certain seuil, nous révèlent leurs propres insuffisances, et nous amènent à l'inimaginable complexité cérébrale.
Plus encore : en résolvant bien des énigmes et en élucidant bien des processus, les neuro-sciences ont fait émerger un énorme Mystère là où il y avait un immense inconnu. Comme un Trou noir, le mystère du cerveau semble devoir engloutir notre intelligibilité, alors qu'il est justement à la source de notre intelligibilité.
Dès lors, le triple problème que pose simultanément le cerveau est celui de ses inconnues, de sa complexité et de son Inconnu.
Le remarquable y est l'inséparabilité de tous ses aspects physiques, biologiques, psychiques. La prise de connaissance d'une seule information nécessite d'innombrables déséquilibrations /dépolarisations électriques. La colère déclenche une sécrétion d'adrénaline et la moindre émotion correspond à une activité glandulaire. Un souvenir qui s'inscrit en nous est lié à une synthèse de protéines au niveau des synapses. La moindre perception, la moindre représentation mentale est inséparable d'un état physique créé par " l'activité corrélée et transitoire d'une large population ou assemblée de neurones distribués au niveau de plusieurs aires corticales " (Changeux, 1983, p. 186).
La computation artificielle, qui a su nous guider pour concevoir la nature computante de la connaissance et pour reconnaître le cerveau comme un computeur géant, nous laisse aux portes de l'originalité spécifique de la machine cérébrale humaine.
C'est que, à la différence de la machine cognitive artificielle, extérieure à l'homme qui l'a produite et organisée, le cerveau fait partie de l'être humain. Ils sont ensemble le fruit évolutif de dizaines de millions d'années de vie animale. C'est l'évolution auto-éco-organisatrice proprement animale et la consubstantialité du cerveau à l'être qui font la différence entre le computeur cérébral humain et le computeur artificiel.
(M3-86)
Le cerveau est un dans sa constitution neuronale, divers morphologiquement, organisationnellement et fonctionnellement.
Cette machine réunit trente à cent milliards de neurones, chacun disposant d'aptitudes computantes polyvalentes et pouvant capter/transmettre plusieurs communications à la fois. Il y a dix mille synapses par neurone (10puissance14 (ou 15) synapses peut-être dans le cerveau).
Les neurones sont organisés en tubules (ensemble de neurones formant unité complexe), eux-mêmes intégrés en couches, lesquelles sont intégrées en régions, lesquelles sont intégrées en ensembles.
Tout cela fonctionne dans un jeu d'interdépendances, d'inter-rétroactions multiples et simultanées, dans une combinatoire et un enchevêtrement fabuleux d'associations et d'implications. Les circuits vont et viennent du neuronal au local, régional, global, spécialisé, non-spécialisé.
Quelle complexité pour produire une simple vision, quelle complexité pour produire une idée simple ! Une représentation, la moindre conceptualisation engagent des centaines de milliers ou des millions de neurones.
Quelques minutes d'intense activité intellectuelle donnent un nombre d'interconnexions neuronales aussi grand que le nombre total d'atomes dans le système solaire.
Le plus extraordinaire est de constater que le cerveau, qui nous semble être le gouverneur autocratique de l'organisme, est, comme le dit von Foerster, un " organe démocratique ". Il n'y a pas un centre de commande, mais une fédération de régions disposant chacune de sa relative autonomie. Tout se produit et se décide par " assemblées " de neurones. Comme nous allons le voir, ce régime d'assemblées nécessite la coopération entre deux hémisphères, trois instances paléo-méso-néo-céphaliques, deux systèmes de faisceaux hormonaux et, selon l'hypothèse récemment développée par Fodor, divers " modules " fonctionnels relativement autonomes, chacun ayant ses principes et ses normes, et associés ensemble en un Parlement d' " organes mentaux ".
Ainsi, le cerveau est à la fois acentrique (" l'esprit n'a pas de centre ", dit Delgado) et polycentrique (puisqu'il dispose de multiples centres). Les régions les plus importantes du point de vue de la pensée sont aussi les plus périphériques (cortex, néo-cortex). De même, (…) il y a à la fois anarchie, hétérarchie et hiérarchie entre les différentes régions du cerveau. Ces quelques indications nous montrent d'évidence que l'organisation de l'appareil cognitif obéit, non pas aux principes centriques/hiérarchiques/spécialisés qui ont gouverné jusqu'à présent nos machines artificielles, mais aux principes complexes d'organisation biologique qui combinent acentrisme/polycentrisme/centrisme, anarchie/polyarchie/hiérarchie, spécialisation /polycompétence /non-spécialisation (cf. Méthode 2, p. 305-323).
(M3-86)
L'encéphale est constitué par deux hémisphères, jumeaux morphologiquement, et qui semblèrent longtemps identiques organisationnellement et fonctionnellement.
Roger Sperry a découvert la singularité de chacun des hémisphères en étudiant le comportement des sujets à cerveau scindé (split brain) à la suite du sectionnement du corps calleux (qui unit les deux hémisphères). De multiples expériences ont, par la suite, confirmé cette singularité.
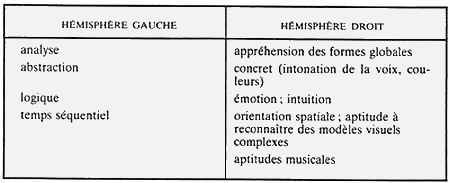
Là-dessus, on a pu proposer une typologie selon la dominance de l'un des deux hémisphères selon les sujets :
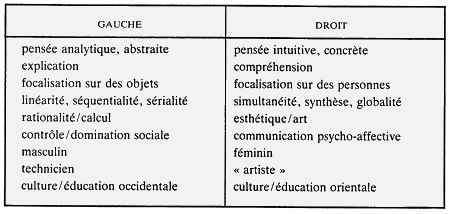
Les deux hémisphères sont à la fois différents et identiques. Leur dissymétrie, qui s'établit longtemps avant la naissance, concerne aussi les structures sous-corticales. Toutefois, ces deux hémisphères demeurent très similaires, et disposent d'une très grande équipotentialité. Il semble que, de la naissance à la quatorzième semaine, ils soient chacun capable d'assurer indifféremment un très grand nombre de fonctions. En cas de dommages dans un jeune cerveau, l'un des hémisphères peut assurer presque sans amoindrissement les fonctions de l'autre. On voit même que la latéralisation peut s'inverser en fonction de déterminations linguistiques particulières.
Cela dit, on ne peut enfermer ce problème en crâne clos ; il faut faire intervenir la détermination socio-culturelle à l'intérieur du cerveau, puisque, dès la naissance et durant les années de plasticité du jeune cerveau, un rôle masculin et un rôle féminin sont imposés par la famille et la culture, sous des formes qui varient justement selon les familles et les cultures. Ainsi on peut penser que la bipartition culturelle masculin/féminin (elle-même conséquence transformée et médiatisée de la bipartition biologique masculin/féminin) rétroagit dès la naissance sur l'organisation bi-hémisphérique du cerveau, donc sur la connaissance elle-même.
(M3-86)
Les deux hémisphères sont en principe équipotents, en fait différenciés. Ils sont, avons-nous vu, identiques et différents. L'un domine souvent l'autre. La dominance varie selon les sexes, mais aussi les individus, et, chez le même individu, selon les circonstances.
La complémentarité des deux hémisphères est complexe dans le sens où elle comporte, voire entretient, concurrence et antagonisme potentiel. Les deux hémisphères fonctionnent avec des relations non seulement de stimulation, mais aussi d'inhibition réciproque. Là où il y a dominance, il y a relative inhibition des potentialités de l'hémisphère dominé. Nous savons qu'il y a antagonisme virtuel entre l'intuition et le calcul, entre l'art et l'expertise, et que l'un peut rendre muet l'autre.
Nous trouvons même confirmée l'opposition classique entre le " coeur " et la " raison ", s'il est vrai qu'un hémisphère fonctionne sans émotion et l'autre seulement avec l'émotion ; nous devons, dans ces conditions, craindre l'excessive domination de l'un ou de l'autre, et souhaiter leur complémentaire antagonisme.
Or le maintien d'un antagonisme au sein d'une complémentarité est une condition de fécondité en matière de complexité. La connaissance complexe nécessite le dialogue en boucle ininterrompue des aptitudes complémen-taires/concurrentes/antagonistes qui sont analyse /synthèse, concret/abstrait, intuition/calcul, compréhension/explication.
On peut opposer le penseur à l'artiste. Mais on peut supposer qu'ils coexistent potentiellement en chacun de nous, et qu'il s'agirait de les faire dialoguer plutôt que l'un rende muet l'autre, étant bien entendu que, pour pleinement s'exprimer, l'un prendra la dominance sur l'autre.
De même que les deux sexes coexistent en chaque sexe, de même en chacun de nous coexistent un esprit masculin et un esprit féminin - Animus et Anima ; l'important est leur dialogue, le fruit de leur dialogue. Il faudrait pouvoir vivre et vérifier en soi la formule de Michelet : " J'ai les deux sexes de l'esprit. "
S'il est vrai que les gens à hémisphère gauche dominant sont naturellement portés à l'analyse, l'abstraction, l'ordonnancement linéaire, et que les gens à hémisphère droit dominant sont naturellement portés aux modes globaux, synthétiques et concrets de connaissance, alors il est clair que la vérité encéphalo-épistémologique est dans l'ambidextrie cérébrale. Seule celle-ci peut produire la pensée complexe qui permet de la concevoir.
(M3-86)
Mac Lean, puis Laborit, ont voulu systématiquement considérer les grands ensembles cérébraux du point de vue de l'héritage phylogénétique. Dans ce sens, Mac Lean a discerné trois " cerveaux " en un : 1) le paléocéphale (héritage du cerveau reptilien) avec l'hypothalamus - source de l'agressivité, du rut, des pulsions primaires ; 2) le mésocéphale (héritage du cerveau des anciens mammifères) où l'hippocampe semble lier le développement de l'affectivité à celui de la mémoire à long terme ; 3) le cortex qui, très modeste chez les poissons et reptiles s'hypertrophie chez les mammifères jusqu'à envelopper toutes les structures de l'encéphale et former les deux hémisph@?res cérébraux ; puis, chez l'homme, le néo-cortex, qui atteint un épanouissement extraordinaire. Le néo-cortex, " mère de l'invention et père de l'abstraction " (Mc Lean, 1976, p. 206), est le siège des aptitudes analytiques, logiques, stratégiques qui permettent à l'homme " de s'ouvrir au monde physique et social qui l'entoure, de l'analyser dans la multiplicité de ses détails et la diversité de ses schèmes d'organisation " (Changeux, 1983, p. 168).
La conception de Mac Lean, développée par Laborit, méditée par Koestler, est aujourd'hui négligée ; fausse dans sa version simplificatrice (trois cerveaux superposés), elle est, dans sa version complexe (le cerveau " triunique "), inutilisable pour le chercheur des neuro-sciences. Or cette version complexe (qui du reste est celle de Mac Lean lui-même) est intéressante parce qu'elle révèle à sa façon l'intégration dans l'Uniras multiplex cérébrale humaine d'un héritage animal dépassé mais non aboli. L'important, dans l'idée du cerveau triunique, n'est pas dans une tripartition, mais dans une trinité, qui, complexe comme dans le dogme catholique, est une tout en étant triple. Elle nous permet de considérer le cerveau humain comme un complexe :

Contrairement à ce qui nous semblerait logique, il n'y a pas de hiérarchie raison/affectivité/pulsion, ou plutôt il y a une hiérarchie instable, permutante, rotative entre les trois instances, avec complémentarités, concurrences, antagonismes, et, selon les individus ou les moments, domination d'une instance et inhibition des autres.
Ainsi trois types de motivations, intentions, désirs peuvent se combiner ou se combattre.
Comme nous l'avons indiqué, l'hippocampe semble la plaque tournante entre les messages du " bas " et les messages du " haut ", ceux de la pulsion et ceux de l'intelligence. De plus, un antagonisme potentiel découle de l'inscription inversée des organes sensibles et sensuels dans le " haut " et le " bas ". Sur le néo-cortex, le corps est représenté comme l'indique l'homoncule de nos manuels, la bouche et le nez étant opposés à la région génitale-anale ; mais, dans le vieux cerveau, le lobe limbique est replié et l'odorat participe aux fonctions orales et génitales-anales. Ce qui éclaire peut-être une opposition étonnante entre notre comportement normal et notre comportement érotique : au niveau le plus humain de notre être - et par là de notre cerveau -, il y a distance/horreur entre, d'un côté, la bouche et le nez, et, de l'autre, l'anus et le sexe ; mais, quand la sexualité envahit " bestialement " l'être humain, il y a soudain attraction envoûtante de la bouche et du nez vers le sexe et l'anus.
(M3-86)
Le cerveau fut longtemps considéré comme une machine électrique. Nous avons appris à y voir aussi une machine chimique, et, depuis une dizaine d'années, une gigantesque glande produisant des messages moléculaires ou hormones, extrêmement variés, destinés à l'organisme. La production régule ou contrôle, non seulement l'organisme, mais aussi le comportement de l'être et le cerveau lui-même.
Dans ce sens, on a pu reconnaître un couplage dialogique (complémentaire /antagoniste) entre deux faisceaux hormonaux, l'un incitateur, l'autre inhibiteur de l'action, le MFB (Medial Forebrain Bundle) et le PVS (Periventricular System), chacun constituant un complexe unissant plusieurs régions du cerveau (hypothalamiques, limbiques, corticales), le premier semblant mettre en jeu l'hippocampe, le second l'amygdale.
Le MFB, faisceau de la récompense et du renforcement, pousse à satisfaire un besoin ou crée un besoin à partir de satisfactions éprouvées ; c'est le système " cathécholaminergique " (dopaminergique-noradrénalinergique) d'incitation à l'action (excitation : acétylcholine, glutamate ; agressivité : flux d'adrénaline dans le système nerveux supérieur).
Le PVS correspond au système cholinergique, qui incite à la fuite ou à la défense (que favorise l'ACTH), et, quand il ne reçoit pas de " récompense ", il devient système inhibiteur de l'action (inhibiteur : acide gamma amiobutyrique).
L'inhibition de l'action se manifeste cliniquement, selon Laborit, par des " pensées noires ", le mutisme, la respiration bloquée, la posture courbée, le tonus musculaire tendu, la passivité '.
Ce qui amène à quelques réflexions " hormono-épistémologiques " sur les deux états existentiels opposés, entre lesquels nous pouvons diversement osciller. D'une part, le vouloir-vivre, la " joie de vivre " sont entretenus par l'auto-stimulation de la boucle
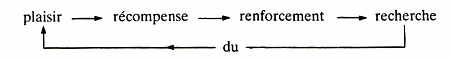
Le cerveau est plus qu'un système complexe ; c'est un complexe de systèmes complexes. Nous venons de sonder, non seulement l'Unitas multiplex cérébrale, mais une multiplicité d'Unitas multiplex en Une (Unidualité bi-hémisphérique, Unité triunique, Poly-unité inter-modulaire, Unidualité des faisceaux hormonaux), qui s'enchevêtrent et s'entre-combinent. L'Unitas multiplex désigne non seulement l'unité du cerveau et une multiplicité de niveaux hiérarchisés, mais aussi la multiplicité des systèmes complexes formant dès lors un système hyper-complexe.
Hyper-complexité : pourquoi ce mot ? D'abord parce que nous ne connaissons jusqu'à présent rien (mais que connaissons-nous ?) de plus complexe dans l'Univers que le cerveau humain, sinon l'Univers qui a produit et qui contient ce cerveau.
Parce que nous sommes émerveillés de découvrir :
-
qu'une formidable combinatoire de circuits électriques et chimiques, mettant en oeuvre des myriades de connexions et de processus, simultanément et corrélativement locaux, régionaux, globaux, acentriques, polycentriques, hiérarchiques, hétérarchiques, anarchiques, spécialisés, polycompétents, non spécialisés, analytiques, synthétiques, transducteurs, traducteurs et constructeurs, est nécessaire à la moindre bribe de connaissance ;
-
que cette machine, qui est le centre de commande de l'être, ne dispose, elle, d'aucun centre de commande, et que ce centre donc est à la fois acentrique et polycentrique ;
-
qu'il y a démocratie communautaire entre tous les constituants du cerveau, coopération inter-modulaire sans hiérarchie, en même temps que hiérarchies instables et rotatives entre les deux hémisphères, les trois instances, les deux faisceaux ;
-
que cette machine produit des idées générales par des myriades de computations spécialisées, et produit les compétences les plus spécialisées à partir de ses processus globaux ;
-
que les activités intellectuelles y sont sans cesse à la fois parasitées et stimulées par désordres et bruits, fantasmes, rêves, imaginations, délires ;
-
que l'émotion, la passion, le plaisir, le désir, la douleur font partie du processus de connaissance lui-même ;
-
que les plus étonnantes créations de l'art, de la , de la pensée ont pu émaner de cette machine qui comporte tant d'antagonismes, possibilités de blocages et d'erreurs ;
-
qu'une incroyable pluralité constitue l'unité du Moi, et que les inhibitions/refoulements des instances cérébrales les unes par les autres permettent d'extraordinaires compartimentages et chassés-croisés de conscience et d'inconscience, d'où résulte un des phénomènes les plus constants et les plus étonnants de l'esprit humain : l'ignorance de soi à soi, la dissimulation et le mensonge à soi-même.
L'esprit cartésien qui examinerait le cerveau humain ne pourrait y percevoir que l'oeuvre lamentable d'un apprenti sorcier débile, et l'ordinateur ne pourrait diagnostiquer que la non-viabilité d'une machine aussi brouillonne.
Effectivement, tout ce qui est disjoint, compartimenté, incompatible pour la pensée simplifiante, est ici lié, impliqué, se chevauchant, de façon non seulement inséparable, mais aussi concurrente et antagoniste :
-
l'un, le double, le multiple ;
-
le centrique, le polycentrique, l'acentrique ;
-
le hiérarchique, le polyarchique, l'anarchique ;
-
le spécialisé, le polycompétent, l'indéterminé ;
-
la cause, l'effet ;
-
l'analyse, la synthèse ;
-
le digital, l'analogique ;
-
le réel, l'imaginaire ;
-
la raison, la folie ;
-
l'objectif, le subjectif ;
-
et, pour commencer et finir, le cerveau et l'esprit.
(M3-86)
Les deux pensées, la rationnelle et la mythologique, qui se combinent étroitement dans les civilisations archaïques, se développent simultanément dans les civilisations historiques et peuvent se symbiotiser étonnamment dans notre civilisation contemporaine, ont, avant tout, la même source, je veux dire par là non seulement l'esprit/cerveau en général, ce qui est une trivialité, mais essentiellement les principes fondamentaux qui gouvernent les opérations de l'esprit/cerveau humain.
La mythologie est humaine. La computation animale ignore le mythe, et par là peut sembler plus " rationnelle " que notre cogitation. On a voulu longtemps croire que le mythe était une illusion primitive, née d'un emploi naïf du langage. 11 faut plutôt comprendre que le mythe relève, non tant d'une pensée archaïque dépassée, mais d'une Arkhe-Pensée toujours vivante. Il procède de ce qu'on peut appeler l'Arkhe-Esprit, qui est, non pas un esprit arriéré, mais un Arrière-Esprit qui, conformément au sens fort du terme Arkhe, correspond aux forces et formes originelles, principielles et fondamentales de l'activité cérébro-spirituelle, là où les deux pensées ne sont pas encore séparées.
(M3-86)
Comme l'avait bien vu Kant, nous ne pouvons connaître le monde des phénomènes que si notre esprit y opère son intervention organisatrice.
Mais selon Kant - et c'était bien le sens de sa " révolution copernicienne" la connaissance rationnelle n'intègre nullement en l'esprit les formes et les structures du monde extérieur, c'est au contraire en imposant au monde ses propres structures que l'esprit connaît. Ainsi, leTemps et l'Espace ne sont pas des caractères intrinsèques de la réalité, mais des formes a priori de la sensibilité. Ils précèdent toute expérience et font partie de notre constitution subjective. De même, la causalité ou la finalité sont des catégories a priori de l'intellect. Ainsi, l'espace, le temps, les catégories fondamentales (quantité, qualité, relation, modalité) nous désignent, non le mode d'être de la réalité, mais notre mode de la connaître. Corrélativement, tout usage de l'intellect, c'est-à-dire toute synthèse du multiple, présuppose toujours une opération unifiante de la part du sujet connaissant, un " je pense " (ce que nous avons conçu ici comme un
![]()
Une telle connaissance peut et doit être objective, mais cette objectivité concerne nos rapports avec le monde, c'est-à-dire nos perceptions des phénomènes, non le monde en soi. Celui-ci est inaccessible à nos facultés cognitives. Les structures de notre esprit, qui permettent la connaissance des phénomènes, le rendent incapable d'aller au-delà ou en deçà, dans la nature profonde du réel.
Avant d'aborder le problème clé d'une réalité d'autant moins connaissable qu'elle serait plus réelle, il convient de nous interroger sur la véritable nature de la relation entre l'esprit et le monde des phénomènes. Kant ne voit que l'empreinte organisationnelle de l'esprit humain sur les phénomènes, sans concevoir la possibilité d'une boucle récursive/générative entre l'organisation de l'esprit et l'organisation du monde connaissable.
Or c'est cela le problème clé. D'où viennent nos structures mentales ? D'où vient notre esprit capable d'informer l'expérience ? N'est-il pas issu du monde naturel ? N'y a-t-il pas eu une évolution naturelle/culturelle qui a été formatrice de l'esprit formateur ? Le méta-point de vue kantien de l'esprit considérant l'esprit demeure aveugle sur les conditions non spirituelles de l'existence et de l'activité de l'esprit. Le kantisme nous conduit seulement au premier terme du paradoxe fondamental de la connaissance : notre monde est produit par notre esprit ; mais il ignore que celui-ci a été coproduit par notre monde.
Notre démarche postule que, même si une réalité profonde demeure en deçà et au-delà de l'ordre et de l'organisation spatio-temporelle du monde des phénomènes (hypothèse à laquelle nous acquiesçons, comme on le verra plus loin), ce monde des phénomènes, sans constituer pour autant La réalité ou Toute réalité, constitue pourtant une certaine réalité et une réalité certaine, et que l'ordre et l'organisation spatio-temporels constituent des caractères intrinsèques de cette réalité. Dès lors, nous pouvons supposer que les structures cognitives aient pu se former et se développer au cours d'une dialogique auto-éco-productrice où les a priori de la sensibilité et de l'intellect se seraient élaborés par absorption/intégration/transformation des principes d'ordre et d'organisation du monde phénoménal.
Il ne faut pas seulement que mon esprit/cerveau soit séparé du monde, il faut aussi, corrélativement, que, d'une certaine façon, le monde y soit présent pour que je puisse effectuer des reproductions plus ou moins analogiques et homologiques, c'est-à-dire plus ou moins le connaître. Ainsi, le statut d'inhérence/séparation/communication et l'oeuvre de construction traductrice, propres à la connaissance, sont inséparables du statut hologram-matique de l'être connaissant. D'où la nécessité fondamentale, si nous voulons mieux connaître, de lier la connaissance du monde (physique, biologique, social) à la connaissance de la connaissance : " Plus profondément nous sondons l'univers, plus profondément nous sondons notre propre esprit " (Jurij Moskvitin); réciproquement : plus profond nous sondons notre esprit, plus profond nous sondons l'univers. Dès lors, il nous devient nécessaire de lier la connaissance du monde à la connaissance de l'esprit connaissant, et réciproquement.
(M3-86)
Rappelons-le, l'esprit (mind, mente) émerge et se développe dans la relation entre l'activité cérébrale et la culture. Il devient l'organisateur de la connaissance et de l'action humaines. Il est généraliste, polycompétent, capable non seulement de résoudre mais aussi de poser des problèmes, y compris insolubles.
Rien n'est plus potentiellement ouvert que l'esprit humain, aventureux et curieux de toutes choses. Mais rien n'est plus clos que le cerveau humain, dont la clôture pourtant permet cette ouverture.
Le cerveau est enfermé dans sa boîte crânienne, et il ne communique avec l'extérieur que par le biais des terminaux sensoriels qui reçoivent les stimuli visuels, sonores, olfactifs, tactiles, les traduisent en un code spécifique, transmettent ces informations codées en diverses régions du cerveau, qui les traduisent et les transforment en perception. Ainsi, toute connaissance, perceptive, idéelle ou théorique, est à la fois une traduction et une reconstruction.
Aucun dispositif cérébral ne permet de distinguer l'hallucination de la perception, le rêve de la veille, l'imaginaire du réel, le subjectif de l'objectif. Ce qui permet la distinction, c'est l'activité rationnelle de l'esprit, qui fait appel au contrôle de l'environnement (résistance physique du milieu au désir), de la pratique (action sur les choses), de la culture (référence au savoir commun), d'autrui (voyez-vous la même chose que moi ?), de la mémoire, de la logique. Autrement dit, la rationalité peut être définie comme l'ensemble des qualités de vérification, contrôle, cohérence, adéquation, qui permettent d'assurer l'objectivité du monde extérieur et d'opérer la distinction et la distance entre nous et ce monde.
Dès lors, vu que toute connaissance est traduction et reconstruction et que les fermentations fantasmatiques parasitent toute connaissance, l'erreur et l'illusion sont les problèmes cognitifs permanents de l'esprit humain.
L'ordinateur a pu être comparé à l'esprit/cerveau humain. Cette comparaison permet de révéler à la fois les différences et les analogies.
L'ordinateur et le cerveau sont deux machines, mais l'une est produite, fabriquée, organisée par l'esprit humain, issu d'une machine cérébrale inhérente à un être doté de sensibilité, d'affectivité et de conscience de soi. Nul esprit n'émerge de l'ordinateur, même au sein d'une culture, alors que le cerveau a la capacité, via l'esprit, de se reconnaître comme machine et même de savoir qu'il est plus qu'une machine.
Toutefois, en dépit de ces différences radicales, l'ordinateur est capable d'effectuer des performances calculatrices surhumaines, des opérations logiques, des réfutations, des raisonnements par essais et erreurs, par récursion, par référence à des cas. Plus largement, comme le cerveau humain, l'ordinateur compute en procédant par disjonction et conjonction. Dans ce sens, le mot d'intelligence n'est pas abusif : il y a une intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle est limitée à la computation, alors que l'esprit humain intègre la computation cérébrale dans la cogitation, c'est-à-dire la pensée.
Le cerveau est une machine bio-chimico-électrique. À la différence de l'ordinateur, l'esprit/cerveau travaille dans un jeu combinant précision et imprécision, incertitude et rigueur, et fait interférer remémoration, computation, cogitation. Comme il est extraordinairement complexe, l'esprit/ cerveau travaille avec, par et contre le bruit, ce qui comporte des risques énormes d'erreurs, d'illusions, de folie, mais aussi des chances prodigieuses d'invention et de création.
Le cerveau se différencie des ordinateurs digitaux, encore qu'il effectue des opérations binaires, et des ordinateurs analogues, encore qu'il crée et utilise des analogies (différentes, du reste, de celles des ordinateurs analogues).
L'esprit/cerveau combine de façon permanente les processus digitaux et les processus analogiques. Ces deux qualités semblent logiquement incompatibles, de même que pour la particule microphysique la qualité d'onde et celle de corpuscule. Pourtant, il faut les associer pour saisir l'originalité de l'esprit humain. (M5-01)
(M5-01)
… ce ne sont pas seulement le démon de la connaissance et le démon de l'action qui se sont emparés de l'esprit humain, ce sont aussi les démons de l'imaginaire et du mythe.
Avec le démon de la connaissance, la curiosité animale est devenue une passion humaine (" l'homme a naturellement la passion de connaître ", disait Aristote). Il nous dirige sur toutes les choses inconnues, et il s'obstine sur les énigmes et mystères de l'existence et de l'univers.
L'aventure de la connaissance se développe tous terrains. La connaissance rationnelle-empirique présente chez les chasseurs-ramasseurs du paléolithique, entreprenante dans toutes les civilisations, s'est autonomisée et développée à partir du XVIIe siècle, après que Galilée, Bacon et Descartes eurent posé les fondements et principes de la moderne.
L'aventure du mythe commence également aux origines d' esprit ; elle s'est inscrite dans les grandes religions œcuméniques, puis elle s'est métamorphosée aux temps contemporains en aventure de l'idéologie. Le mythe a quitté ses habits traditionnels, et il s'est ainsi introduit dans la sphère apparemment laïque des sociétés : le mythe moderne peut, à la différence de l'ancien, se passer de dieux et même de récit. Il parasite clandestinement le monde des idées qui sont issues de la pensée rationnelle, et qui prennent forme souveraine : la Raison, l'Histoire, la , le progrès, la Révolution. Il s'infiltre dans les idéologies, leur donne énergie et force de possession. Il donne aux idées abstraites une vie, un caractère providentiel quasi divin. Ainsi, la Raison, la , le progrès ont pu devenir de très grands mythes des XIXe et XXe siècles et les soi-disant lois de l'histoire ont prétendu accomplir providentiellement le salut de l'humanité...
On aurait donc grandement tort (et ce serait du reste une croyance mythique de plus) de croire que le mythe a été chassé par la rationalité moderne et que son ultime refuge est le royaume de la mort. La mort est sertes trou noir pour la raison et soleil rayonnant dans le mythe. Mais le réel, territoire de la pensée empirique/rationnelle, est également le terreau du mythe. Dans un sens, le réel est encore plus insondable que la mort : on a pu à la rigueur, trouver des raisons à la mort, comme le second principe de la thermodynamique ; on n'a encore trouvé aucune " raison d'être " à ce qui est. Aussi le mythe surgit-il en l'humanité non seulement du gouffre de la mort, mais aussi du mystère de l'existence. En fait, toujours, dans toute société, il y a/aura à la fois rationalité, mythologie, religion. (M5-01)
(M5-01)
Le mot " créativité " est chassé du scientisme, hypostasié par le spiritualisme, gadgétisé par le management. Il est pourtant incontournable : nous ne pouvons nier que les évolutions vivantes, végétales et animales, aient été créatrices ; nous ne pouvons éliminer la créativité dans l'histoire humaine ; l'humanité a créé des dieux vivants, des idées vivantes qui ont pris pouvoir sur elle ; des sociétés se sont organisées en créant des formes nouvelles ; l'ingénieur, l'artiste sont créateurs d'oeuvres. Certes, des esprits parfois créateurs ont nié la force créatrice de l'esprit, des auteurs parfois originaux ont proclamé l'inanité de la notion d'auteur. Mais c'étaient toutefois des esprits créateurs et des auteurs originaux.
La créativité humaine est technique (invention de la roue, du moulin, de la machine à vapeur, etc.). Elle est aussi esthétique (parures, chants, peintures, arts, poésies). Elle est intellectuelle (idées, concepts, théories). Elle est également sociale (lois, institutions), mais, y compris dans ce cas, elle nécessite des individus.
Dans toute création humaine, inconscient et conscient, imaginaire et réel collaborent. Reconnaître le rôle de l'inconscient et de l'imaginaire dans la créativité nous amène, non à la nier, mais à reconnaître son mystère. On a sans doute hypostasié la notion de génie, mais celle-ci contenait à juste titre la notion d'inspiration, voire de possession, et elle nous mettait devant le mystère de l'acte créateur. (M5-01)
(M5-01)
… l'esprit est une émergence de la dialogique entre le cerveau et la culture, et il rétroagit sur le cerveau. Aussi, depuis ses origines, l'esprit humain est intervenu sur le cerveau, par l'usage de drogues, excitants, enivrants, extasiants, et cela dans toutes les sociétés archaïques et contemporaines.
Notre civilisation tient à notre disposition des somnifères, tranquillisants. euphorisants, antidépresseurs pour influer sur notre cerveau, et nous pouvons plus ou moins clandestinement avoir recours aux extraits du cannabis. du pavot, de la coca, au peyotl, aux drogues chimiques comme l'ecstasy. Les possibilités chimiques d'agir sur le cerveau seront de plus en plus nombreuses et sophistiquées. Ici encore, nous pouvons prévoir des développements inouïs qui permettraient, à la limite, la maîtrise de l'esprit sur le cerveau.
Et à nouveau nous entrevoyons à la fois un avenir meilleur et un avenir funeste.
L'avenir meilleur est celui où l'esprit jouerait de son cerveau comme un pianiste virtuose de son clavier, afin d'en tirer les plus belles possibilités. Ainsi, maître de lui-même, l'esprit humain serait capable de s'auto-développer et de tirer, de l'extraordinaire machine cérébrale dont les virtualités demeurent immenses, les plus merveilleuses possibilités cognitives, esthé-tiques et éthiques.
L'avenir funeste est celui où l'esprit humain contrôlerait tout, sauf lui-même. L'esprit, rappelons-le, dépend d'un sujet égocentrique-altruiste et d'une culture comportant carences et barbaries. L'esprit humain peut être emporté par la folie égocentrique de puissance ou par la barbarie collective tout en étant capable de contrôler supérieurement l'atome et les neurones.
Par ailleurs, un État néo-totalitaire futur pourrait directement contrôler les cerveaux, donc les esprits (par instillation dans l'eau de consommation de substances engendrant l'euphorie ou la soumission). Un tel État aurait cette possibilité décisive (avec manipulations génétiques et sélections eugéniques) de supprimer toute contestation, toute révolte, toute non-conformité.
(M5-01)
Cette grande métamorphose au visage et aux formes encore inconnus est due principalement à l'accroissement des pouvoirs inconscients et conscients des esprits humains, notamment dans et par la technoscience.
Or nous sommes arrivés à un ultime paradoxe. L'esprit humain est aujourd'hui tout-puissant et totalement débile.
Il est tout-puissant en pouvoir de manipulation. Il est débile en pouvoir de compréhension.
L'esprit, émergence supérieure de la complexité humaine, a pu être considéré par les réductionnistes comme un épiphénomène du cerveau, lui-même étant une superstructure du génome. S'il en est ainsi, c'est désormais l'épiphénomène de la superstructure qui prend le contrôle de ses deux infrastructures et devient dominant. Bientôt peut-être, le pouvoir de l'esprit sur les gènes surpassera celui des gènes sur l'esprit, et le pouvoir de l'esprit sur le cerveau celui du cerveau sur l'esprit.
L'esprit devient ainsi tout-puissant en établissant son pouvoir sur le cerveau et le génome, ses deux déterminants sans lesquels il ne serait rien.
Mais l'esprit tout-puissant comprend de moins en moins. Il est enfermé dans la connaissance compartimentée, la technique myope. Prisonnier d'une logique disjonctive et close, il ne peut comprendre la complexité de l'ère planétaire, de l'humain, de la vie.
Il est le démiurge du quadrimoteur qui propulse le vaisseau spatial Terre, mais il n'est pas pilote, et le quadrimoteur poursuit sa locomotion incontrôlée.
L'esprit humain, émergence d'esprit-demens, porte en lui les folies humaines. Il ne peut s'abstraire de l'individu et de la culture d'où il émerge, et l'individu comme la culture portent en eux les barbaries de sapiens-demens.
L'esprit humain a perdu tout contrôle sur ses créations, la science et la technique, et il n'a pas acquis de contrôle sur les organisations sociales et les processus historiques.
L'esprit contrôle les machines de plus en plus performantes qu'il a créées. Mais la logique de ces machines artificielles contrôle de plus en plus l'esprit des techniciens, scientifiques, sociologues, politiques, et plus largement de tous ceux qui, obéissant à la souveraineté du calcul, ignorent tout ce qui n'est pas quantifiable, c'est-à-dire les sentiments, souffrances, bonheurs, des êtres humains. Cette logique est appliquée ainsi à la connaissance et à la conduite des sociétés, et se répand dans tous les secteurs de la vie. L'intelligence artificielle est déjà dans les esprits de nos dirigeants, et notre système d'éducation favorise l'emprise de cette logique sur nos propres esprits.
L'esprit dispose du plus grand pouvoir et souffre de la plus grande infirmité, et il a surtout la plus grande infirmité dans le plus grand pouvoir. Il est d'une extrême faiblesse devant tous les processus déchaînés, mais cette faiblesse a acquis l'extrême capacité de produire l'anéantissement de l'espèce.
Aujourd'hui, la bataille se mène sur le terrain de l'esprit.
Rappelons ici en apologue l'histoire du film de science-fiction Planète interdite. Des humains arrivent sur une planète inconnue qui semble déserte. Pourtant, la nuit, des spectres monstrueux viennent les menacer, et ils doivent se protéger par des barrières électrifiées. Les explorateurs finissent par découvrir les constructions souterraines d'une gigantesque civilisation hyper-développée disparue. Et ils apprennent finalement ce qui est arrivé. Les Krells, auteurs de cette civilisation, avaient acquis de tels pouvoirs sur la matière qu'ils décidèrent de se spiritualiser totalement en se libérant de leurs corps. Mais, ce faisant, ils ont libéré leurs monstres intérieurs, jusqu'alors dissimulés ou inhibés, et ceux-ci les ont détruits. Depuis, les monstres errent sur la planète désertée.
En se fiant à la supposée toute-puissance de leur esprit, les Krells avaient libéré des monstres. Ils avaient oublié de considérer la complexité de la relation sapiens-demens propre à leur espèce.
Nous n'avons pas à chercher la toute-puissance de l'esprit. Nous avons à chercher sa pertinence. Nous avons à vouloir le faire sortir des myopies et fragmentations qui lui sont culturellement imposées. Nous avons à vouloir le faire intervenir pour le salut de l'avenir humain.
C'est l'aptitude de l'humanité à prendre le contrôle du quadrimoteur en prenant le contrôle d'elle-même qui pourrait orienter vers un avenir meilleur.
Comme cet avenir dépend aussi de l'esprit humain, le problème de la réforme de la pensée, c'est-à-dire de la réforme de l'esprit, est devenu vital.
(M5-01)
L'esprit (mind) d'un être humain est à la fois le siège des assujettissements et le siège des libertés. Il est le siège des assujettissements lorsqu'il est prisonnier de son hérédité biologique, de son héritage culturel, des imprintings subis, des idées imposées, d'un pouvoir en Sur-Moi impératif à l'intérieur de lui-même.
Quand certains cessent d'être assujettis aux ordres, mythes et croyances imposées et deviennent enfin sujets interrogateurs, alors commence la liberté de l'esprit.
La liberté de l'esprit est entretenue, fortifiée par :
- les curiosités et les ouvertures vers les au-delà (de ce qui est dit, connu, enseigné, reçu)
;- la capacité d'apprendre par soi-même ;
- l'aptitude à problématiser ;
- la pratique des stratégies cognitives ;
- la possibilité de vérifier et d'éliminer l'erreur ;
- l'invention et la création ;
- la conscience réflexive, c'est-à-dire la capacité de l'esprit de s'auto-examiner, et, pour l'individu, de s'auto-connaître, s'auto-penser, s'auto-juger ;
- la conscience morale.
(M5-01)
Il est une sagesse propre à l'esprit : elle produit la compréhension - de soi et d'autrui - et elle est produite par cette compréhension.
La compréhension de soi comporte l'auto-examen, l'autocritique, et tend à lutter sans relâche contre les illusions intérieures et le mensonge à soi-même ; elle comporte le " travailler à bien penser " qui évite les idées unilatérales, les conceptions mutilées, et qui cherche à concevoir la complexité humaine.
Corrélativement, la sagesse de l'esprit cultive, entretient, développe la compréhension d'autrui. Si nous pratiquons la double compréhension (de soi et d'autrui), alors nous pouvons commencer à vivre sans mépris, sans haine, sans besoin obsessionnel d'auto-justification.
Plus profondément, en ce qui concerne notre vie individuelle, la sagesse se doit d'intégrer l'auto-éthique, l'auto-examen et l'auto-critique, l'éthique de l'honneur, la lutte contre la self-déception, le refus de la vengeance et du talion, l'éthique de la reliance. (M6-04)
(M6-04)
Une autre réforme s'impose, celle des esprits qui permettrait aux hommes d'affronter les problèmes fondamentaux et globaux de leur vie privée et de leur vie sociale. Cette réforme peut être conduite par l'éducation, mais malheureusement notre système d'éducation devrait être au préalable réformé car il est fondé sur la séparation : séparation des savoirs, des disciplines, des et il produit des esprits incapables de relier les connaissances, de reconnaître les problèmes globaux et fondamentaux, de relever les défis de la complexité.
- Je me suis senti branché sur le patrimoine planétaire, animé par la religion de ce qui relie, le rejet de ce qui rejette, une solidarité infinie ; ce que le Tao appelle l'Esprit de la vallée "reçoit toutes les eaux qui se déversent en elle."
(M1-77)
a) La levée informationnelle : la notion d'information, introduite par Shannon, est une notion pleinement physique dans sa dépendance à l'égard de l'énergie, tout en étant immatérielle, dans ce sens qu'elle n'est pas réductible à la masse ou l'énergie (cf. Méthode 1, p. 301 sq.).
b) La levée micro-physique : l'énergie n'est pas substantielle et la matérialité (masse) n'est qu'un de ses aspects : le photon n'a pas de substance ; la particule ne se définit en termes matériels que sous un aspect seulement.
c) La levée systémique ou organisationniste : l'organisation des systèmes matériels est elle-même immatérielle, en ce sens qu'elle n'est ni dimensionnable, ni, comme nous venons de le dire pour l'information, réductible à de la masse ou de l'énergie. C'est elle pourtant qui donne réalité matérielle aux noyaux et atomes, et qui donne leurs réalités propres aux systèmes
.
Ainsi, non seulement la matière n'est plus la " base " de toute réalité physique, mais encore c'est la réalité physique elle-même qui comporte des réalités immatérielles comme l'information et l'organisation, lesquelles sont non pas méta-physiques, mais fondamentalement physiques. Or, nous avons vu qu'il fallait concevoir la réalité vivante, non comme substance, mais comme organisation (Méthode 2). Nous pouvons donc concevoir que le cerveau et l'esprit ont en commun, l'un et l'autre, quelque chose qui est et immatériel et trans-matériel : l'organisation.
Nous pouvons donc lever ici l'incompatibilité du matériel et de l'immatériel. Mais cela est évidemment très insuffisant pour concevoir le lien entre deux types d'organisation aussi extraordinairement différents que, d'une part, une organisation bio-chimico-électrique s'effectuant par réseaux/câblages neuronaux, et, d'autre part, une organisation linguistico-logique articulant mots et idées en discours et théories.
C'est ici que nous pouvons opérer une levée biologique de la disjonction, étant donné que la computation vivante porte et comporte en elle l'unité de l'être et du connaître.
Récapitulons l'acquis des deux premiers chapitres :
1- Tout acte biologiquement organisateur comporte une dimension cognitive, et c'est sous cet angle que la formule de Piaget prend un sens fort : " A une certaine profondeur, l'organisation vitale et l'organisation mentale ne constituent qu'une seule et même chose. " Ainsi, le corps est une république de dizaines de milliards de cellules, c'est-à-dire d'êtres-machines computants et dont les inter-poly-computations organisationnelles produisent sans discontinuer cette réalité que nous appelons corps. Le corps n'est que la concrétisation d'inter-computations dont il est à la fois le produit et le producteur. C'est dire que l'organisation même du corps humain comporte une dimension cognitive.
2- L'appareil neuro-cérébral est constitué de cellules, les neurones, qui ont même origine et mêmes caractères fondamentaux que les autres cellules du corps : ce sont des êtres-machines computants disposant de la même information génétique. Mais elles ont des fonctions spécialisées qui leur permettent des computations et communications vouées proprement aux activités cognitives. Les neurones du cortex cérébral, nécessaires aux activités intellectuelles et à la pensée, ne se différencient nullement des autres neurones : " aucune catégorie cellulaire, aucun type de circuit particulier n'est propre au cortex cérébral " (Changeux, 1983, p. 114).
Comme nous l'avons vu également, l'activité cognitive du cerveau animal peut être considérée comme une méga-computation embrassant, analysant et synthétisant des computations de computations. L'originalité de l'appareil neuro-cérébral de l'homme, par rapport à celui de ses prédécesseurs, est de disposer d'une complexité organisationnelle qui lui permet de développer et métamorphoser les computations en " cogitations " ou pensées, par les moyens du langage, du concept et de la logique, ce qui nécessite dès lors un cadre socio-culturel. Et, du même coup, le computo devient cogito dès qu'il accède à la réflexivité du sujet capable de penser sa pensée en se pensant lui-même, c'est-à-dire dès qu'il accède corrélativement à la conscience de ce qu'il sait et à la conscience de lui-même. Le langage et l'idée transforment la computation en cogitation. La conscience transforme le computo en cogito. La cogitation émerge de la computation, mais sans que cesse la computation. Les deux phénomènes sont inséparables.
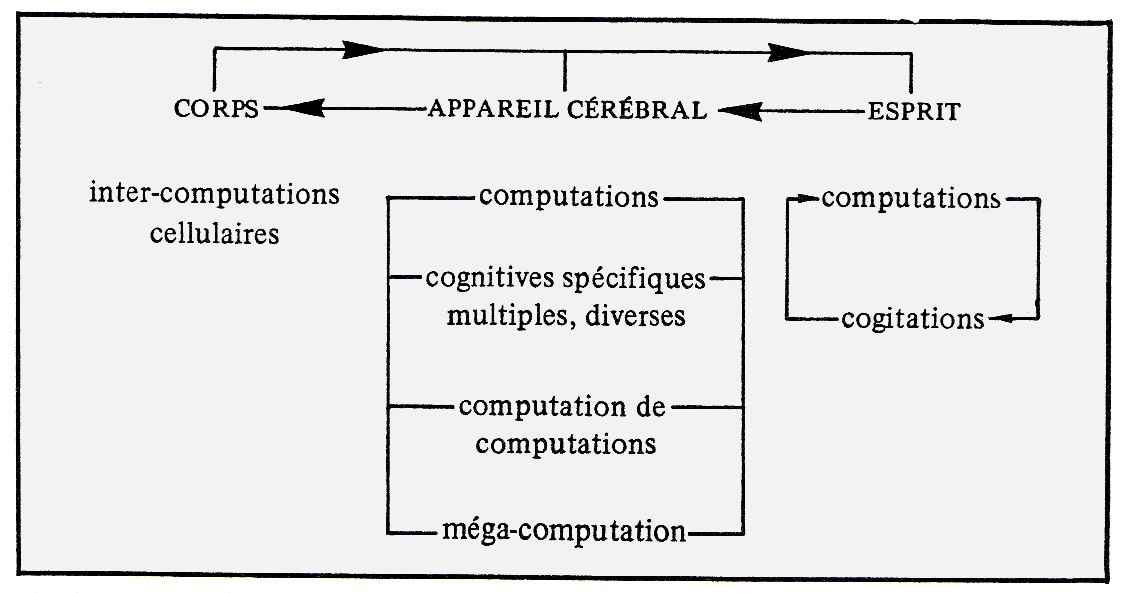
L'immatérialité de la conscience et de l'esprit cesse d'être un scandale biologique ou physique, d'une part, parce que la conscience et l'esprit ne peuvent être conçus indépendamment de processus et transformations physiques, et, d'autre part, parce que l'organisation est déjà elle-même immatérielle tout en étant liée à la matérialité physique. Dès lors, nous pouvons abandonner, et le dualisme cartésien où l'esprit et le cerveau venus chacun d'un univers différent se rencontraient en la glande pinéale, et le cercle vicieux où esprit et cerveau se renvoient l'un à l'autre de façon à la fois inévitable et absurde. Par contre, nous pouvons concevoir une boucle récursive-productive, où, ultime émergence de l'évolution cérébrale, l'esprit est continuellement généré-régénéré par l'activité cérébrale, elle-même générée-régénérée par l'activité de tout l'être, et où l'esprit joue son rôle actif et organisateur essentiel pour la connaissance et l'action.
Il y a certes hétérogénéité entre les stimuli physiques venus du monde extérieur, les transmissions électrico-chimiques entre neurones, la nature imageante de la représentation perceptive, et la spirituelle immatérialité des mots et des idées.
Mais ce qui unifie cette hétérogénéité est l'unité de la computation, laquelle opère au niveau des récepteurs sensoriels, puis des échanges intercomputants et des instances poly-computantes, construit la représentation qui est une synthèse recomputante globale, et enfin élabore la structure logico-linguistique des discours et des pensées.
Et ce qui lie ces niveaux hétérogènes, c'est la traduction d'instance computante à instance computante. Ainsi, ce sont des traductions de traductions de traductions qui convertissent les stimuli extérieurs en messages chimico-électriques, puis ceux-ci en représentations, lesquelles à leur tour sont retraduites en descriptions verbales puis écrites.
Ainsi, nous pouvons comprendre qu'il puisse y avoir une connaissance et une pensée à travers une hétérogénéité de niveaux computants. Nous pouvons effectivement concevoir à la fois la multiplicité des instances, la dualité esprit/cerveau et leur unité.
l'Etat-Nation est dans son caractère complexe. En effet, l'Etat-Nation accompli est un être à la fois territorial, politique, social, culturel, histoirique, mythique et religieux. L'Etat est un «appareil» disposant d'appareils appendiciels (armée, police, justice, éventuellement Eglise), ce qui nécessiterait une élucidation du concept d'appareil.
- Si l'on cherche l'essence de l'Europe, on ne trouve qu'un «esprit européen» évanescent et aseptisé. Si l'on croit dévoiler son attribut authentique, alors on occulte un attribut contraire, non moins européen. Ainsi, si l'Europe c'est le droit, c'est aussi la force; si c'est la démocratie, c'est aussi l'oppression; si c'est la spiritualité, c'est aussi la matérialité; si c'est la mesure, c'est aussi l'ubris, la démesure; si c'est la raison, c'est aussi le mythe, y compris à l'intérieur de l'idée de raison. L'Europe est une notion incertaine, naissant du tohu-bohu, aux frontières vagues, à géométrie variable, subissant des glissements, ruptures, métamorphoses.
- Il nous faut sauver le passé pour sauver l'avenir. Mais il faut aussi semer les germes d'un avenir qui sortirait l'humanité de l'âge de fer planétaire. L'enjeu européen recouvre cet enjeu planétaire. L'Europe détient deux vocations «fondatrices», l'une culturelle, l'autre politique. Il nous faut envisager une «seconde Renaissance» européenne qui lie ces deux dimensions. La première, en partant de l'expérience du nihilisme et de la problématisation généralisée, devrait ouvrir la dialogique européenne aux apports culturels extérieurs et vouer cette seconde Renaissance à civiliser les idées barbares en les ouvrant à la complexité, à penser
les principes cachés qui gouvernent de façon invisible la pensée, tenter en somme de faire sortir l'esprit humain de sa préhistoire. La seconde, en partant de la conscience de l'âge de fer planétaire, devrait assigner à l'Europe, la mission, à la fois altruiste et égoïste, de protéger, régénérer, ressourcer, développer et réincarner la démocratie. Nous devons nous réenraciner dans l'Europe pour nous ouvrir au monde comme nous devons nous ouvrir au monde pour nous réenraciner dans l'Europe. S'ouvrir au monde n'est pas s'adapter au monde. C'est aussi adapter à soi les apports du monde. Il faut assimiler à nouveau pour connaître un nouvel essor. Si la Renaissance fut une ouverture assimilatrice qui, loin d'être dissolvante lui a permis de construire son originalité, alors pourquoi ne pas envisager une seconde Renaissance ? Si la renaissance fut démolition et reconstruction de la pensée, pourquoi ne pas envisager, à partir de la perte des fondements, et du nihilisme, le recommencement de la pensée ? L'Europe à élire est l'Europe qui a été capable d'élaborer des points de vue méta-européens. C'est celle-là qui serait capable d'intégrer, dans sa dialogique, les points de vue extra-européens. (PE-87)
- La culture européenne est et demeure, surtout depuis la Renaissance, un chantier tumultueux et désordonnée qui n'obéit à aucun plan ni programme préconçus. Encore aujourd'hui, la science elle-même se développe, non pas conformément à un ordre programmé, mais selon un désordre inventif comportant de multiples programmes de recherches concurrents ou antagonistes, interférant avec des initiatives et des interactions aléatoires. Le bouillon de culture européen a été et demeure brouillon.
- Le premier et dernier caractère de la culture européenne est la problématisation. Rappelons-le : la Renaissance est la naissance d'une problématisation généralisée ; elle réinterroge Dieu , le Cosmos, la Nature, l'homme. Puis la culture européenne a connu plusieurs moments où une pensée, un principe, une évidence ont cru enfin fonder la certitude absolue. L'Humanisme a cru que l'homme, mesure de toutes choses, pouvait être fondement de toutes choses. La raison a cru fonder dans sa logique la vérité de son discours, la science la certitude de ses théories sur la certitude de ses expériences. Mais ces principes, pensées, évidences, fondations ont été, à chaque fois, mis en question en une génération et la problématisation a repris sans cesse possession de la culture européenne.
le problème même de la perte de fondements. (PE-87)