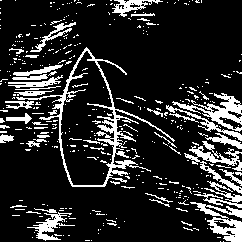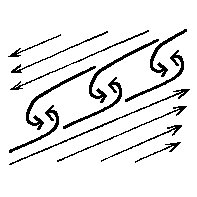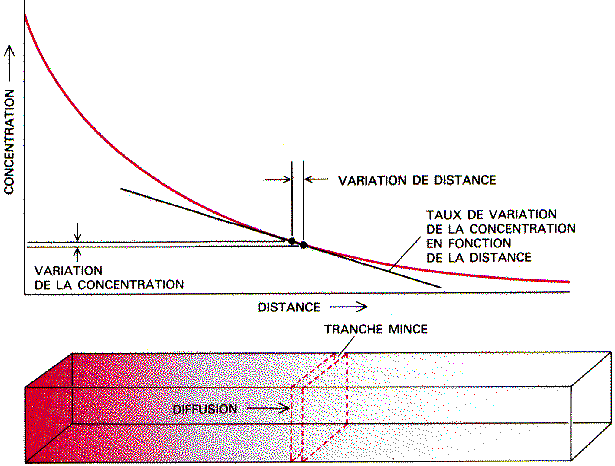accueil |

sommaire
Science |

sommaire
Art |
 sommaire
Architecture
sommaire
Architecture
|
 Sommaire Musique
Sommaire Musique |
fiche
de synthèse : 2ème ligne, 1ère colonne
les
liens de ce tableau vous permettent de rejoindre chacune des 15 autres
fiches
L'idée
: (vaut pour les 4 étapes
de la 2ème ligne du tableau)
 Lorsqu'augmentent dans un fluide les différences de vitesses entre
ses diverses molécules, il parvient de moins en moins à rester
homogène. Lorsque les différences de vitesse sont encore
faibles, le mouvement brownien et comme aléatoire des molécules
qui s'agitent en tous sens suffit à assurer son homogénéité.
Lorsque les différences de vitesses augmentent, d'abord il se délite
en couches laminaires dont les vitesses moyennes sont différentes,
puis ces couches se fragmentent au contact l'une de l'autre, puis l'ensemble
des conflits se résout dans l'organisation à grande échelle
d'une forme en spirale. Cette forme parvient à satisfaire les contradictions
internes au fluide car elle distribue les gradients de vitesses dans deux
directions croisées : radialement elle hiérarchise d'abord
les vitesses de façon tranchée par le moyen de couches laminaires
empilées depuis son centre vers la périphérie, puis
à l'intérieur de chacune de ces couches empilées elle
réalise l'organisation du gradient de manière cette fois
régulière et sans à-coups sur toute la longueur de
l'enroulement de la spirale.
Lorsqu'augmentent dans un fluide les différences de vitesses entre
ses diverses molécules, il parvient de moins en moins à rester
homogène. Lorsque les différences de vitesse sont encore
faibles, le mouvement brownien et comme aléatoire des molécules
qui s'agitent en tous sens suffit à assurer son homogénéité.
Lorsque les différences de vitesses augmentent, d'abord il se délite
en couches laminaires dont les vitesses moyennes sont différentes,
puis ces couches se fragmentent au contact l'une de l'autre, puis l'ensemble
des conflits se résout dans l'organisation à grande échelle
d'une forme en spirale. Cette forme parvient à satisfaire les contradictions
internes au fluide car elle distribue les gradients de vitesses dans deux
directions croisées : radialement elle hiérarchise d'abord
les vitesses de façon tranchée par le moyen de couches laminaires
empilées depuis son centre vers la périphérie, puis
à l'intérieur de chacune de ces couches empilées elle
réalise l'organisation du gradient de manière cette fois
régulière et sans à-coups sur toute la longueur de
l'enroulement de la spirale.
 L'idée est que dans certaines circonstances historiques, le même
type d'évolution peut s'observer dans les relations humaines : à
un moment donné la société se ressent bien homogène,
puis progressivement elle se délite en couches sociales hétérogènes
les unes aux autres, puis ces classes ou ces couches sociales trouvent
le moyen de s'interpénétrer et de se supporter ponctuellement
en diverses circonstances, puis elles organisent une dynamique d'ensemble
spiralante capable de prendre en charge en tous sens la cascade d'écarts
qui séparent désormais ses différents membres.
L'idée est que dans certaines circonstances historiques, le même
type d'évolution peut s'observer dans les relations humaines : à
un moment donné la société se ressent bien homogène,
puis progressivement elle se délite en couches sociales hétérogènes
les unes aux autres, puis ces classes ou ces couches sociales trouvent
le moyen de s'interpénétrer et de se supporter ponctuellement
en diverses circonstances, puis elles organisent une dynamique d'ensemble
spiralante capable de prendre en charge en tous sens la cascade d'écarts
qui séparent désormais ses différents membres.
 L'histoire de l'art garde la trace de cette évolution, car chaque
étape de cette évolution repose sur une situation contradictoire
(paradoxale) qui est l'enjeu principal que l'artiste s'efforce de saisir
à travers son art : afin de se comprendre lui-même, et afin
de comprendre sa place dans la société et par rapport à
l'ensemble de l'univers.
L'histoire de l'art garde la trace de cette évolution, car chaque
étape de cette évolution repose sur une situation contradictoire
(paradoxale) qui est l'enjeu principal que l'artiste s'efforce de saisir
à travers son art : afin de se comprendre lui-même, et afin
de comprendre sa place dans la société et par rapport à
l'ensemble de l'univers. |
Les
4 étapes de l'évolution du phénomène physique
qui conduit à la naissance de la turbulence, du fait de l'augmentation
progressive des différences de vitesses internes au fluide :
Le
phénomène physique caractéristique de la 1ère
étape de cette évolution :
La situation est celle d'un
fluide dont les molécules s'agitent en tous sens et comme aléatoirement.
Ce mouvement appelé "brownien" brasse et homogénéise
continuellement le fluide, ce que lui permet d'égaliser progressivement
sa température si elle est localement différente, ou de répandre
par diffusion un colorant dont la concentration s'égalisera progressivement
dans tout le volume.
Ce fluide homogène
nous sert de point de départ pour analyser comment évolue
la situation au fur et à mesure qu'augmentent les différences
de vitesses internes au fluide.

|
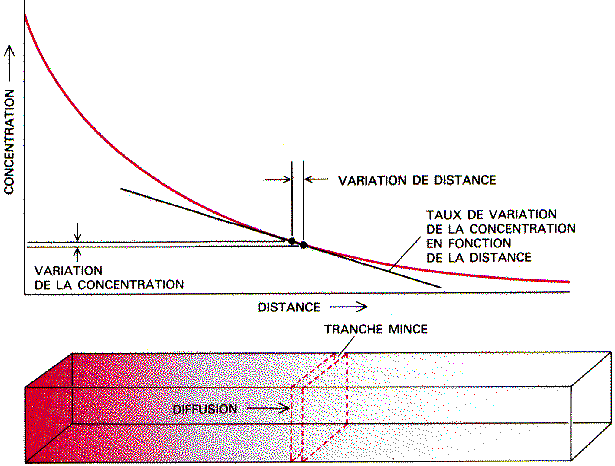
|
|
le mouvement brownien d'une particule microscopique en suspension dans l'eau
[d'après un dessin de Jean Perrin - document de la revue Pour la Science]
|
Dessin du bas : diffusion
progressive et très régulière d'un colorant dans un
liquide par l'effet du mouvement brownien de ses molécules. Dessin
du haut : la concentration du colorant à un instant donné
est portée en fonction de la distance
[figure extraite d'un article de Bernard Lavanda "Le mouvement brownien" dans la revue Pour la Science]
|
Quel est le remarquable de cette situation ? :
À la différence
de ce que l'on observait lors
des quatre étapes précédentes (1ère ligne
du tableau), le sort individuel de chaque atome ou de chaque molécule
est maintenant indéterminable et inintéressant. Ce qui peut
maintenant utilement s'observer, et cela sera valable pendant quatre étapes,
c'est la façon dont se résolvent les différences de
vitesses internes au fluide. Pour cette raison, nous dirons que les 4 étapes
précédentes relevaient d'un fonctionnement "de type ponctuel"
(on observait les déplacements d'un atome considéré
comme une entité ponctuelle en mouvement), tandis que les quatre
étapes de cette nouvelle série relèvent d'un fonctionnement
"en classement", entendu ici dans le sens de "classement des vitesses".
Le fait qu'avec un fluide
on quitte le fonctionnement de type ponctuel a une conséquence très
claire pour les scientifiques : pour étudier le comportement d'un
liquide ou d'un gaz ils ne peuvent plus avoir recours à des calculs
selon les lois de la dynamique qui s'appliquent aux déplacements
des corps que l'on peut isoler ponctuellement, et ils doivent avoir recours
à une méthode de calcul de type probabiliste et statistique
qui se contente de prendre en compte le mouvement moyen de milliards de
molécules.
Le nom donné au paradoxe qui caractérise cette situation : ça se suit sans se suivre
Pourquoi
? : Puisque l'effet du mouvement brownien est de classer
statistiquement le fluide de telle sorte que la vitesse (ou la température
ce qui revient au même) de l'ensemble de ses molécules soit
toujours rangée en ordre bien progressif, il permet que les molécules
se suivent toujours en bon ordre de vitesse. Mais puisque ce classement
statistique n'est obtenu que par un mélange hasardeux perpétuel,
c'est-à-dire par le dérangement perpétuel du classement
des molécules qui ne cessent de se brasser, il implique par conséquent
que les molécules sont perpétuellement déclassées
et ne se suivent donc et jamais en bon ordre de vitesse. Ainsi, dans cette
situation toujours cela se suit (considéré de façon
statistique à grande échelle) sans se suivre (à tout
instant et en tout endroit, considéré à petite échelle).
On peut remarquer que, sur le fond, ce phénomène était déjà présent à l’étape précédente où les
molécules, déjà, se dirigeaient en tous sens, selon qu’elles se faisaient très fugitivement et aléatoirement happer par tel ou tel
réseau, puis par un autre. Cependant, nous ne regardions alors que ce qui survenait aux molécules prises individuellement, tandis que, maintenant, nous
prenons du champ et nous considérons le divorce qui apparaît dans le fluide entre ce qui se produit à petite échelle (le désordre complet des vitesses) et ce qui se produit
à grande échelle (l'uniformité statistique des vitesse).
| Dans
certaines situations, le fonctionnement de la société humaine
présente des analogies avec celui de ce phénomène
physique. Cela peut se lire dans l'art, car les artistes se sont alors
efforcé de mettre à nu les relations paradoxales qu'il implique
entre chaque individu et le reste de sa société : chacun
aspire à un classement permanent et stable des membres de la société
selon leurs mérites personnels, tout en ressentant ce que cela implique
comme profonde remise en cause perpétuelle des différences
acquises, car irrémédiablement celles-ci tendent à
creuser des écarts dans la société. Un classement
stable selon le mérite et non selon les acquis par héritage,
implique donc un déclassement et reclassement perpétuel,
ce qui est l'inverse de la stabilité. |
Comment
ce paradoxe "ça se suit sans se suivre" se manifeste dans
les arts visuels et dans l'architecture :
Expression
analytique (ses 2 aspects incompatibles sont séparés dans
notre perception) :
On
perçoit que les éléments et les espaces se succèdent
par un certain aspect de leurs dispositions, tandis que par un autre aspect
on ne les perçoit pas à la suite les uns des autres. Par
exemple, deux morceaux de courbes se prolongent dans un mouvement continu,
mais un élément interrompt brutalement le premier de telle
sorte que le suivant ne le prolonge pas.
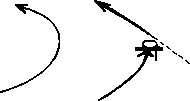 |
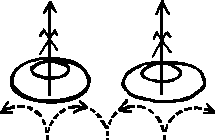 |
|
l'escalier de l'Opéra
Garnier à Paris : les rampes des deux volées se suivent dans
un même arrondi, mais la main courante de la volée du bas
s'interrompt sur un tambour qui l'empêche de se poursuivre
|
le plafond de la salle
de lecture de la Bibliothèque Nationale à Paris : l'axe des
corolles ne les fait pas porter visuellement sur les nervures, mais sur
le vide entre nervures. Les corolles sont au-dessus du vide qu'elles franchissent,
pas à la suite des nervures qui les portent et qu'elles prolongent
|
Expression
synthétique (ses 2 aspects incompatibles sont inséparables
dans notre perception) :
Très
souvent cet effet est obtenu par une impossibilité à trancher
entre deux modes de lectures tels que, dans chaque cas l'ordre des éléments
n'est pas le même. Par exemple, une organisation pyramidale range
des formes en ordre d'importance croissante du bas vers le haut, tandis
que la taille des formes ainsi placées contredisent cet ordre et
suggère un classement différent.
Une
forme peut aussi être lue à la suite de deux autres formes,
de telle sorte que notre perception ne parvient pas à décider
laquelle des deux elle suit vraiment, par exemple :
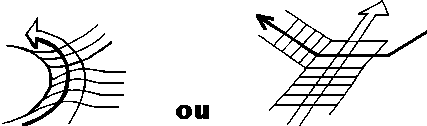 les marches de l'escalier
de l'Opéra Garnier à Paris : par un aspect la seconde volée
suit la première,
mais on peut aussi la
lire comme venant plutôt depuis la volée symétrique
tandis que la première volée se poursuit dans le vide de
l'axe central
les marches de l'escalier
de l'Opéra Garnier à Paris : par un aspect la seconde volée
suit la première,
mais on peut aussi la
lire comme venant plutôt depuis la volée symétrique
tandis que la première volée se poursuit dans le vide de
l'axe central
L'exemple
caractéristique d'architecture à garder à l'esprit
pour se souvenir du paradoxe ça se suit sans se suivre :
Labrouste - les corolles
du plafond de la salle de lecture
de la Bibliothèque Nationale à Paris, qui ne suivent
pas les nervures qu'elles prolongent, mais se dressent dans le vide situé
entre les nervures
Comment
ce paradoxe se manifeste dans la musique, où il signifie "grande
agitation / équilibre" :
Effet analytique (qui
s'entend par l'évolution au fur et à mesure que le temps
passe) :
Alternance de moments où
les notes bougent à toute vitesse entre le grave et l'aigu, et de
moments d'équilibre où la musique se stabilise et reste constante.
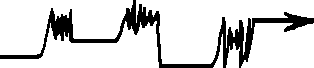
Effet synthétique
(qui s'entend à chaque instant) :
Sans arrêt la musique
ondule comme aléatoirement, mais comme elle monte et descend sans
arrêt, elle se maintient en permanence autour d'une position moyenne
d'équilibre. Cet équilibre moyen est produit par l'agitation
constante de la musique, exactement comme l'homogénéisation
régulière d'un fluide est produit par la constante agitation
frénétique de ses molécules.
Cette position moyenne (représentée
par un trait d'axe sur le croquis ci-dessous) peut être matérialisée
par une ligne mélodique qui martèle une note fixe, ou qui
forme une couche qui s'installe à hauteur continue tandis que le
reste de la musique ondule. La musique de Beethoven en particulier présente
cette structure : écoutez par exemple sous cet angle le début
du premier mouvement de sa symphonie Pastorale ou de sa symphonie Héroïque.

Pour
davantage de développements sur ce fonctionnement paradoxal qui
produit la continuité la plus régulière à l'aide
du plus complet désordre :
-
dans les phénomènes physiques et dans l'évolution
de la société occidentale
- en architecture
(le style "Napoléon III" en art - milieu du XIXème
siècle) :
Garnier - l'escalier de l'Opéra
de Paris
Labrouste - la salle
de lecture de la Bibliothèque Nationale à Paris
-
en musique :
dans le chant grégorien
(jusque vers le Xème siècle)
Pour
des exemples d'architectures où ce paradoxe se combine avec d'autres
:
avec 3 autres paradoxes
associés à égalité, relativement mélangés
sur les mêmes formes (fonctionnement en classement) :
- dans
l'architecture romane (environ de 1000 à 1150 après JC),
il est le 2ème paradoxe analysé
dernière
mise à jour de cette fiche : 18 octobre 2007