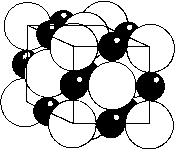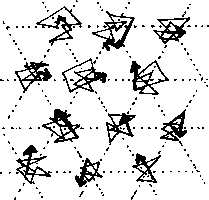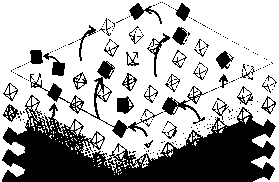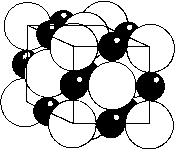accueil |

sommaire
Science |

sommaire
Art |
 sommaire
Architecture
sommaire
Architecture
|
 Sommaire Musique
Sommaire Musique |
fiche
de synthèse : 1ère ligne, 1ère colonne
les
liens de ce tableau vous permettent de rejoindre chacune des 15 autres
fiches
L'idée :
(vaut pour les 4 étapes de la 1ère ligne du tableau)
 Lorsqu'un corps s'échauffe et passe progressivement de l'état solide à l'état liquide, le comportement de ses atomes
se modifie par étapes. Dans l'état solide initial, les atomes sont fermement tenus en place dans un réseau collectif où
ils sont totalement solidaires les uns des autres. Au fur et à mesure que la température s'élève, chaque atome prend de plus en plus d'indépendance
par rapport aux autres et, dans l'état liquide final, les atomes ne tiennent plus entre eux que par des liaisons faibles et extrêmement
transitoires, ce qui explique, précisément, le comportement fluide du matériau.
Lorsqu'un corps s'échauffe et passe progressivement de l'état solide à l'état liquide, le comportement de ses atomes
se modifie par étapes. Dans l'état solide initial, les atomes sont fermement tenus en place dans un réseau collectif où
ils sont totalement solidaires les uns des autres. Au fur et à mesure que la température s'élève, chaque atome prend de plus en plus d'indépendance
par rapport aux autres et, dans l'état liquide final, les atomes ne tiennent plus entre eux que par des liaisons faibles et extrêmement
transitoires, ce qui explique, précisément, le comportement fluide du matériau.
 L'idée est que dans certaines circonstances historiques, le même
type d'évolution peut s'observer dans les relations humaines : à
un moment donné la complète solidarité de groupe,
puis progressivement les individus prennent de l'indépendance et
deviennent de moins en moins solidaires les uns des autres.
L'idée est que dans certaines circonstances historiques, le même
type d'évolution peut s'observer dans les relations humaines : à
un moment donné la complète solidarité de groupe,
puis progressivement les individus prennent de l'indépendance et
deviennent de moins en moins solidaires les uns des autres.
 L'histoire de l'art garde la trace de cette évolution, car chaque
étape de cette évolution repose sur une situation contradictoire
(paradoxale) qui est l'enjeu principal que l'artiste s'efforce de saisir
à travers son art : afin de se comprendre lui-même, et afin
de comprendre sa place dans la société et par rapport à
l'ensemble de l'univers.
L'histoire de l'art garde la trace de cette évolution, car chaque
étape de cette évolution repose sur une situation contradictoire
(paradoxale) qui est l'enjeu principal que l'artiste s'efforce de saisir
à travers son art : afin de se comprendre lui-même, et afin
de comprendre sa place dans la société et par rapport à
l'ensemble de l'univers. |
Les 4 étapes de l'évolution du phénomène physique
qui mène de l'état solide à l'état liquide :
|
0
|
1
|
2
|
3
|
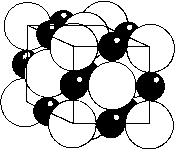
|
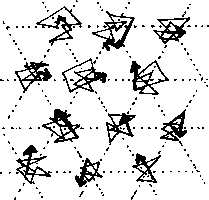
|
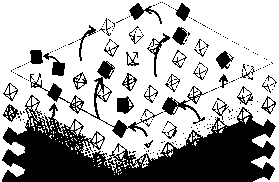
|

|
|
Le réseau solide des atomes, fermement bloqués les uns contre les autres par leurs liaisons chimiques réciproques
|
Les atomes s'agitent frénétiquement, mais sans quitter leur position dans le réseau
|
L'amorce de la fusion : certains atomes commencent à quitter leur place
|
L'état liquide : les atomes bougent librement les uns par rapport aux autres,
ils ne sont plus tenus entre eux que par des liaisons faibles et très transitoires
|
Le phénomène physique caractéristique de la 1ère
étape de cette évolution :
La situation est celle d'un réseau cristallin d'atomes ou de molécules semblables, mutuellement attirés et fortement bloqués les uns contre les autres du fait de leurs liaisons chimiques.
Ce corps solide nous sert de point de départ pour analyser comment évolue la situation au fur et à mesure que sa température s'élève.
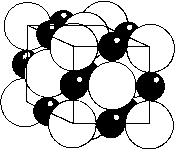 le réseau du chlorure de sodium, que nous connaissons plus simplement sous le nom de sel, où alternent
les anions chlorure et les cations sodium qui s'attirent mutuellement et qui se bloquent fermement les uns
contre les autres du fait de leurs charges électriques opposées [croquis établi d'après un ouvrage scolaire Nathan]
le réseau du chlorure de sodium, que nous connaissons plus simplement sous le nom de sel, où alternent
les anions chlorure et les cations sodium qui s'attirent mutuellement et qui se bloquent fermement les uns
contre les autres du fait de leurs charges électriques opposées [croquis établi d'après un ouvrage scolaire Nathan]
Le nom donné au paradoxe qui caractérise cette situation :
le centre à la périphérie
Pourquoi ? : Dans un tel réseau, où tous les atomes s'appuient les uns sur les autres, de chacun on peut dire qu'il est
au centre des autres et qu'il fait simultanément partie de la périphérie des autres. Ce qui est au centre est donc en même temps à la périphérie.
| Dans
certaines situations, le fonctionnement de la société humaine
présente des analogies avec celui de ce phénomène
physique. Cela peut se lire dans l'art, car les artistes se sont alors
efforcé de mettre à nu les relations paradoxales qu'il implique
entre chaque individu et le reste de sa société : chacun
se ressent comme "le" centre du monde, et se ressent simultanément
entouré de tous côtés par ses semblables, donc par autant
d'autres "centres du monde" |
Comment
ce paradoxe du "centre à la périphérie" se manifeste
dans les arts visuels et dans l'architecture :
Expression
analytique (ses 2 aspects incompatibles sont séparés dans
notre perception) :
L'oeuvre
est organisée pour que notre perception hésite en permanence
entre la perception d'un centre au centre et celle de centres tout autour.
Par exemple, on perçoit clairement l'existence d'un équilibre
central à la figure, et dans le même temps, des axes ou des
centres latéraux lui font concurrence en revendiquant d'être
tout autant considérés comme tels.
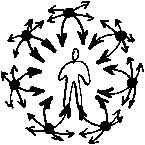 |
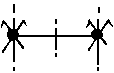 |
 |
|
le plan du pavage du
Capital de Rome : une statue au centre et des branches rayonnantes qui
se dirigent vers elle depuis des centres répartis sur toute sa périphérie
|
le principe d'une façade
d'architecture dite "maniériste" : des figures latérales
axées concurrencent dans notre perception l'axe principal de la
façade
|
le plan de la villa
Rotonda de Palladio : 4 porches latéraux se présentent comme
autant d'axes qui concurrencent l'axe central du bâtiment
|
Expression
synthétique (ses 2 aspects incompatibles sont inséparables
dans notre perception) :
On
rate le point d'appui à partir duquel s'organise la perception de
ce qui nous entoure, puisqu'il est à la fois là où
l'on s'attend à le trouver (au centre de soi) et pas là (puisqu'il
est réparti sur toute notre périphérie). Par analogie,
cela donne par exemple des bâtiments qui s'appuient sur le sol (là
où l'on s'y attend), et qui en même temps proposent un niveau
bas décalé par rapport au sol.
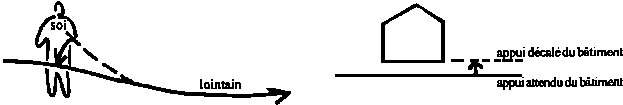
L'exemple
caractéristique d'architecture à garder à l'esprit
pour se souvenir du paradoxe du centre à la périphérie :
Michel-Ange - le pavage du Capitole de Rome
Comment
ce paradoxe se manifeste dans la musique, où il signifie "partout et tout autour, du semblable" :
Effet analytique (qui s'entend par l'évolution au fur et à mesure que le temps passe) :
Monotonie au fil du temps.
Ce sont toujours des choses ou des effets semblables qui reviennent, de
la même façon que ce sont toujours des atomes semblables qui
reviennent quand on se déplace dans le réseau cristallin.

Effet synthétique
(qui s'entend à chaque instant) :
Des thèmes s'entrelacent,
ou bien un thème est constamment entouré par les circonvolutions
d'un autre thème, de la même façon que les atomes d'un
réseau cristallin sont dans toutes les directions entourés d'autres atomes.
La notion de choeur est
aussi utilisée pour cet effet, car dans un choeur on entend des
voix semblables qui s'entourent les unes les autres.
Au piano, ce peut être
la frappe simultanée de plusieurs notes, formant ainsi un groupe
de notes qui s'entourent mutuellement.
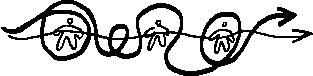 |
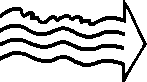 |
|
un thème entrelace
un autre thème qui se retrouve donc partout entouré de façon
semblable, comme le sont les atomes d'un réseau cristallin
|
des voix semblables
chantent en choeur et s'entourent ainsi mutuellement
|
Pour
davantage de développements sur ce fonctionnement paradoxal qui
reporte l'équilibre central sur l'ensemble de la périphérie
:
-
dans les phénomènes physiques et dans l'évolution
de la société occidentale
- en architecture
(le style dit maniériste en art - XVIème siècle)
:
Michel-Ange : le pavage du Capitole
de Rome
Palladio : la façade
de San Francesco della Vigna à Venise
-
en musique :
dans l'Ars Antiqua (fin du
XIIIème siècle)
dans l'Ars Nova (XIVème
siècle)
dans un Canon de l'époque
Renaissance (XVème siècle)
Pour
des exemples d'architectures où ce paradoxe se combine avec d'autres
:
avec 3 autres paradoxes
associés à égalité, relativement mélangés
sur les mêmes formes (fonctionnement en classement) :
- dans l'art
gothique au 14ème siècle, il est le 2ème paradoxe
analysé
l'un des paradoxes enrôle
les 3 autres à son service (fonctionnement en organisation) :
- dans l'art
gothique flamboyant du 15ème siècle, il se met au service
du paradoxe "relié / détaché"
- dans l'art
gothique flamboyant du 16ème siècle, c'est lui qui enrôle
à son service trois autres paradoxes
dernière mise à jour de cette fiche : 22 août 2007